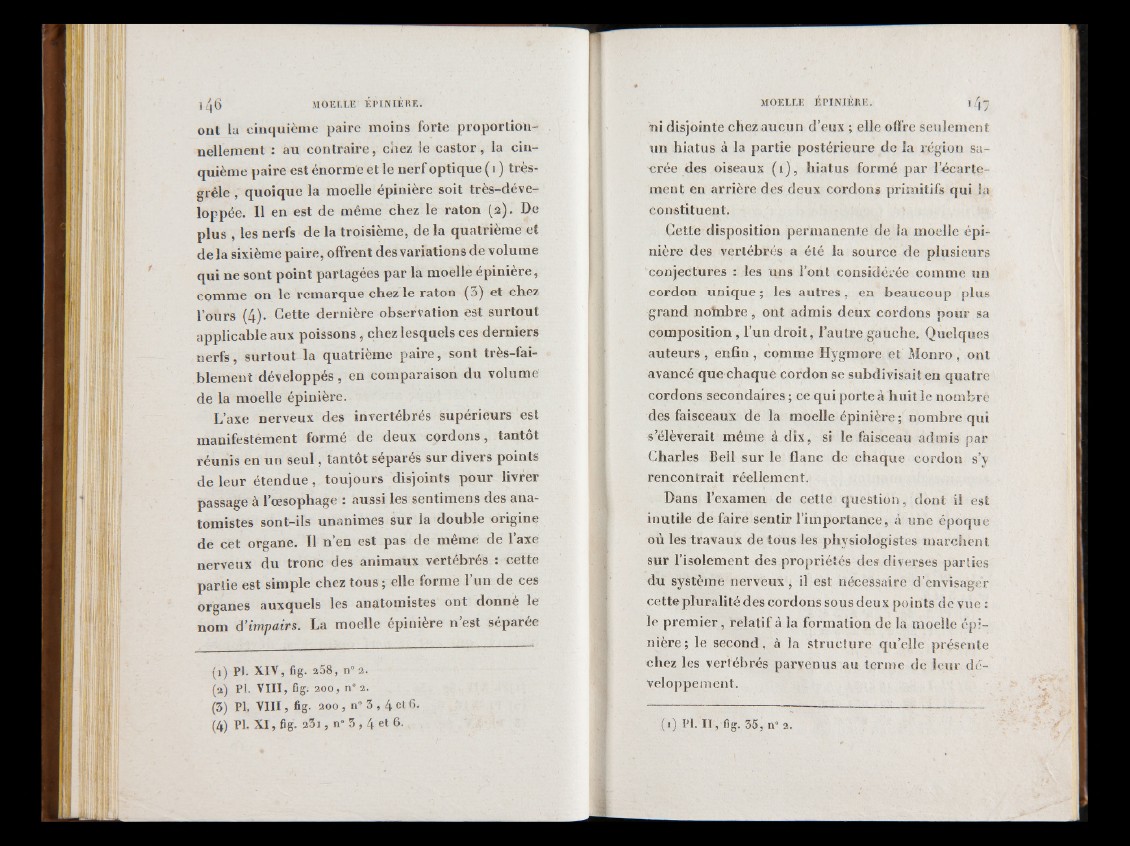
ont la cinquième paire moins forte proportionnellement
: au contraire, chez le castor, la cinquième
paire est énorme et le nerf optique ( 1 ) très-
grêle , quoique la moelle épinière soit très-déve-
loppée. Il en est de même chez le raton (2). De
plus , les nerfs de la troisième, de la quatrième et
de la sixième paire, offrent des variations de volume
qui ne sont point partagées par la moelle épinière,
comme on le remarque chez le raton (3) et chez
l’ours (4). Cette dernière observation est surtout
applicable aux poissons, chez lesquels ces derniers
nerfs, surtout la quatrième paire, sont très-faiblement
développés, en comparaison du volume
de la moelle épinière.
L’axe nerveux des invertébrés supérieurs est
manifestément formé de deux cordons, tantôt
réunis en un seul, tantôt séparés sur divers points
de leur étendue, toujours disjoints pour livrer
passage à l’oesophage : aussi les sentimens des anatomistes
sont-ils unanimes sur la double origine
de cet organe. Il n’en est pas de même de l’axe
nerveux du tronc des animaux vertébrés : cette
partie est simple chez tous ; elle forme l’un de ces
organes auxquels les anatomistes ont donne le
nom d'impairs. La moelle épinière n ’est séparée 1 2 3 4
(1) PJ. XIY, fig. 258, n° 2.
(2) PI. YIII, fig. 200, n° 2.
(3) PI, VIII, fig. 200, n” 3 , 4 et 6.
(4) Pl. XI, fig. 25i , n° 3 , 4 et 6.
mi disjointe chez aucun d’eux ; elle offre seulement
un hiatus à la partie postérieure de la région sacrée
des oiseaux (1), hiatus formé par l’écartement
en arrière des deux cordons primitifs qui la
constituent.
Cette disposition permanente de la moelle épinière
des vertébrés a été la source de plusieurs
conjectures : les uns l’ont considérée comme un
cordon unique ; les autres, en beaucoup plus
grand noinbre, ont admis deux cordons pour sa
composition, l’un droit, l’autre gauche. Quelques
au teu rs, enfin, comme Hygmore et Monro, ont
avancé que chaque cordon se subdivisait en quatre
cordons secondaires ; ce qui porte à huit le nombre
des faisceaux de la moelle épinière; nombre qui
s’élèverait même à dix, si le faisceau admis par
Charles Bell sur le flanc de chaque cordon s’y
rencontrait réellement.
Dans l’examen de cette question, dont il est
inutile de faire sentir l’importance, à une époque
où les travaux de tous les physiologistes marchent
sur l’isolement des propriétés des diverses parties
du système nerveux ; il est nécessaire d’envisager
cette pluralité des cordons sous deux points de vue :
le premier, relatif à la formation de la moelle épinière;
le second, à la structure quelle présente
chez les vertébrés parvenus au terme de leur développement.