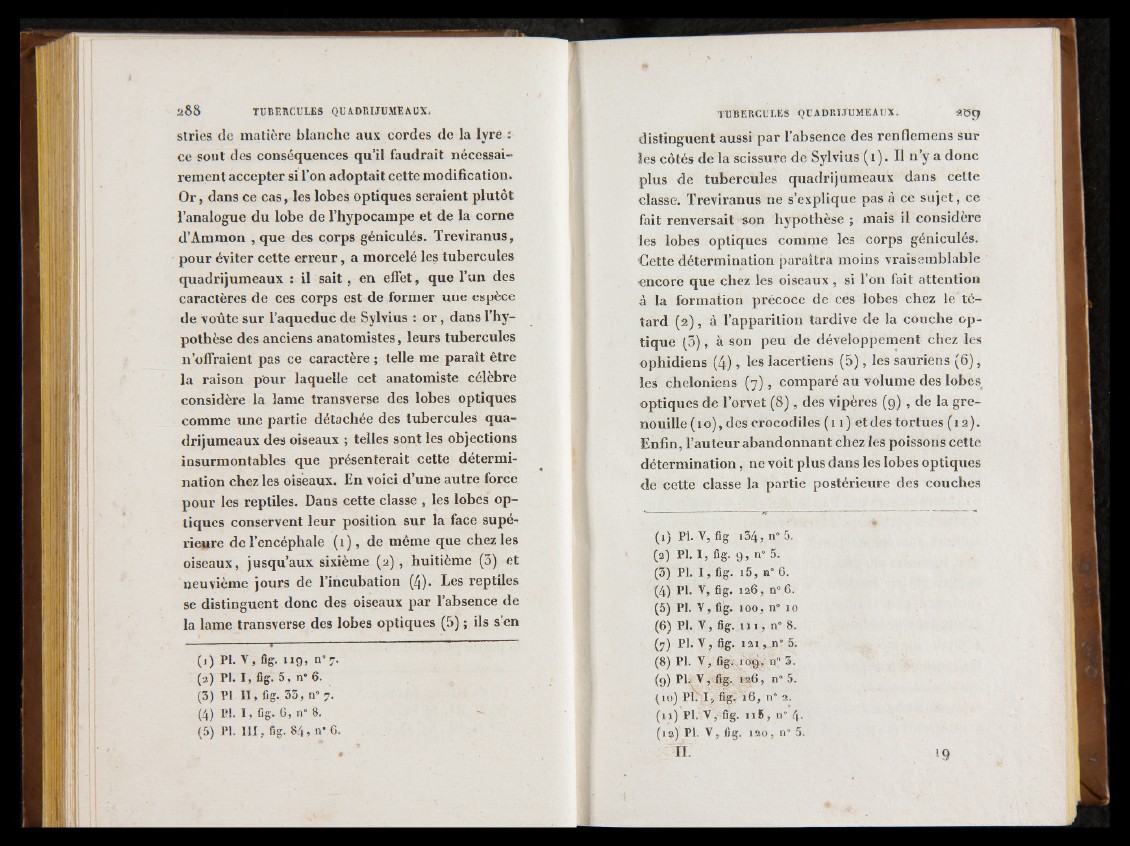
stries de matière blanche aux cordes de la lyre i
ce sont des conséquences qu’il faudrait nécessairement
accepter si l’on adoptait cette modification.
Or, dans ce cas, les lobes optiques seraient plutôt
l’analogue du lobe de l’hypocampe et de la corne
d’Ammon , que des corps géniculés. Treviranus,
pour éviter cette erreur, a morcelé les tubercules
quadrijumeaux : il sait, en effet, que l’un des
caractères de ces corps est de former une espèce
de voûte sur l’aqueduc de Sylvius : o r , dans l’hypothèse
des anciens anatomistes, leurs tubercules
n’offraient pas ce caractère ; telle me paraît être
la raison pour laquelle cet anatomiste célèbre
considère la lame transverse des lobes optiques
comme une partie détachée des tubercules quadrijumeaux
des oiseaux ; telles sont les objections
insurmontables que présenterait cette détermination
chez les oiseaux. En voici d’une autre force
pour les reptiles. Dans cette classe , les lobés optiques
conservent leur position sur la face supérieure
de l’encéphale ( i ) , de même que chez les
oiseaux, jusqu’aux sixième (2), huitième (5) et
neuvième jours de l’incubation (4)- Des reptiles
se distinguent donc des oiseaux par l’absence de
la lame transverse des lobes optiques (5) ; ils s’en
1 1 ' ----- "r . _
(j) PL Y, fig. 119, n" 7,
(2) PI. I , fig. 5 , n° 6.
(3) PI II, fig. 33, n” 7.
(4) PI. I , fig. 6, n» 8.
(5) PL III, fig. 84, n** 6. ■*
distinguent aussi par l’absence des renflemens sur
les côtés de la scissure de Sylvius (1). Il n’y a donc
plus de tubercules quadrijumeaux dans cette
classe. Treviranus ne s’explique pas à ce sujet, ce
fait renversait son hypothèse ; mais il considère
les lobes optiques comme les corps géniculés.
Cette détermination paraîtra moins vraisemblable
encore que chez les oiseaux, si l’on fait attention
à la formation précoce de ces lobes chez le têtard
(2), à l’apparition tardive de la couche optique
( 3 ) , à son peu de développement chez les
ophidiens (4) , les lacertiens (5), les sauriens (6),
les cheloniens (7), comparé au volume des lobes
optiques de l’orvet (8), des vipères (9) , de la grenouille
( 1 o), des crocodiles (11) et des tortues (12).
Enfin, l’auteur abandonnant chez les poissons cette
détermination, ne voit plus dans les lobes optiques
de cette classe la partie postérieure des couches
(1) PL V, fig i34,n ” 5.
(2) Pl. I , fig. 9 , n° 5.
(3) PL I , fig. i 5, n° 6.
(4) PL V, fig. 126, n0 6.
(5) Pl. Y, fig. 100, n° 10
(6) PL V, fig. 111, n° 8.
(7) PL Y, fig. iai.,,.n° 5.
(8) PL V, figt,r<^,; n" 3.
(9) PL V,vfig. 126, n° 5.
(10) P lh l, fig. 16, n° 2.
(11) PL V, fig. n 5 , n° 4*
(12) PL V, fig. 120, n” 5.
il. 19