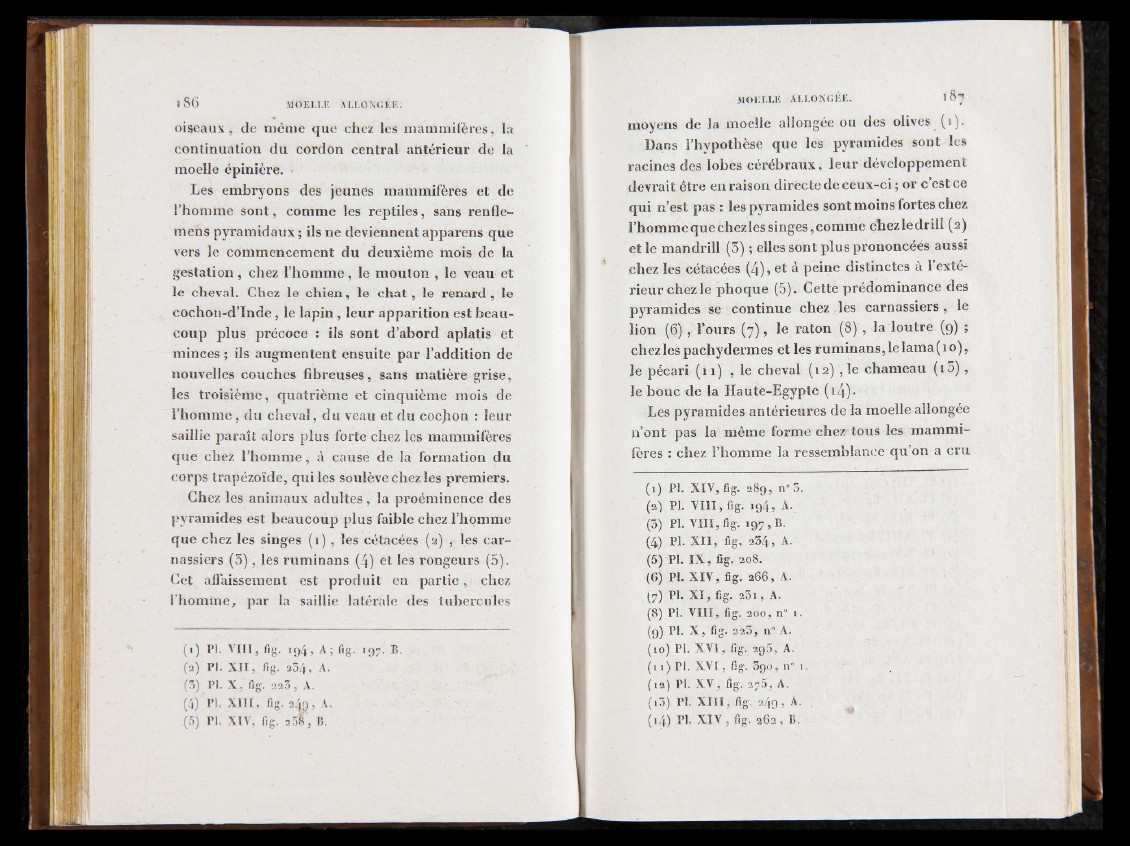
oiseaux, de même que chez les mammifères, la
continuation du cordon central antérieur de la
moelle épinière. •
Les embryons des jeunes mammifères et de
l’homme sont, comme les reptiles, sans renfle-
mens pyramidaux; ils ne deviennent apparens que
vers le commencement du deuxième mois de la
gestation, chez l’homme, le mouton , le veau et
le cheval. Chez le chien, le chat, le renard, le
cochon-d’Inde, le lapin, leur apparition est beaucoup
plus précoce : ils sont d’abord aplatis et
minces ; ils augmentent ensuite par l’addition de
nouvelles couches fibreuses, sans matière grise,
les troisième, quatrième et cinquième mois de
l’homme, du cheval, du veau et du cocjion : leur
saillie paraît alors plus forte chez les mammifères
que chez l’homme, à cause de la formation du
corps trapézoïde, qui les soulève chez les premiers.
Chez les animaux adultes, la proéminence des
pyramides est beaucoup plus faible chez l’homme
que chez les singes (1), les cétacées (2) | les carnassiers
(5), les ruminans (4) et les rongeurs (5).
Cet affaissement est produit en partie, chez
l’homme, par la saillie latérale des tubercules
( 0 P). VIII, fig. 194, A; fig. i
(a) PI- XII, fig. 2'34-,- A.
(3) PI. X, fig. 223, A.
(4) PI- XIII, fig. 249, A.
(5) PI. XIV, fig. 2ï f , B.
97. B.
moyens de la moelle allongée ou des olives (1).
Dans l’hypothèse que les pyramides sont les
racines des lobes cérébraux, leur développement
devrait être en raison directe de ceux-ci ; or c’est ce
qui n’est pas : les pyramides sont moins fortes chez
l’homme que chezles singes, comme chezledrilî (2)
et le mandrill (5) ; elles sont plus prononcées aussi
chez les cétacées (4), et à peine distinctes à 1 extérieur
chez le phoque (5). Cette prédominance des
pyramides se continue chez les carnassiers, le
lion (6), l’ours (7), le raton (8) , la loutre (9) ;
chez les pachydermes et les ruminans, le lama (10),
le pécari (11) , le cheval (12) ,1e chameau ( i 5) ,
le bouc de la Haute-Egypte ( i4)-
Les pyramides antérieures de la moelle allongée
n’ont pas la même forme chez tous les mammifères
: chez l’homme la ressemblance qu’on a cru
(1) PI. XIV, fig. 289, n° 3,
(2) PL VIII, fig. 194, A.
(3) P L V I I I , fig. 1 9 7 , B.
(4) PL XII, fig, 234, A.
(5) PI. IX, fig. 208.
(6) PL XIV, fig. 266, A.
(7) PI. XI, fig. 23i , A.
(8) P l . V I I I , fig. 2 0 0 , n° 1 .
(9) PL X , fig. 223, n° A.
( t o ) PL XVI, fig. 295, A .
(tt) PL XVI, fig. 3go, n° 1.
(12) Pl. XV, fig. 275, A.
( .3) P L X I I I , fig. 249, A- .
(14) PL XIV, fig. 262 , B.