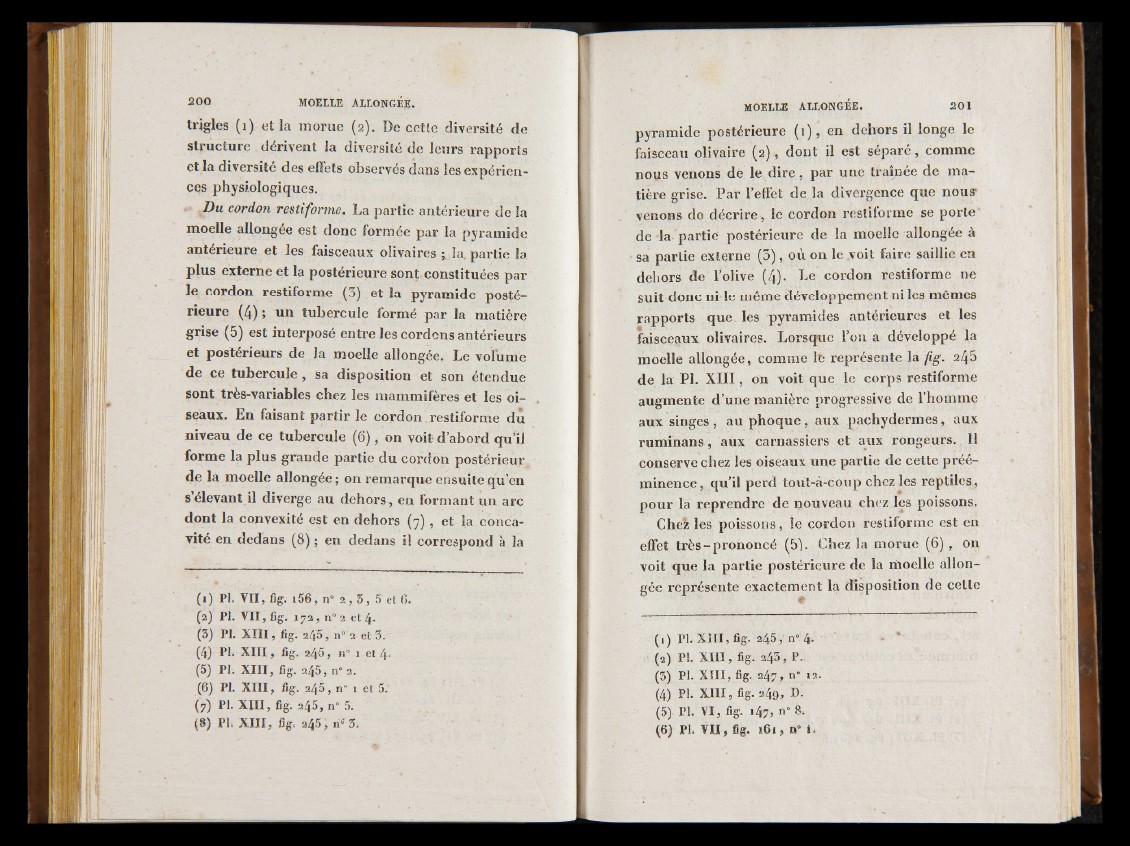
trigles (1) et la morue (a).. De cetie diversité de
structure dérivent la diversité de leurs rapports
et la diversité des effets observés dans les expériences
physiologiques.
- Du cordon restiforme. La partie antérieure de îa
moelle allongée est donc formée par la pyramide
antérieure et les faisceaux oîivaires ; la. partie la
plus externe et la postérieure sont constituées par
le cordon restiforme (3) et la pyramide postérieure
(4) ; un tubercule formé par la matière
grise (5) est interposé entre les cordons antérieurs
et postérieurs de la moelle allongée. Le volume
de ce tubercule, sa disposition et son étendue
sont très-variables chez les mammifères et les oiseaux.
En faisant partir le cordon restiforme du
niveau de ce tubercule (6), on voit-d’abord qu’il
forme la plus grande partie du cordon postérieur
de la moelle allongée; on remarque ensuite qu’en
s élevant il diverge au dehors , en formant un arc
dont la convexité est en dehors (7) , et la concavité
en dedans (8); en dedans il correspond à la 1
(1) PL VII, fig. i56, n° 2 , 3 , 5 et G.
(2) PL VII, fig. 172, n° 2 et 4.
(3) PL XIII, fig. 245, n° 2 et 5.
(4) PL XIII, fig. 245, n° 1 et 4 -
(5) Pl. XIII, fig. 245, n° 2.
(6) PL XIII, fig. 245, n° 1 et 5.
(7) Pl. XIII, fig. 245, n° 5.
(S) PL XIII, fig. 245, n65i
pyramide postérieure (1), en dehors il longe le
faisceau olivaire (2), dont il est sépare, comme
nous venons de le dire, par une traînée de matière
grise. Par l’effet de la divergence que nous'
venons do décrire, le cordon restiforme se porte'
de la partie postérieure de la moelle allongée à
sa partie externe (3), où on le ,voit faire saillie en
dehors de l’olive (4). Le cordon restiforme ne
suit donc ni le même développement ni les mêmes
rapports que les pyramides antérieures et les
faisceaux oîivaires. Lorsque i’on a développé la
moelle allongée, comme le représente la fig, 245
de la PL XIII, on voit que le corps restiforme
augmente d’une manière progressive de l’homme
aux singes, au phoque , aux pachydermes, aux
ruminans, aux carnassiers et aux rongeurs. 11
conserve chez les oiseaux une partie de cette prééminence,
qu’il perd tout-à-coup chez les reptiles,
pour la reprendre de nouveau chez les poissons.
Chei les poissons, le cordon restiforme est en
effet très-prononcé (5). Chez la morue (6), on
voit que la partie postérieure de la riioelle allongée
représente exactement la disposition de cette 1 2 * 4 5 6
(1) PL XIII, fig. 245,'n“ 4-
(2) Pl. XIII, fig. 243, P.
(5) PL XIII, fig. 247, n* 12
(4) PL XIII, fig. 249, D.
(5) Pl. VI, fig. 147, n” 8.
(6) PL VII, fig. 161, n° I,