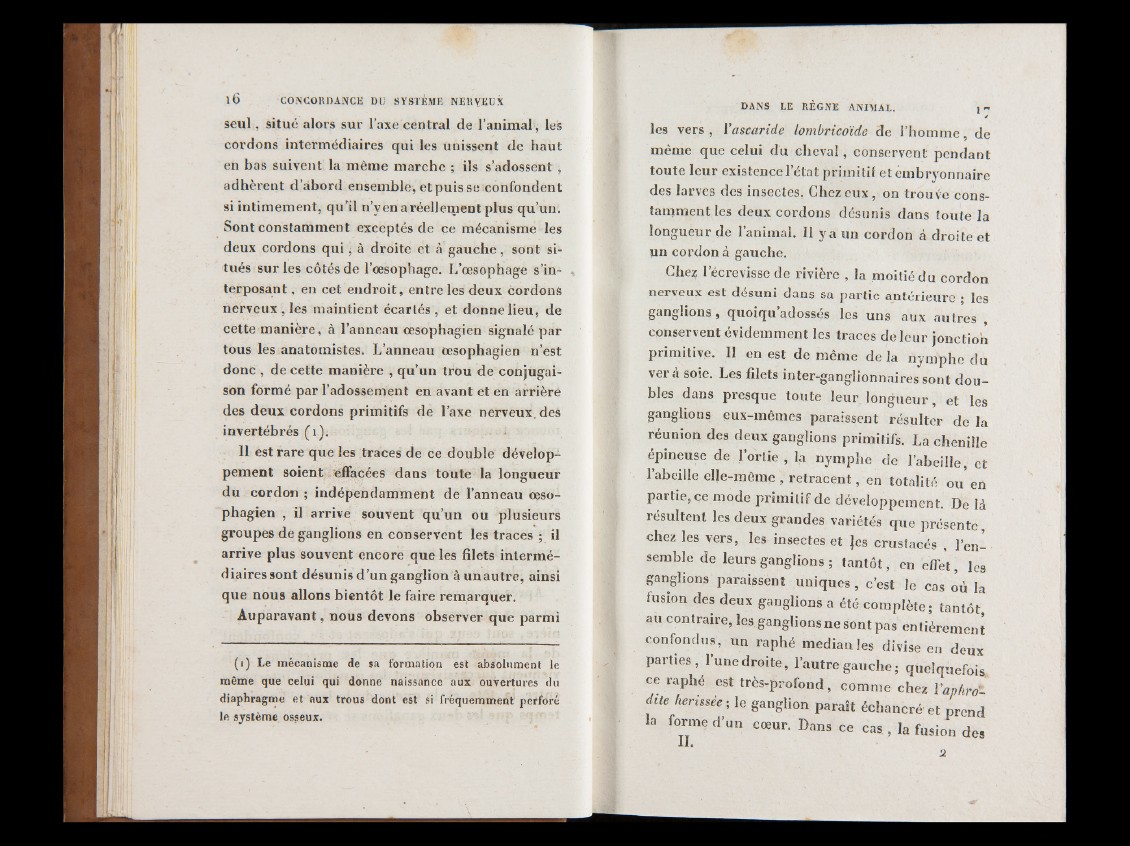
seul, situé alors sur Taxe central de l’animal , les
cordons intermédiaires qui les unissent de haut
en bas suivent la même marche ; ils s’adossent ,
adhèrent d’abord ensemble, et puis se confondent
si intimement, qu’il n’v en a réellement plus qu’un.
Sont constamment exceptés de ce mécanisme les
deux cordons qui ; à droite et à gauche, sont situés
sur les côtés de l’oesophage. L’oesophage s’interposant
, en cet endroit, entre les deux cordons
nerveux , les maintient écartés , et donne lieu, de
cette manière, à l’anneau oesophagien signalé par
tous les anatomistes. L’anneau oesophagien n’est
donc , de cette manière , qu’un trou de conjugaison
formé par l’adossement en avant et en arriéré
des deux cordons primitifs de l’axe nerveux, des
invertébrés ( 1). <
11 est rare que les traces de ce double développement
soient effacées dans toute la longueur
du cordon ; indépendamment de l’anneau oesophagien
, il arrive souvent qu’un ou plusieurs
groupes de ganglions en conservent les traces ; il
arrive plus souvent encore que les filets intermédiaires
sont désunis d ’un ganglion à un autre, ainsi
que nous allons bientôt le faire remarquer.
Auparavant , nous devons observer que parmi
(i) Le mécanisme de sa formation est absolument le
même que celui qui donne naissance aux ouvertures du
diaphragme et aux trous dont est si fréquemment perforé
le système osseux.
les vers, Yascaride lombricoïde de l’homme de
même que celui du cheval, conservent pendant
toute leur existence l’état primitif et embryonnaire
des larves des insectes, Chez eux, on trouve constamment
les deux cordons désunis dans toute la
longueur de l’animal. Il y a un cordon à droite et
un cordon à gauche.
Cheç l’écrevisse de rivière , la moitié du cordon
nerveux est désuni dans sa partie antérieure ; les
ganglions, quoiqu’adossés les uns aux autres ,
conservent évidemment les traces de leur jonctioh
primitive. Il en est de même delà nymphe du
ver à soie. Les filets inter-ganglionnaires sont doubles
dans presque toute leur longueur, et les
ganglions eux-mêmes paraissent résulter de la
réunion des deux ganglions primitifs. La chenille
épineuse de l’ortie, la nymphe de l’abeille, et
l’abeille elle-même » retracent, en totalité ou en
partie, ce mode primitif de développement. De là
résultent les deux grandes variétés que présente,
chez les vers, les insectes et jes crustacés , l’ensemble
de leurs ganglions ; tantôt, en effet, les
ganglions paraissent uniques , c’est le cas où la
fusion des deux ganglions a été complète; tantôt
au contraire, les ganglions ne sont pas entièrement
confondus, un raphé médian les divise en deux
parties, l’une droite, l’autre gauche; quelquefois,
ce raphé est très-profond, comme chez Vap/iro-
dite hérissée; le ganglion paraît échancré'et prend
la forme d’un coeur. Dans ce cas., la fusion des