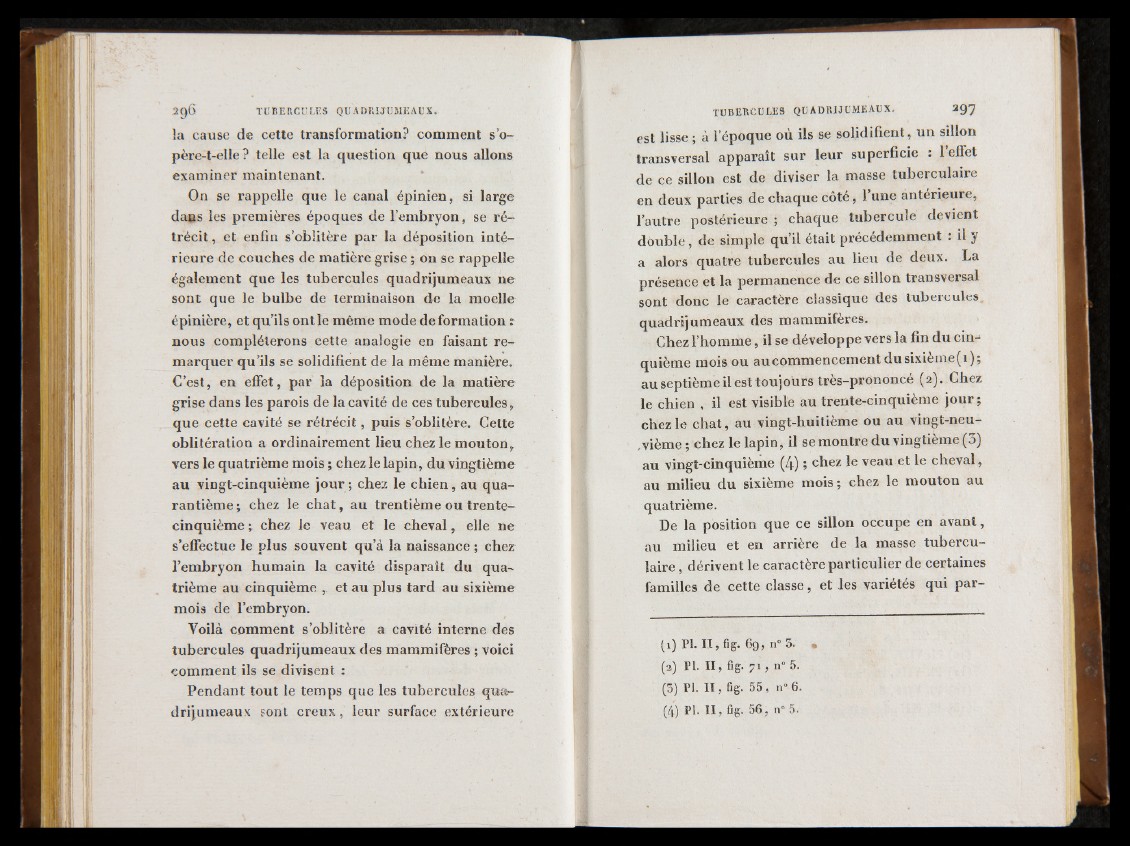
la cause de cette transformation? comment s’opère
t-elle? telle est la question que nous allons
examiner maintenant.
On se rappelle que le canal épinien, si large
daes les premières époques de l’embryon, se rétrécit
, et enfin s’oblitère par la déposition intérieure
de couches de matière grise ; on se rappelle
également que les tubercules quadrijumeaux ne
sont que le bulbe de terminaison de la moelle
épinière, et qu’ils ont le même mode deformation r
nous compléterons cette analogie en faisant remarquer
qu’ils se solidifient de la même manière.
C’est, en effet, par la déposition de la matière
grise dans les parois de la cavité de ces tubercules,
que cette cavité se rétrécit, puis s’oblitère. Cette
oblitération a ordinairement lieu chez le mouton,
vers le quatrième mois ; chez le lapin, du vingtième
au vingt-cinquième jour ; chez le chien, au quarantième;
chez le chat, au trentième ou trente-
cinquième ; chez le veau et le cheval, elle 11e
s’effectue le plus souvent qu’à la naissance ; chez
l’embryon humain la cavité disparaît du quatrième
au cinquième , et au plus tard au sixième
mois de l’embryon.
Yoilà comment s’oblitère a cavité interne des
tubercules quadrijumeaux des mammifères ; voici
comment ils se divisent :
Pendant tout le temps que les tubercules quadrijumeaux
sont creux, leur surface extérieure
est lisse ; à l’époque où ils se solidifient, un sillon
transversal apparaît sur leur superficie : 1 effet
de ce sillon est de diviser la masse tuberculaire
en deux parties de chaque côté, 1 une antérieure,
l’autre postérieure ; chaque tubercule devient
double, de simple qu’il était précédemment : il y
a alors quatre tubercules au lieu de deux. La
présence et la permanence de ce sillon transversal
sont donc le caractère classique des tubercules
quadrijumeaux des mammifères.
Chez l’homme, il se développe vers la fin du cin-*
quième mois ou au commencement du sixième(i);
au septième il est toujours très-prononcé (2). Chez
le chien , il est visible au trente-cinquième jour;
chez le chat, au vingt-huitième ou au vingt-neu-
,vième ; chez le lapin, il se montre du vingtième (3)
au vingt-cinquième (4) ; chez le veau et le cheval,
au milieu du sixième mois ; chez le mouton au
quatrième.
De la position que ce sillon occupe en avant,
au milieu et en arrière de la masse tuberculaire
, dérivent le caractère particulier de certaines
familles de cette classe, et les variétés qui par-
(1) PI. I I , fig. 69, n° 3. .
(2) PI. I I , fig. 71, n° 5.
(5) PI. I l , fig'. 55 , n° 6.
(4) PI. II, fig. 56, n* 5.