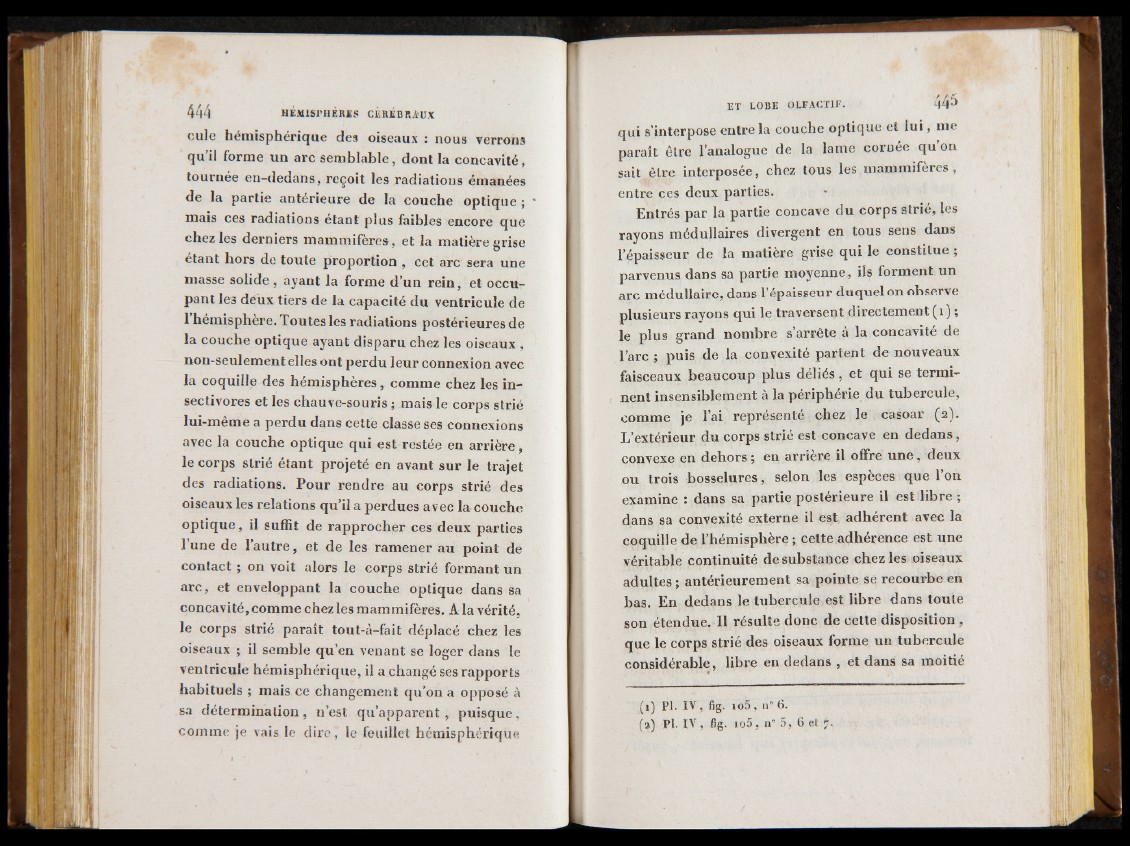
cule hémisphérique des oiseaux : nous verrons
qu’il forme un arc semblable, dont la concavité,
tournée en-dedans, reçoit les radiations émanées
de la partie antérieure de la couche optique ;
mais ces radiations étant plus faibles encore que
chez les derniers mammifères, et la matière grise
étant hors de toute proportion , cet arc sera une
masse solide, ayant la forme d’un rein, et occupant
les deux tiers de la capacité du ventricule de
1 hémisphère. Toutes les radiations postérieures de
la couche optique ayant disparu chez les oiseaux,
non-seulement elles ont perdu leur connexion avec
la coquille des hémisphères, comme chez les insectivores
et les chauve-souris ; mais le corps strié
lui-même a perdu dans cette classe ses connexions
avec la couche optique qui est restée en arrière ,
le corps strié étant projeté en avant sur le trajet
des radiations. Pour rendre au corps strié des
oiseaux les relations qu’il a perdues avec la couche
optique, il suffit de rapprocher ces deux parties
l’une de l’au tre , et de les ramener au point de
contact ; on voit alors le corps strié formant un
arc, et enveloppant la couche optique dans sa
concavité, comme chez les mammifères. A la vérité,
le corps strié paraît tout-à-fait déplacé chez les
oiseaux ; il semble qu’en venant se loger dans le
ventricule hémisphérique, il a changé ses rapports
habituels ; mais ce changement qu’on a opposé à
sa détermination, n’est qu’apparent, puisque,
comme je vais le dire, le feuillet hémisphérique
qui s'interpose entre la couche optique et lu i, me
paraît être l’analogue de la lame coruee qu on
sait être interposée, chez tous les mammifères ,
entre ces deux parties.
Entrés par la partie concave du corps strie, les
rayons médullaires divergent en tous sens dans
l’épaisseur de la matière grise qui le constitue ;
parvenus dans sa partie moyenne, ils forment un
arc médullaire, dans l’épaisseur duquel on observe
plusieurs rayons qui le traversent directement (1) ;
le plus grand nombre s’arrête à la concavité de
l ’a rc ; puis de la convexité partent de nouveaux
faisceaux beaucoup plus déliés, et qui se terminent
insensiblement à la périphérie du tubercule,
comme je l’ai représenté chez le casoar (2).
L’extérieur du corps strié est concave en dedans,
convexe en dehors ; en arrière il offre u n e , deux
ou trois bosselures, selon les espèces que l’on
examine : dans sa partie postérieure il est libre ;
dans sa convexité externe il est adhérent avec la
coquille de l’hémisphère ; cette adhérence est une
véritable continuité de substance chez les oiseaux
adultes ; antérieurement sa pointe se recourbe en
bas. En dedans le tubercule est libre dans toute
son étendue. Il résulte donc de cette disposition ,
que le corps strié des oiseaux forme un tubercule
considérable, libre en dedans , et dans sa moitié
(1) PI. IV, fig. io 5 , n" 6.
(a) PI. IV, fig. jo5 , n° 5, 6 et 7,