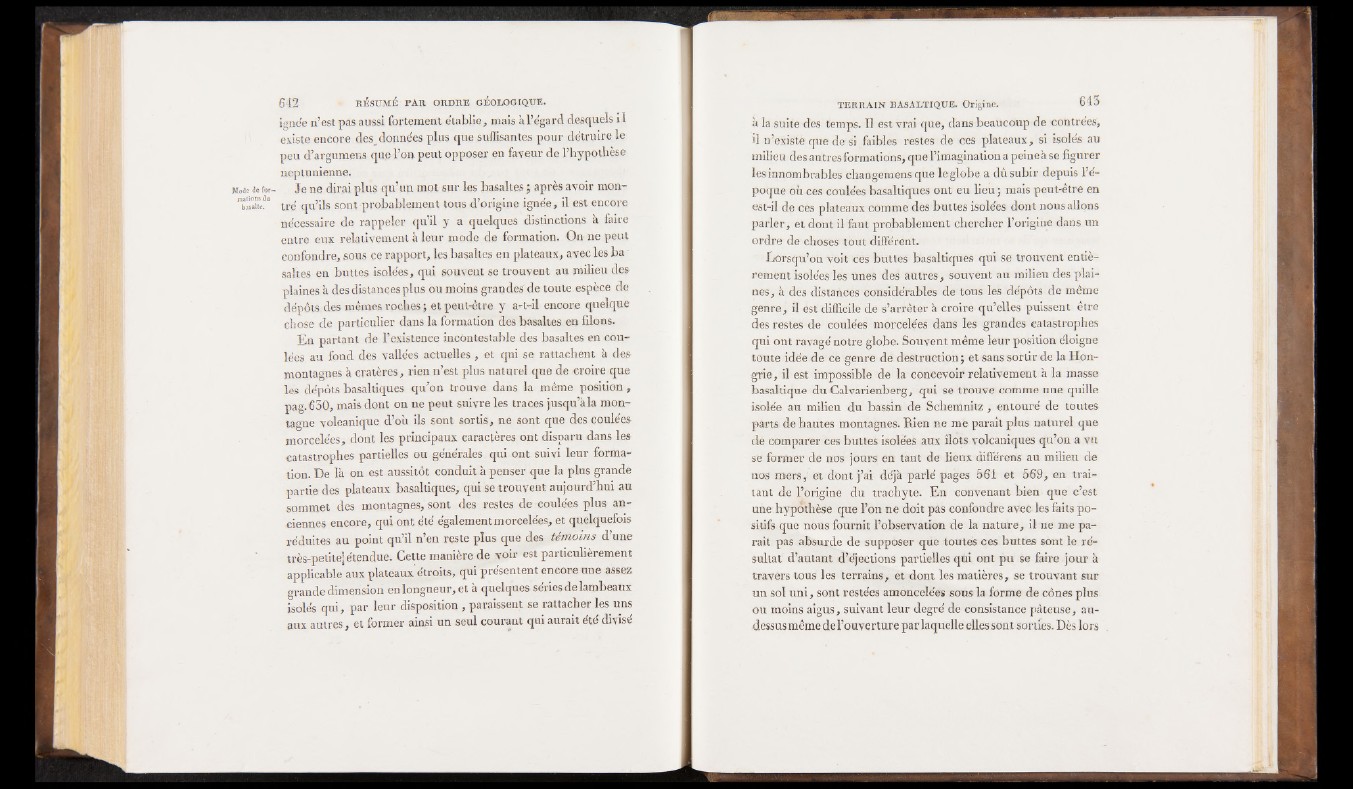
Mode de formations
du
basalte.
ignée n’est pas aussi fortement établie, mais à l’égard desquels il
existe encore des_ données plus que suffisantes pour détruire le
peu d’argumens que l’on, peut opposer en faveur de l’hypothèse
neptunienne.
Je ne dirai plus qu’un mot sur les basaltes ; après avoir montré
qu’ils sont probablement tous d’origine ignée, il est encore
nécessaire de rappeler qu’il y a quelques distinctions à faire
entre eux relativement à leur mode de formation. On ne peut
confondre, sous ce rapport, les basaltes en plateaux, avec les ba -
saltes en buttes isolées, qui souvent se trouvent au milieu des
plaines à des distances plus ou moins grandes' de toute espèce de
dépôts des mêmes roches ; et peut-être y a-t-il encore quelque
chose de particulier dans la formation des basaltes en filons.
En partant de l’existence incontestable des basaltes en coulées
au fond des vallées actuelles , et qui se rattachent à des
montagnes à eratères, rien n’est plus naturel que de croire que
les dépôts basaltiques qu’on trouve dans la même position ,
pag. 630, mais dont on ne peut suivre les traces jusqu’àla montagne
volcanique d’où ils sont sortis, ne sont que des coulées
morcelées, dont les principaux caractères ont disparu dans les
catastrophes partielles ou générales qui ont suivi leur formation.
De là on est aussitôt conduit à penser que la plus grande
partie des plateaux basaltiques, qui se trouvent aujourd’hui au
sommet des montagnes, sont des restes de coulées plus anciennes
encore, qui ont été également morcelées, et quelquefois
réduites au point qu’il n’en reste plus que des tém oins d’une
très-petite] étendue. Cette manière de voir est particulièrement
applicable aux plateaux étroits, qui présentent encore une assez
grande dimension en longueur, et à quelques séries de lambeaux
qui, par leur disposition , paraissent se rattacher les uns
aux autres, et former ainsi un seul courant qui aurait été divisé
à la suite des temps. Il est vrai que, dans beaucoup de contrées,
il n’existe que de si faibles restes de ces plateaux, si isolés au
milieu des autres formations, que l’imagination a peineà se figurer
les innombrables changemens que le globe a dû subir depuis l’époque
où ces coulées basaltiques ont eu lieu ; mais peut-être en
est-il de ces plateaux comme des buttes isolées dont nous allons
parler, et dont il faut probablement chercher l’origine dans un
ordre de choses tout différent.
Lorsqu’on voit ces buttes basaltiques qui se trouvent entièrement
isolées les unes des autres, souvent au milieu des plaines,
à des distances considérables de tous les dépôts de même
genre, il est difficile de s’arrêter à croire qu’elles puissent être
des restes de coulées morcelées dans les grandes catastrophes
qui ont ravagé notre globe. Souvent même leur position éloigne
toute idée de ce genre de destruction; et sans sortir de la Hongrie,
il est impossible de la concevoir relativement à la masse
basaltique du Calvarienberg, qui se trouve comme une quille
isolée au milieu du bassin de Schemnitz, entouré de toutes
parts de hautes montagnes. Rien ne me parait plus naturel que
de comparer ces buttes isolées aux îlots volcaniques qu’on a vu
se former de nos jours en tant de lieux différens au milieu de
nos mers, et dont j’ai déjà parlé pages 561 et 569, en traitant
de l’origine du trachyte. En convenant bien que c’est
une hypothèse que l’on ne doit pas confondre avec les faits positifs
que nous fournit l’observation de la nature, il ne me paraît
pas absurde de supposer que toutes ces buttes sont le résultat
d’autant d’éjections partielles qui ont pu se faire jour à
travers tous les terrains, et dont les matières, se trouvant sur
un sol uni, sont restées amoncelées sous la forme de cônes plus
ou moins aigus, suivant leur degré de consistance pâteuse, au-
dessus même de l’ouverture par laquelle elles sont sorties. Dès lors