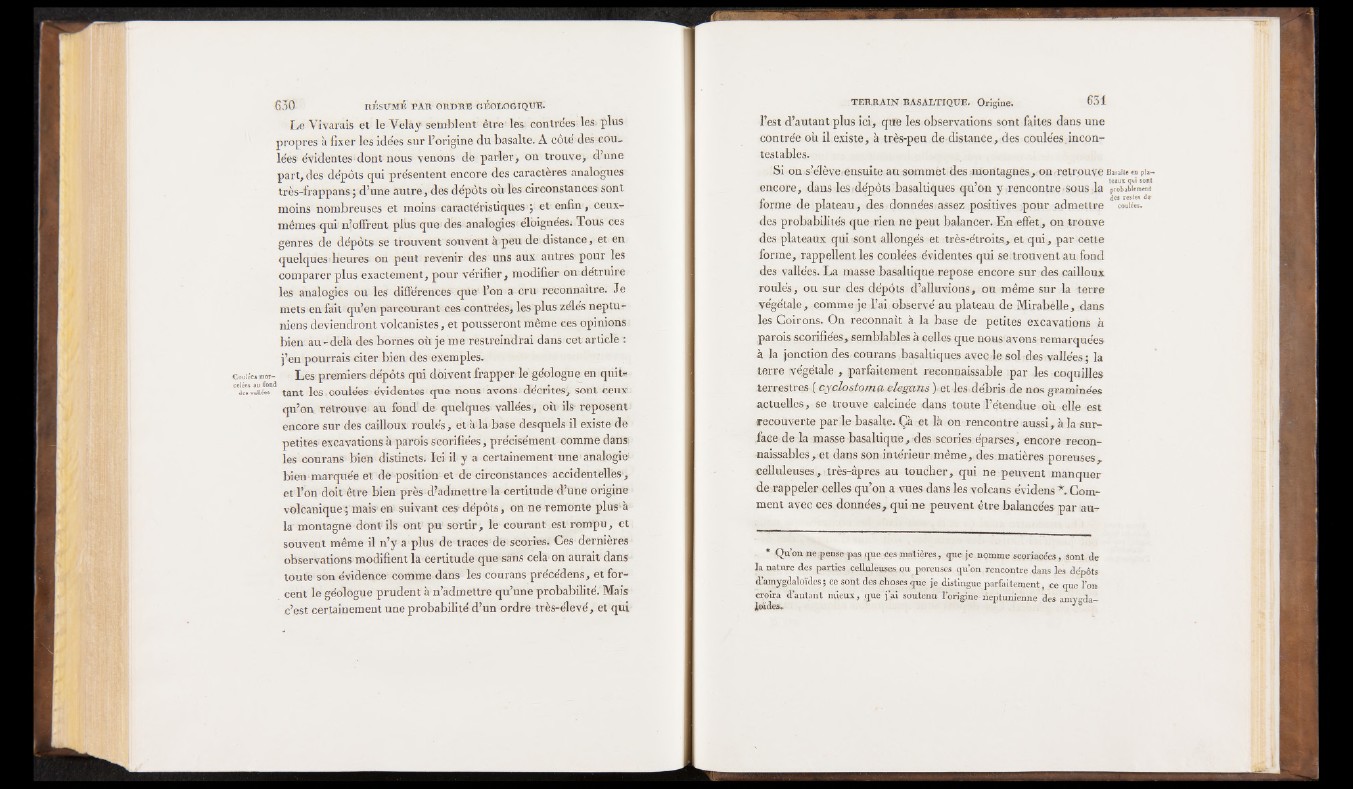
Le Vi va rais et le Velaÿ semblent être- les contrées les- plus
propres à fixer les ide'es sur l’origine du basalte. A côte des côu^
lées évidentes dont nous venons dé parler, on trouve, d’une
part, des dépôts qui présentent encore des caractères analogues
très-frappans ; d’une autre, des dépôts où lfes circonstances sont
moins nombreuses et moins caractéristiques-p et enfin,. ceux-
mêrnes qui n’offrent plus que des analogies éloigneesj Tous ces
genres de dépôts se trouvent souvent à peu de distance, et en
quelques heures on peut revenir des uns aux autres pour les
comparer plus exactement, pour vérifier, modifier ou détruire
les analogies ou les différences que'l’on a cru reconnaître. Je
mets en fait qu’en parcourant ces contrées, les plus zélés neptu-
niens deviendront volcanistes, et pousseront même ces opinions
bien au-delà des bornes où je me restreindrai dans cet article :
j’en pourrais citer bien des exemples,
couices mor- Les premiers dépôts qui doivent frapper le géologue en quit-
"SVané«11 tant les coulées évidentes que nous avons décrites, sont ceux
qu’on retrouve, au fond de quelques vallées, où ils- reposent
encore sur des cailloux roulés, et àJa base desquels il existe de
petites excavations à parois scorifiées, précisément-comme dans:
les courans bien distincts- Ici il y a certainement une analogie
bien marquée et de position et de circonstances accidentelles',
et l’on doit être bien près d?admettreda-certitude d’une origine
volcanique! mais en suivant ces dépôts, on ne remonte plus1 à
la montagne dont1 ils ont' pu sortir, le courant est rompu, et
souvent même il n’y a plus de traces de scories. Ces dernières
observations modifient la certitude que sans cela on aurait dans
toute son évidence comme dans les courans précédens, et forcent
le géologue prudent à n’admettre qu’une probabilité. Mais
c’est certainement une probabilité d’un ordre très-élevé, et qui
l’est d’autant plus ici, que les observations sont faites dans une
contrée où il existe, à très-peu de distance, des coulées.incontestables.
Si on s’élève!ensuite au sommet des-montagnes, on retrouve BaiaHeen pia-
1 -| ~i /A i i • . , teaux qui sont encore, dans les depots basaltiques qu on y rencontre sous la piobabitntm
forme de plateau, des données!assez positives pour admettre coulées,
des probabilités que rien ne peut balancer. En effet, on trouve
des plateaux qui sont allongés et très-étroits., et qui, par cette
forme, rappellent les coulées évidentes qui se.trouvent au fond
des vallées. La masse basaltique repose encore sur des cailloux
roulés., ou sur des dépôts d’alluvions, ou même sur la terre
végétale, comme je liai observé au plateau de Mirabelle, dans
les Coirons. On reconnaît à la base de petites excavations à
parois scorifiées, semblables à celles que nous avons remarquées
à la jonction des courans basaltiques avec le sol des vallées - la
terre végétale , parfaitement reconnaissable par les coquilles
terrestres ( cyclostoma elegans ) et les débris de nos graminées
actuelles, se trouve calcinée dans toute l’étendue où elle est
■recouverte par le basalte. Çà e t là on rencontre aussi, à la surface
de la masse basaltique, des scories éparses, encore reconnaissables
, et dans son intérieur même, des matières poreuses,
celluleuses, très-âpres au toucher, qui ne peuvent manquer
de rappeler celles qu’on a vues dans les volcans évidens *. Comment
avec ces données, qui ne peuvent être balancées par au-
* Qu’on ne pense pas que ces matières, que je nomme seoriaee'es, sont de
la nature des parties celluleuses ou^poreuses qu’on rencontre dans les dépôts
d’amygdaloïdes; ce sont des choses que je distingue parfaitement, ce que l’on
croira d’autant mieux, ç[ue j’ài soutenu l ’origine neptunienne des amygda-
iûïdes*