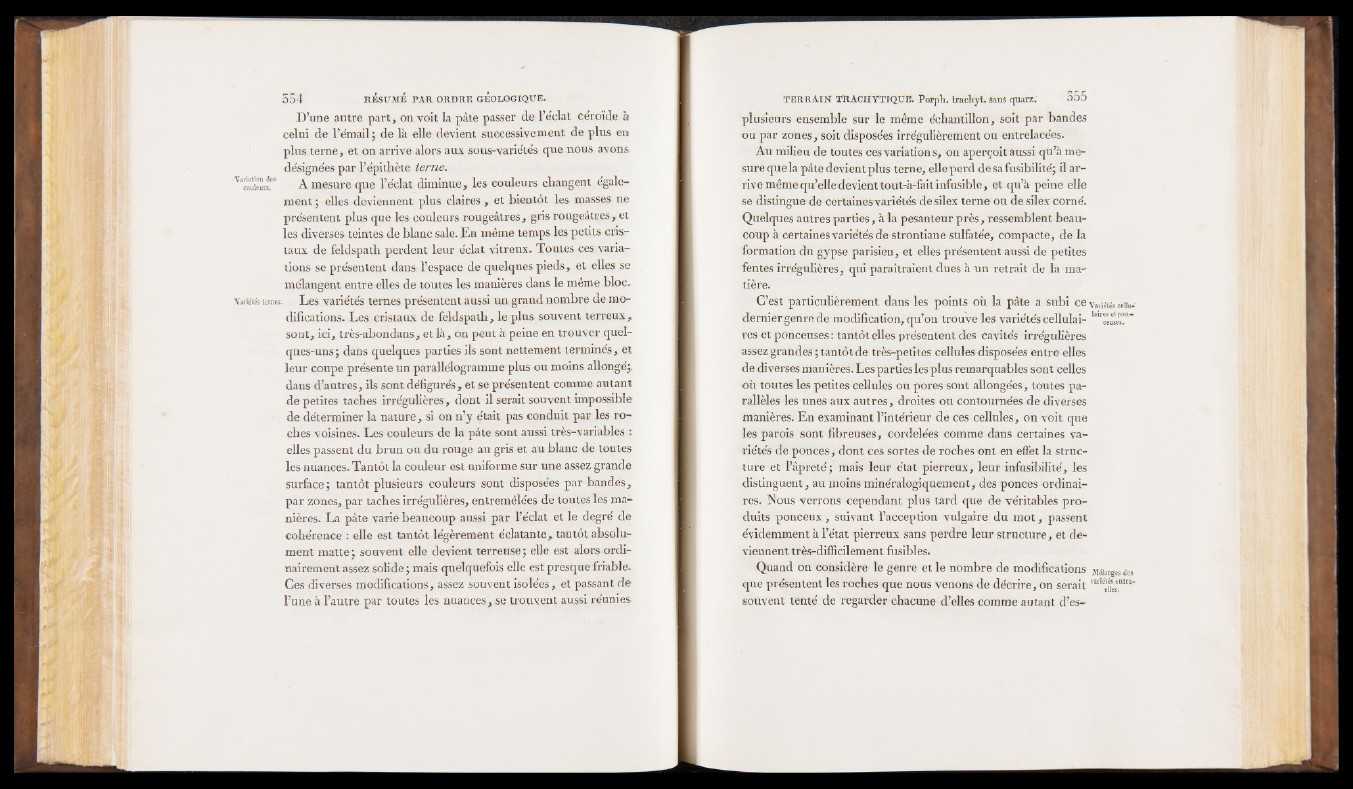
D’une autre p art, on voit la pâte passer de l’e'clat ce'roïde à
celui de l’émail ; de là elle devient successivement de plus en
plus terne, et on arrive alors aux sous-variéte's que nous avons
désignées par l’épithète terne.
Vaé o i f s A mesure que l’éclat diminue, les couleurs changent également
; elles deviennent plus claires , et bientôt les masses ne
présentent plus que les couleurs rougeâtres , gris rougeâtres, et
les diverses teintes de blanc sale. En même temps les petits cristaux
de feldspath perdent leur éclat vitreux. Toutes ces variations
se présentent dans l’espace de quelques pieds, et elles se
mélangent entre elles de toutes les manières dans le même bloc.
[Variétés ternes. Les variétés ternes présentent aussi un grand nombre de modifications.
Les cristaux de feldspath, le plus souvent terreux,
sont, ici, très-abondans, et là, on peut à peine en trouver quelques
uns ; dans quelques parties ils sont nettement terminés, et
leur coupe présente un parallélogramme plus ou moins allongé},
dans d’autres, ils sont défigurés, et se présentent comme autant
de petites taches irrégulières, dont il serait souvent impossible
de déterminer la nature, si on n’y était pas conduit par les roches
voisines. Les couleurs de la pâte sont aussi très-variables :
elles passent du brun ou du rouge au gris et au blanc de toutes
les nuances. Tantôt la couleur est uniforme sur une assez grande
surface; tantôt plusieurs couleurs sont disposées par bandes,
par zones, par taches irrégulières, entremêlées de toutes les manières.
La pâte varie beaucoup aussi par l’éclat et le degré de
cohérence : elle est tantôt légèrement éclatante, tantôt absolument
matte; souvent elle devient terreuse ; elle est alors ordinairement
assez solide ; mais quelquefois elle est presque friable.
Ces diverses modifications, assez souvent isolées, et passant de
l’une à l’autre par toutes les nuances, se trouvent aussi réunies
plusieurs ensemble sur le même échantillon, soit par bandes
ou par zones, soit disposées irrégulièrement ou entrelacées.
Au milieu de toutes ces variations, on aperçoit aussi qu’à mesure
que la pâte devient plus terne, elle perd de sa fusibilité; il arrive
même qu’elle devient tout-à-fait infusible, et qu’à peine elle
se distingue de certainesvariétés de silex terne ou de silex corné.
Quelques autres parties, à la pesanteur près, ressemblent beaucoup
à certaines variétés de strontiane sulfatée, compacte, de la
formation du gypse parisien, et elles présentent aussi de petites
fentes irrégulières, qui paraîtraient dues à un retrait de la matière.
C’est particulièrement dans les points où la pâte a subi ce VariéiË «iiu-
dernier genre de modification, qu’on trouve les variétés cellulai- | S S ""
res et ponceuses : tantôt elles présentent des cavités irrégulières
assez grandes ; tantôt de très-petites cellules disposées entre elles
de diverses manières. Les parties les plus remarquables sont celles
où toutes les petites cellules ou pores sont allongées, toutes parallèles
les unes aux autres, droites ou contournées de diverses
manières. En examinant l’intérieur de ces cellules , on voit que
les parois sont fibreuses, cordelées comme dans certaines variétés
de ponees, dont ces sortes de roches ont en effet la structure
et l’âpreté; mais leur état pierreux, leur infusibilité, les
distinguent, au moins minéralogiquement, des ponces ordinaires.
Nous verrons cependant plus tard que de véritables produits
ponceux, suivant l’acception vulgaire du m o t, passent
évidemment à l’état pierreux sans perdre leur structure, et deviennent
très-difficilement fusibles.
Quand on considère le genre et le nombre de modifications Maanges de!
que présentent les roches que nous venons de décrire, on serait ”ritË nlre"
souvent tenté de regarder chacune d’elles comme autant d’es