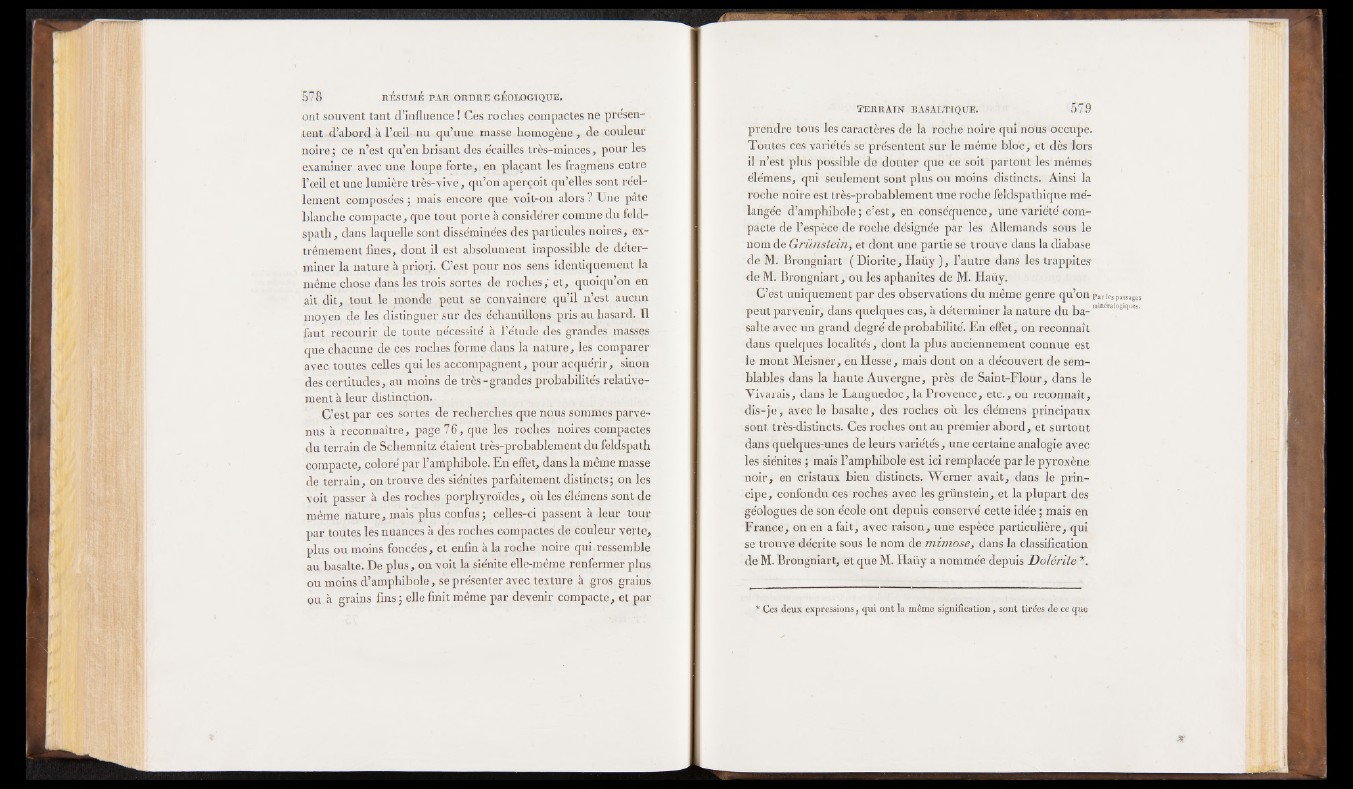
ont souvent tant d’influence ! Ces roches compactes ne présentent
d’abord à l’oeil nu qu’une masse homogène , de couleur
noire; ce n’est qu’en brisant des e'cailles très-minces, pour les
examiner avec une loupe forte,, en plaçant les fragmens entre
l’oeil et une lumière très-vive, qu’on aperçoit qu’elles sont réellement
composées ; mais encore que voit-on alors ? Une pâte
blanche compacte, que tout porte à considérer comme du feldspath,
dans laquelle sont disséminées des particules noires, extrêmement
fines, dont il est absolument impossible de déterminer
la nature à priori. C’est pour nos sens identiquement la
même chose dans les trois sortes de roches,’ e t, quoiqu’on en
ait dit, tout le monde peut se convaincre qu’il n’est aucun
moyen de les distinguer sur des échantillons pris au hasard. 11
faut recourir de toute nécessité à l’étude des grandes masses
que chacune de ces roches forme dans la nature, les comparer
avec toutes celles qui les accompagnent, pour acquérir, sinon
des certitudes, au moins de très-grandes probabilités relativement
à leur distinction.
C’est par ces sortes de recherches que nous sommes parvenus
à reconnaître, page 76, que les roches noires compactes
du terrain de Schemnitz étaient très-probablement du feldspath
compacte, coloré par l’amphibole. En effet, dans la même masse
de terrain, on trouve des siénites parfaitement distincts; on les
voit passer à des roches porphyroïdes, où les élémens sont de
même nature, mais plus confus ; celles-ci passent à leur tour
par toutes les nuances à des roches compactes de couleur verte,
plus ou moins foncées, et enfin à la roche noire qui.ressemble
au basalte. De plus, on voit la siénite elle-même renfermer plus
ou moins d’amphibole , se présenter avec texture à gros grains
ou à grains fins; elle finit même par devenir compacte, et par
prendre tous les caractères de la roche noire qui nous occupe.
Toutes ces variétés se présentent sur le même bloc, et dès lors
il n’est plus possible de douter que ce soit partout les mêmes
élémens, qui seulement sont plus ou moins distincts. Ainsi la
roche noire est très-probablement une roche feldspathique mélangée
d’amphibole; c’est, en conséquence, une variété compacte
de l’espèce de roche désignée par les Allemands sous le
nom de Grüristein, et dont une partie se trouve dans la diabase
de M. Brongniart ( Diorite, Haüy ), l’autre dans les trappites
de M. Brongniart, ou les aphanites de M. Haüy.
C’est uniquement par des observations du même genre qu’on parie»passa6es
peut parvenir, dans quelques cas, à déterminer la nature du ba- ““ ra °6",ues'
salte avec un grand degré de probabilité. En effet, on reconnaît
dans quelques localités, dont la plus anciennement connue est
le mont Meisner, en Hesse, mais dont on a découvert de semblables
dans la haute Auvergne, près de Saint-Flour, dans le
Vivarais, dans le Languedoc, la Provence, etc., on reconnaît,
dis-je, ayec le basalte, des roches où les élémens principaux
sont très-distincts. Ces roches ont au premier abord, et surtout
dans quelques-unes de leurs variétés, une certaine analogie avec
les siénites ; mais l’amphibole est ici remplacée par le pyroxène
noir, en cristaux bien distincts. Werner avait, dans le principe,
confondu ces roches avec les grünstein, et la plupart des
géologues de son école ont depuis conservé cette idée; mais en
France, on en a fait, avec raison, une espèce particulière, qui
se trouve décrite sous le nom de mimose, dans la classification
de M. Brongniart, et que M. Haüy a nommée depuis D olérite *,
* Çes deux expressions ; qui ont la même signification, sont tirées de ce que
AT