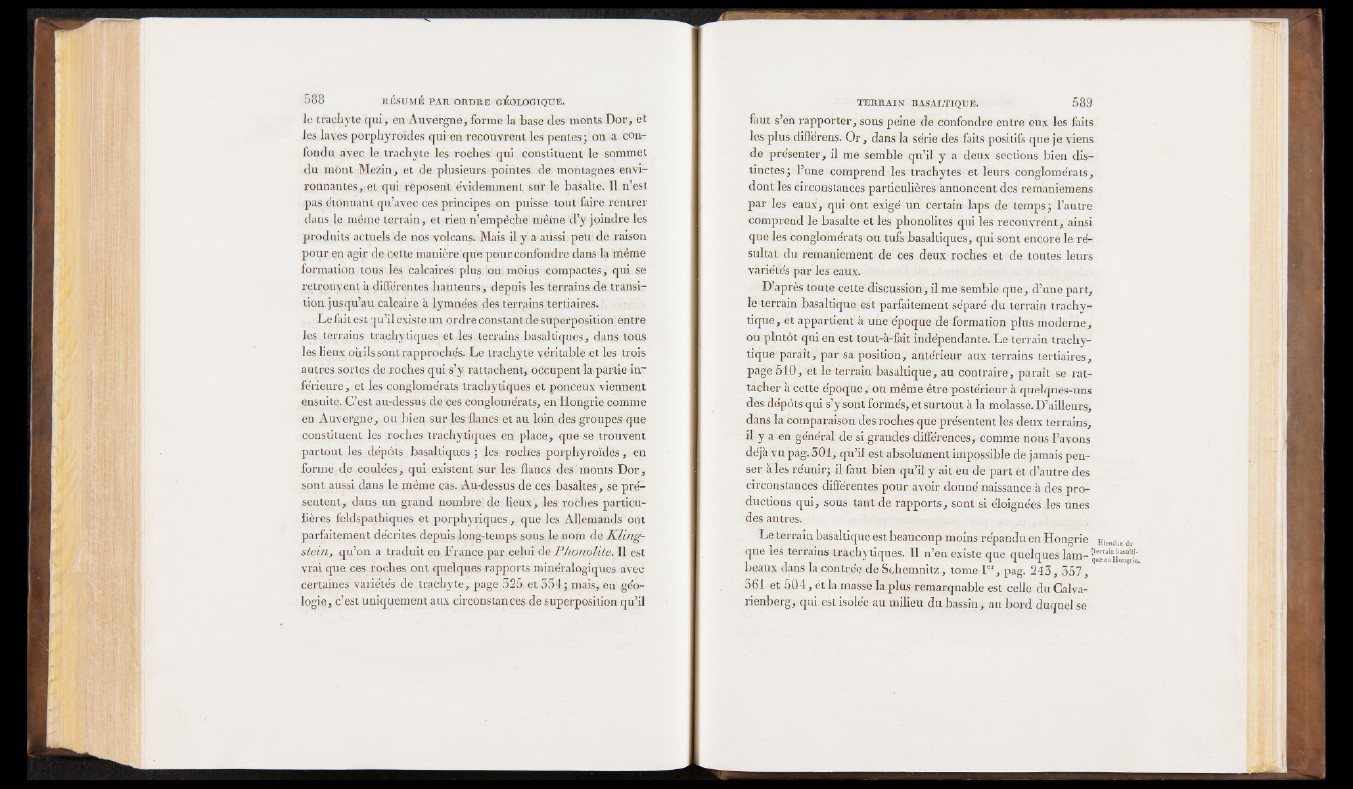
le trachyte qui, en Auvergne, forme la base des monts Dor, et
les laves porphyroïdes qui en recouvrent les pentes;: on a confondu
avec le trachyte les roches qui constituent le sommet
du mont Mezin, et de plusieurs, pointes, de montagnes environnantes,
et qui reposent évidemment sur le basalte. Il n’est
pas étonnant qu’avec ces principes on puisse tout faire rentrer
dans le même terrain, et rien n’empêçhe même d’y joindre les
produits actuels de nos volcans. Mais il y a aiissi peu dè raison
pour en agir de cette manière que pour confondre dans la même
formation tous les calcaires plus ou moins compactés, qui se
retrouvent à différentes hauteurs, depuis les terrains dé transition
jusqu’au calcaire à lymnées des tèrrains'tertiaires. :
Lefaitest qu’il existe un ordre constant de superposition entre
les terrains trachytiques et lès terrains basaltiques, dans tous
les lieux ou ils sont rapprochés. Le trachyte véritable et les trois
autres sortes de roches qui s’y rattachent, occupent la,partie inférieure,
et les conglomérats trachytiques et ponceux viennent
ensuite. C’est au-dessus de ces conglomérats, en Hongrie comme
en Auvergne, ou bien sur les flancs: et au loin des groupes que
constituent les roches trachytiques en place, que se trouvent
partout les dépôts basaltiques ; les; roches porphyroïdes, en
forme de coulées, qui:existent'sur les flancs des monts Dor,
sont aussi dans le même cas. Au-dessus de ces basaltes, se présentent,
dans un grand nombre de lieux, les roches particulières
feldspathiques et porphyriques , que les Allemands ont
parfaitement décrites depuis long-temps sous le nom de K ling-
stein , qu’on a traduit en, France par celui de Phonolite. Il est
vrai que ces roches ont quelques rapports minéralogiques avec
certaines variétés de trachyte, page 325 et 534; mais, en géologie,
c’est uniquement aux circonstan ces de superposition qu’il
faut s’en rapporter, sous peine de confondre entre eux les faits
les plus différens. O r, dans la série des faits positifs que je viens
de présenter, il me semble qu’il y a deux sections bien distinctes;
l’une comprend les trachÿtes et leurs conglomérats,
dont les circonstances particulières annoncent des remaniemens
par les eaux, qui ont exigé un certain laps de temps; l’autre
comprend le basalte et les phonolites qui les recouvrent, ainsi
que les conglomérats ou tufs basaltiques, qui sont encore le résultat
du remaniement de ces deux roches et de toutes leurs
variétés par les eaux.
D’après toute cette discussion, il mesemble que, d’une part,
le terrain basaltique est parfaitement séparé du terrain trachy-
tique, et appartient à une époque de formation plus moderne,
ou plutôt qui en est tout-à-fait indépendante. Le terrain trachy-
tique paraît, par sa position, antérieur aux terrains tertiaires,
page 510, et le terrain basaltique, au contraire, paraît se rattacher
à cette époque, ou même être postérieur à quelques-uns
des dépôts qui s’ÿsont formés, et surtout à la molasse. D’ailleurs,
dans la comparaison des roches que présentent les deux terrains,
il y a en général de si grandes différences, comme nous l’avons
déjà vu pag. 301, qu’il est absolument impossible de jamais penser
à les réunir; il faut bien qu’il y ait eu de part et d’autre des
circonstances différentes pour avoir donné naissance à des productions
qui, sous tant de rapports, sont si éloignées les unes
des autres.
Le terrain basaltique est beaucoup moins répandu en Hongrie Eicndu« du
que lés terrains trachytiques. Il n’en existe que quelques lam- qu"™Honpje
beaux dans la contrée de Schemnitz, tome Ier, pag. 243, 357,
361 et 504, ét la masse la plus remarquable est celle du Calva-
rienberg, qui est isolée au milieu du bassin , au bord duquel se