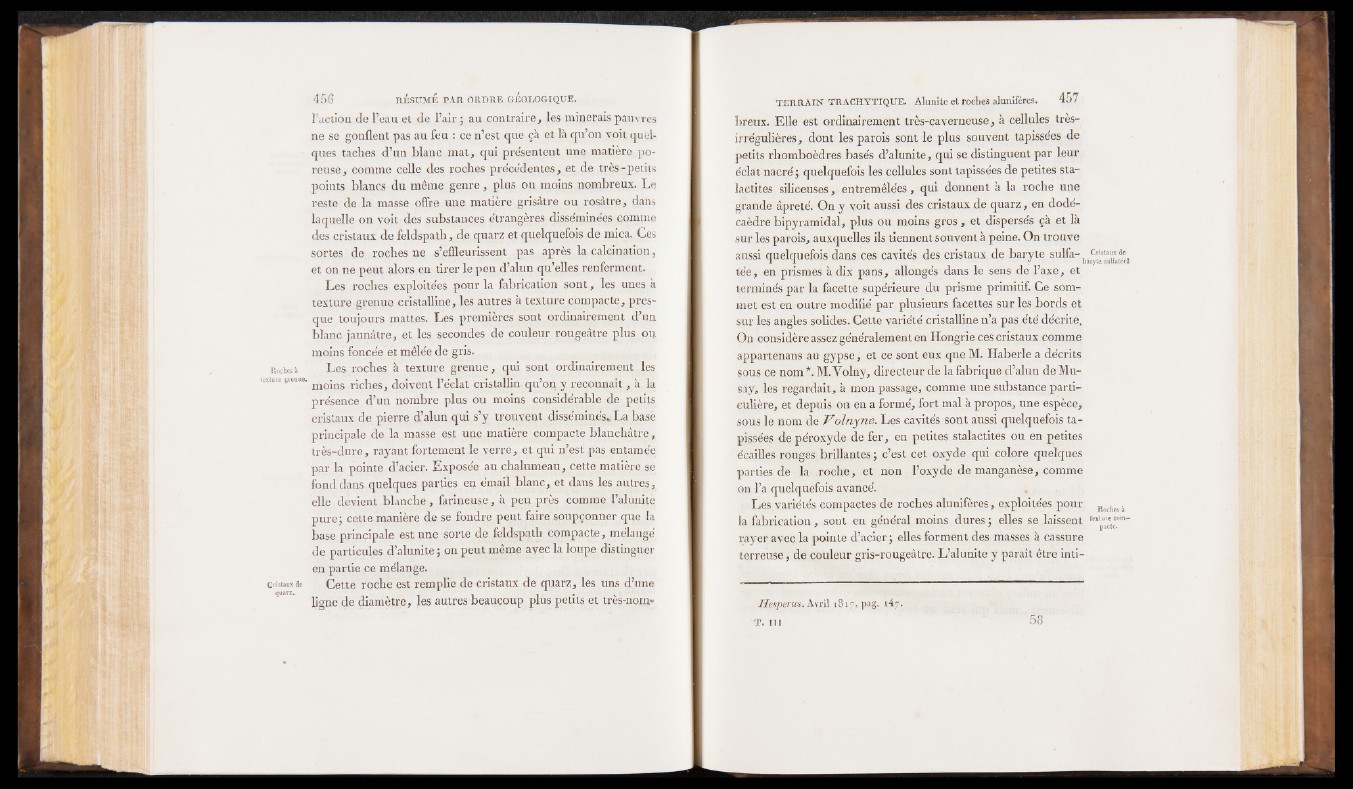
Roches à
xture grenue.
Cristaux de
quarz.
l’action de l’eau et de l’air ; au contraire, les minerais pauvres
ne se gonflent pas au feu : ce n’est que ça et là qu’on voit quelques
taches d’un blanc mat, qui présentent une matière poreuse,
comme celle des roches précédentes, et de très-petits
points blancs du même genre, plus ou moins nombreux. Le
reste de la masse offre une matière grisâtre ou rosâtre, dans
laquelle on voit des substances étrangères disséminées comme
des cristaux de feldspath, de quarz et quelquefois de mica. Ces
sortes de roches ne s’effleurissent pas après la calcination,
et on ne peut alors en tirer le peu d’alun qu’elles renferment.
Les roches exploitées pour la fabrication so n t, les unes à
texture grenue cristalline, les autres à texture compacte, presque
toujours mattes. Les premières sont ordinairement d’un
blanc jaunâtre, et les secondes de couleur rougeâtre plus ou
moins foncée et mêlée de gris.
Les roches à texture grenue, qui sont ordinairement les
moins riches, doivent l’éclat cristallin qu’on y reconnaît, à la
présence d’un nombre plus ou moins considérable de petits
cristaux de pierre d’alun qui s’y trouvent disséminés. La basé
principale de la masse est une matière compacte blanchâtre,
très-dure, rayant fortement le verre, et qui n’est pas entamée
par la pointe d’acier. Exposée au chalumeau, cette matière se
fond dans quelques parties ep émail blanc, et dans les autres,
elle devient blanche, farineuse, à peu près comme l’alunite
pure; cette manière de se fondre peut faire soupçonner que la
base principale est une sorte de feldspath compacte, mélangé
de particules d’alunite ; on peut même avec la loupe distinguer
en partie ce mélange.
Cette roche est remplie de cristaux de quarz, les uns d’une
ligne de diamètre, les autres beaucoup plus petits et très-nom*
TERRAIN TRACHTTIQUE. Alunite et roches alunifères. 457
breux. Elle est ordinairement très-caverneuse, à cellules très-
irrégulières , dont les parois sont le plus souvent tapissées de
petits rhomboèdres basés d’alunite, qui se distinguent par leur
éclat nacré ; quelquefois les cellules sont tapissées de petites stalactites
siliceuses, entremêlées, qui donnent à la roche une
grande âpreté. On y voit aussi des cristaux de quarz, en dodécaèdre
bipyramidal, plus ou moins gros, et dispersés çà et là
sur les parois, auxquelles ils tiennent souvent à peine. On trouve
aussi quelquefois dans ces cavités des cristaux de baryte
tée, en prismes à dix pans, allongés dans le sens de l’axe, et
terminés par la facette supérieure du prisme primitif. Ce sommet
est en outre modilié par plusieurs facettes sur les bords et
sur les angles solides. Cette variété cristalline n’a pas été décrite.
On considère assez généralement en Hongrie ces cristaux comme
appartenans au gypse, et ce sont eux que M. Haberle a décrits
sous ce nom*. M.Volny, directeur de la fabrique d’alun deMu-
sày, les regardait, à mon passage, comme une substance particulière,
et depuis on en a formé, fort mal à propos, une espèce,
sous le nom de Volnyne. Les cavités sont aussi quelquefois tapissées
de pe'roxyde de fer, en petites stalactites ou en petites
écailles rouges brillantes ; c’est cet oxyde qui colore quelques
parties de la roche, et non l’oxyde de manganèse, comme
on l’a quelquefois avancé.
Les variétés compactes de roches alunifères, exploitées pour BoctltsJ
la fabrication , sont en général moins dures ; elles se laissent texl“j '“m"
rayer avec la pointe d’acier ; elles forment des masses à cassure
terreuse, de couleur gris-rougeâtre. L’alunite y paraît être inti-
H e s p e r u s . Avril 1817, pag.