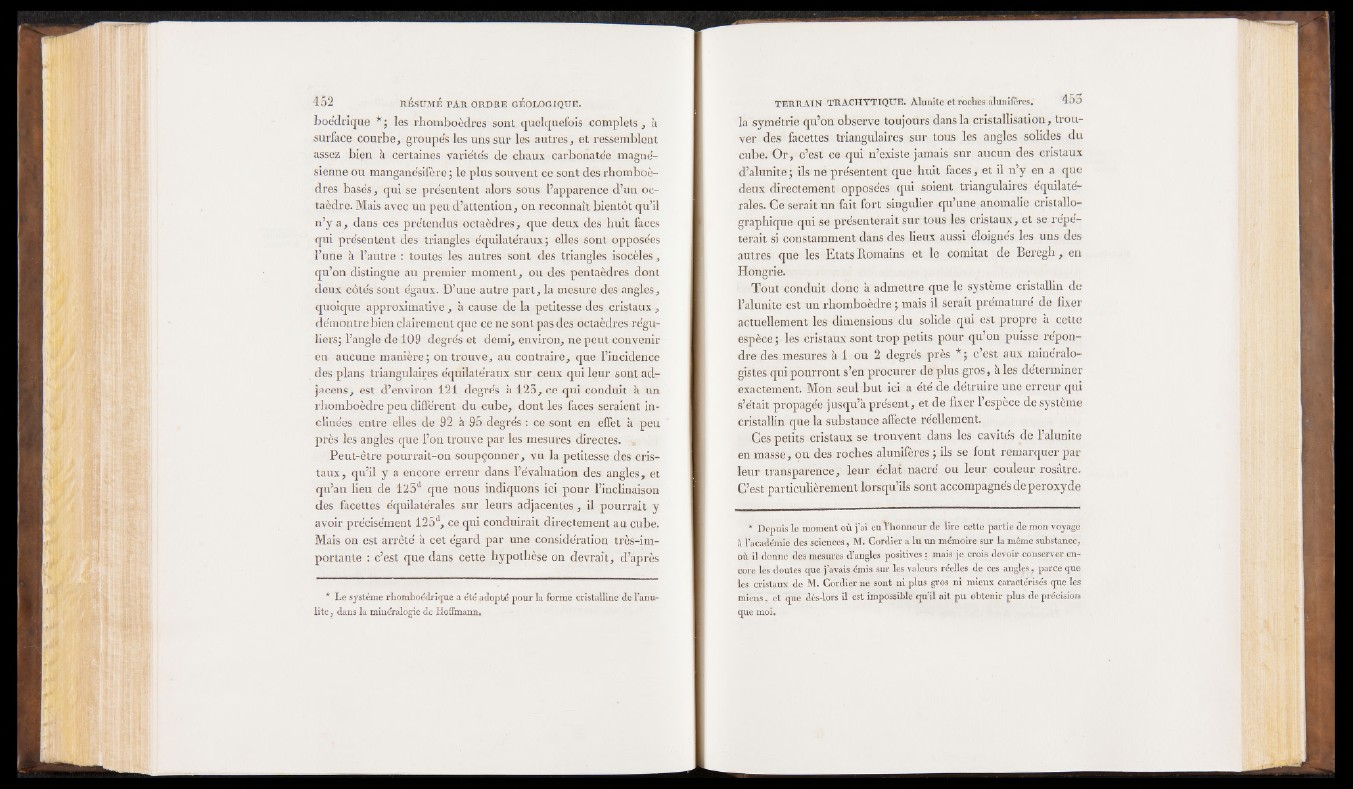
boédrique *; les rhomboèdres sont quelquefois complets , à
surface courbe, groupe's les uns sur les autres, et ressemblent
assez bien à certaines varie'te's de chaux carbonatée magnésienne
ou manganésifère ; le plus souvent ce sont des rhomboèdres
basés, qui se présentent alors sous l’apparence d’un octaèdre.
Mais avec un peu d’attention, on reconnaît bientôt qu’il
n’y a , dans ces prétendus octaèdres, que deux des huit faces
qui présentent des triangles équilatéraux; elles sont opposées
l’une à l’autre : toutes les autres sont des triangles isocèles,
qu’on distingue au premier moment, ou des pentaèdres dont
deux côtés sont égaux. D’une autre p art, la mesure des angles,
quoique approximative , à cause de la petitesse des cristaux ,
démontre bien clairement que ce ne sont pas des octaèdres réguliers;
l’angle de 109 degrés et demi, environ, ne peut convenir
en aucune manière; on trouve, au contraire, que l’incidence
des plans triangulaires équilatéraux sur ceux qui leur sont ad-
jacens, est d’environ 121 degrés k 123, ce qui conduit à un
rhomboèdre peu différent du cube, dont les faces seraient inclinées
entre elles de 92 k 95 degrés : ce sont en effet k peu
près les angles que l’on trouve par les mesures directes. „
Peut-être pourrait-on soupçonner, vu la petitesse des cristaux,
qu’il y a encore erreur dans l’évaluation des angles, et
qu’au lieu de 123d que nous indiquons ici pour l’inclinaison
des facettes équilatérales sur leurs adjacentes, il pourrait y
avoir précisément 125 , ce qui conduirait directement au cube.
Mais on est arrêté k cet égard par une considération très-importante
: c’est que dans cette hypothèse on devrait, d’après
* Le système rhomboédrique a été adopté pour la forme cristalline de l’anu-
lite, dans la minéralogie de Hoffmann*
TERRAIN TRACHYTIQUE. Alunite et roches àluniféres. 4 5 3
la symétrie qu’on observe toujours dans la cristallisation, trouver
des facettes triangulaires sur tous les angles solides du
cube. O r, c’est ce qui n’existe jamais sur aucun des cristaux
d’alunite; ils ne présentent que huit faces, et il n’y en a que
deux directement opposées qui soient triangulaires équilatérales.
Ce serait un fait fort singulier qu’une anomalie cristallographique
qui se présenterait sur tous les cristaux, et se répéterait
si constamment dans des lieux aussi éloignés les uns des
autres que les Etats Romains et le comitat de Beregh, en
Hongrie.
Tout conduit donc k admettre que le système cristallin de
l’alunite est un rhomboèdre ; mais il serait prématuré de fixer
actuellement les dimensions du solide qui est propre k cette
espèce ; les cristaux sont trop petits pour qu’on puisse répondre
des.mesures k 1 ou 2 degrés près *; c’est aux minéralogistes
qui pourront s’en procurer de plus gros, k les déterminer
exactement. Mon seul but ici a été de détruire une erreur qui
s’était propagée jusqu’à présent, et de fixer l’espèce de système
cristallin que la substance affecte réellement.
Ces petits cristaux se trouvent dans les cavités de l’alunite
en masse, ou des roches aluniferes ; ils se font remarquer par
leur transparence, leur éclat nacré ou leur couleur rosâtre.
C’est particulièrement lorsqu’ils sont accompagnés de peroxyde
* Depuis le moment où j’ai eu l’honneur de lire cette partie de mon voyage
à l’académie des sciences, M. Cordier a lu un mémoire sur la même substance,
où il donne des mesures d’angles positives ; mais je crois devoir conserver encore
les doutes que j’avais émis sur les valeurs réelles de ces angles, parce que
les cristaux de M. Cordier ne sont ni plus gros ni mieux caractérisés que les
miens, et que dès-lors il est impossible qu’il ait pu obtenir plus de précision
que moi*