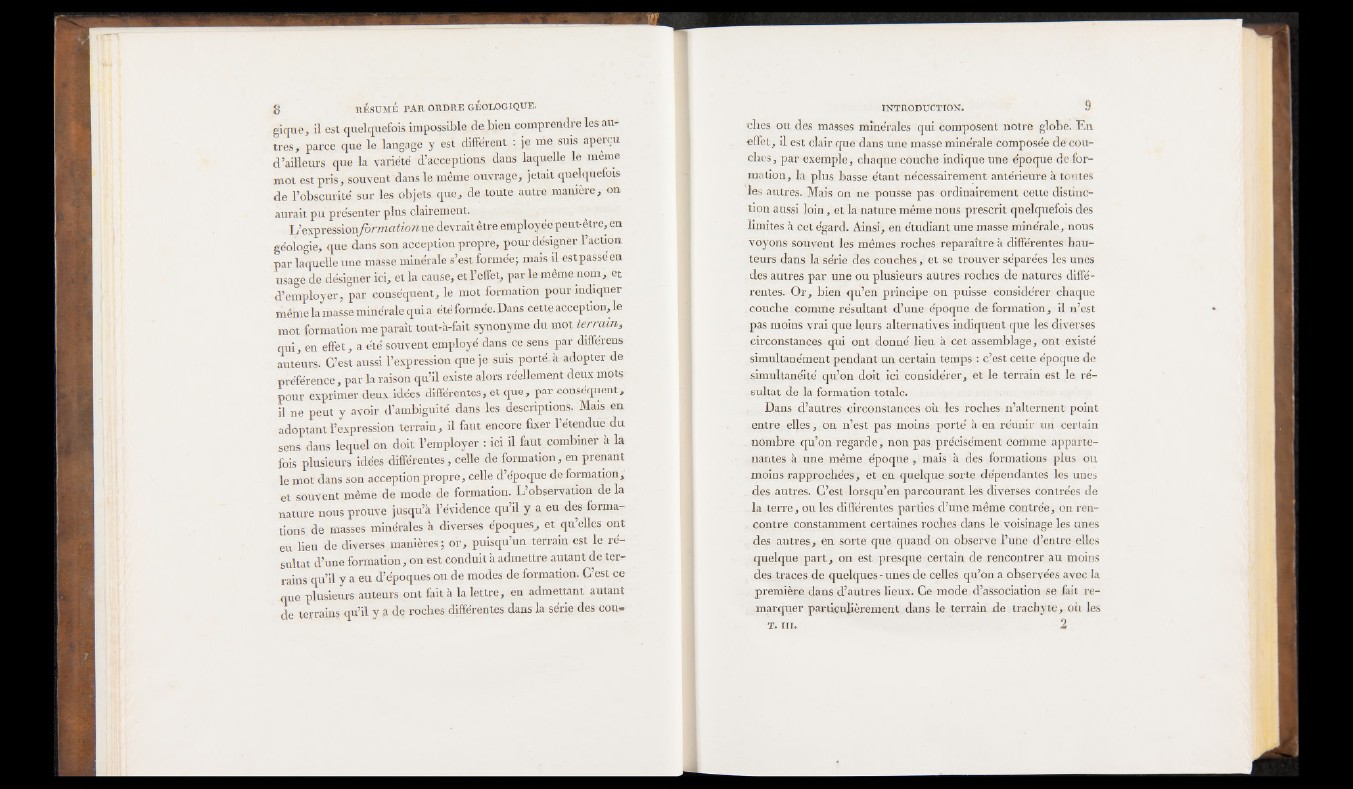
gique, il est quelquefois impossible de bien comprendre les autres,
parce que le langage y est différent : je me suis aperçu
d ’ailleurs que la variété d’acceptions dans laquelle le même
mot est pris, souvent dans le même ouvrage, jetait quelquefois
de l’obscurité sur les objets que, de toute autre manière, on
aurait pu présenter plus clairement. |
L’expressionformation ne devrait être employée peut-être, en
géologie, que dans son acception propre, pour désigner Faction
par laquelle une masse minérale s’est formée; mais il est passé en
usage de désigner ici, et la cause, et l’effet, par le même nom, et
d’employer, par conséquent, le mot formation pour indiquer
même la masse minérale qui a été formée. Dans cette acception, le
mot formation me paraît tout-à-fait synonyme du mot terrain,
qui, en effet, a été souvent employé dans ce sens par différens
auteurs. C’est aussi l’expression que je suis porté.à adopter de
préférence, par la raison qu’il existe alors réellement deux mots
pour exprimer deux idées différentes, et que, par conséquent,
il ne peut y avoir d’ambiguité dans les descriptions. Mais en
adoptant l’expression terrain, il faut encore fixer l’étendue du
sens dans lequel on doit l’employer : ici il faut combiner à la
fois plusieurs idées différentes, celle de formation, en prenant
le mot dans son acception propre, celle d’époque de formation,
et souvent même de mode de formation. L’observation de la
nature nous prouve jusqu’à l’évidence qu’il y a eu des formations
de masses minérales à diverses époques,, et qu elles ont
eu lieu de diverses.manières; o r, puisqu’un terrain est le résultat
d’une formation, on est conduit à admettre autant de terrains
qu’il y a eu d’époques ou de modes de formation. C’est ce
que plusieurs auteurs ont fait à la lettre, en admettant autant
de terrains qu’il y a de roches différentes dans la série des couelles
ou des masses minérales qui composent notre globe. En
effet, il est clair que dans une masse minérale composée de couches
, par exemple, chaque couche indique une époque de formation
, la plus basse étant nécessairement antérieure à toutes
les autres. Mais on ne pousse pas ordinairement cette distinction
aussi loin, et la nature même nous prescrit quelquefois des
limites à cet égard. Ainsi, en étudiant une masse minérale, nous
voyons souvent les mêmes roches reparaître à différentes hauteurs
dans la série des couches, et se trouver séparées les unes
des autres par une ou plusieurs autres roches de natures différentes.
O r, bien qu’en principe on puisse considérer chaque
couche comme résultant d’une époque de formation, il n’est
pas moins vrai que leurs alternatives indiquent que les diverses
circonstances qui ont donné lieu à cet assemblage, ont existé
simultanément pendant un certain temps : c’est cette époque de
, simultanéité qu’on doit ici considérer, et le terrain est le résultat
de la formation totale.
Dans d’autres circonstances où les roches n’alternent point
entre elles, on n’est pas moins porté à en réunir un certain
nombre qu’on regarde, non pas précisément comme appartenantes
à une même époque , mais à des formations plus ou
moins rapprochées, et en quelque sorte dépendantes les unes
des autres. C’est lorsqu’en parcourant les diverses contrées de
la terre, ou les différentes parties d’une même contrée, on rencontre
constamment certaines roches dans le voisinage les unes
des autres, en sorte que quand on observe l’une d’entre elles
quelque p art, on est presque certain de rencontrer au moins
des traces de quelques-unes de celles qu’on a observées avec la
première dans d’autres lieux. Ce mode d’association se fait remarquer
particulièrement dans le terrain aie trachyte, où les
T. III. 2