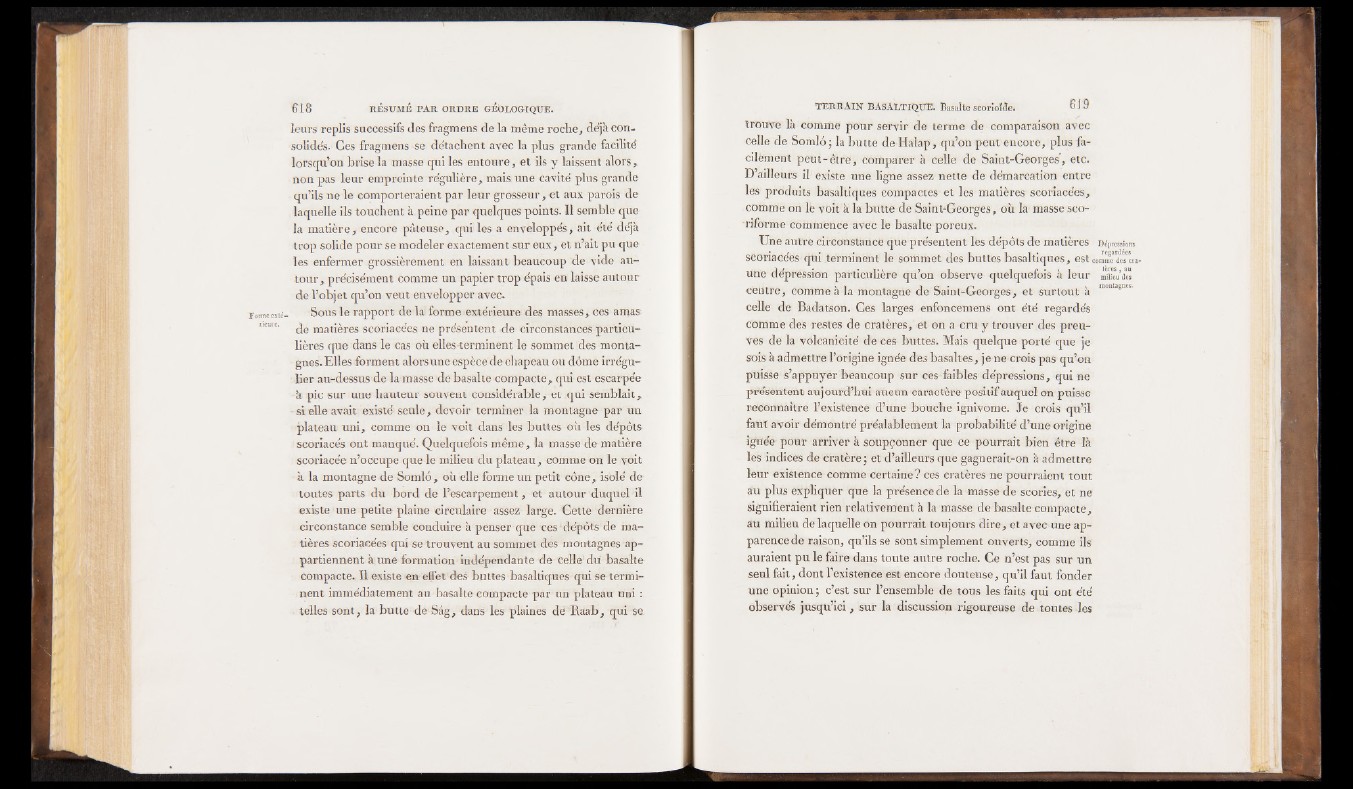
Tonne extérieure.
leurs replis successifs des fragmens de la même roche, déjà consolides.
Ces fragmens se de'tachent avec la plus grande facilité
lorsqu’on brise la masse qui les entoure, et ils y laissent alors ,
non pas leur empreinte régulière, mais une cavité plus grande
qu’ils ne le comporteraient par leur grosseur, et aux parois de
laquelle ils touchent à. peine par quelques points. 11 semble que
la matière, encore pâteuse, qui les a enveloppés, ait été déjà
trop solide pour se modeler exactement sur eux, et n’ait pu que
les enfermer grossièrement en laissant beaucoup de vide autour,
précisément comme un papier trop épais en laisse autour
de l’objet qu’on veut envelopper avec.
Sous le rapport de la forme extérieure des masses, ces amas
de matières scoriacées ne présentent .de circonstances particulières
que dans le cas où elles-terminent le sommet des montagnes.
Elles forment alors une espèce de chapeau ou dôme irrégulier
au-dessus de la masse de basalte compacte, qui est escarpée
à pic sur une hauteur souvent considérable, et qui semblait,
- si elle avait existé seule, devoir terminer la montagne par un
plateau uni, comme on le voit dans les buttes où les dépôts
scoriacés, ont manqué. Quelquefois même, la masse de matière
scoriacée n’occupe que le milieu du plateau, comme on le voit
à la montagne de Somlô , où elle forme un petit cône , isolé de
toutes parts du bord de l’escarpement, et autour duquel il
existe une petite plaine circulaire assez large. Cette dernière
circonstance semble conduire à penser que ces‘dépôts de matières
scoriacées qui se trouvent au sommet des montagnes appartiennent
à; une formation indépendante de celle’ dit basalte
compacte. Il existe en effet des buttes basaltiques qui se terminent
immédiatement au basalte compacte par un plateau uni :
telles sont, la butte de Sâg, dans les plaines de Raab, qui se
trouve là comme pour servir de terme de comparaison avec
celle de Somlô ; la butte de Halap, qu’on peut encore, plus facilement
peut-être, comparer à celle de Saint-Georges’, etc.
D’ailleurs il existe une ligne assez nette de démarcation entre
les produits basaltiques compactes et les matières scoriacées,
comme on le voit à la butte de Saint-Georges, où la masse sco-
riforme commence avec le basalte poreux.
Une autre circonstance que présentent les dépôts de matières Durassions
scoriacées qui terminent le sommet des buttes basaltiques, est commedes'era-
une dépression particulière qu’on observe quelquefois à leur m£de°
centre, comme à la montagne de Saint-Georges, et surtout à
celle de Badatson. Ges larges enfoncemens ont été regardés
comme des restes de cratères, et on a cru y trouver des preuves
de la volcanicité de ces buttes. Mais quelque porté que je
sois à admettre l’origine ignée des basaltes, je ne crois pas qu’on
puisse s’appuyer beaucoup sur ces faibles dépressions, qui ne
présentent aujourd’hui aucun caractère positif auquel on puisse
reconnaître l’existence d’une bouche ignivome. Je crois qu’il
faut avoir démontré préalablement la probabilité’d’une origine
ignée pour arriver à soupçonner que ce pourrait bien être là
les indices de cratère ; et d’ailleurs que gagnerait-on à admettre
leur existence comme certaine ? ees cratères ne pourraient tout
au plus expliquer que la présence de la masse de scories, et ne
signifieraient rien relativement à la masse de basalte compacte,
au milieu de laquelle on pourrait toujours dire, et avec une apparence
de raison, qu’ils se sont simplement ouverts, comme ils
auraient pu le faire dans toute autre roche. Ce n’est pas sur un
seul fait, dont l’existence est encore douteuse, qu’il faut fonder
une opinion ; c’est sur l’ensemble de tous les faits qui ont été
observés jusqu’ic i, sur la discussion rigoureuse de toutes les