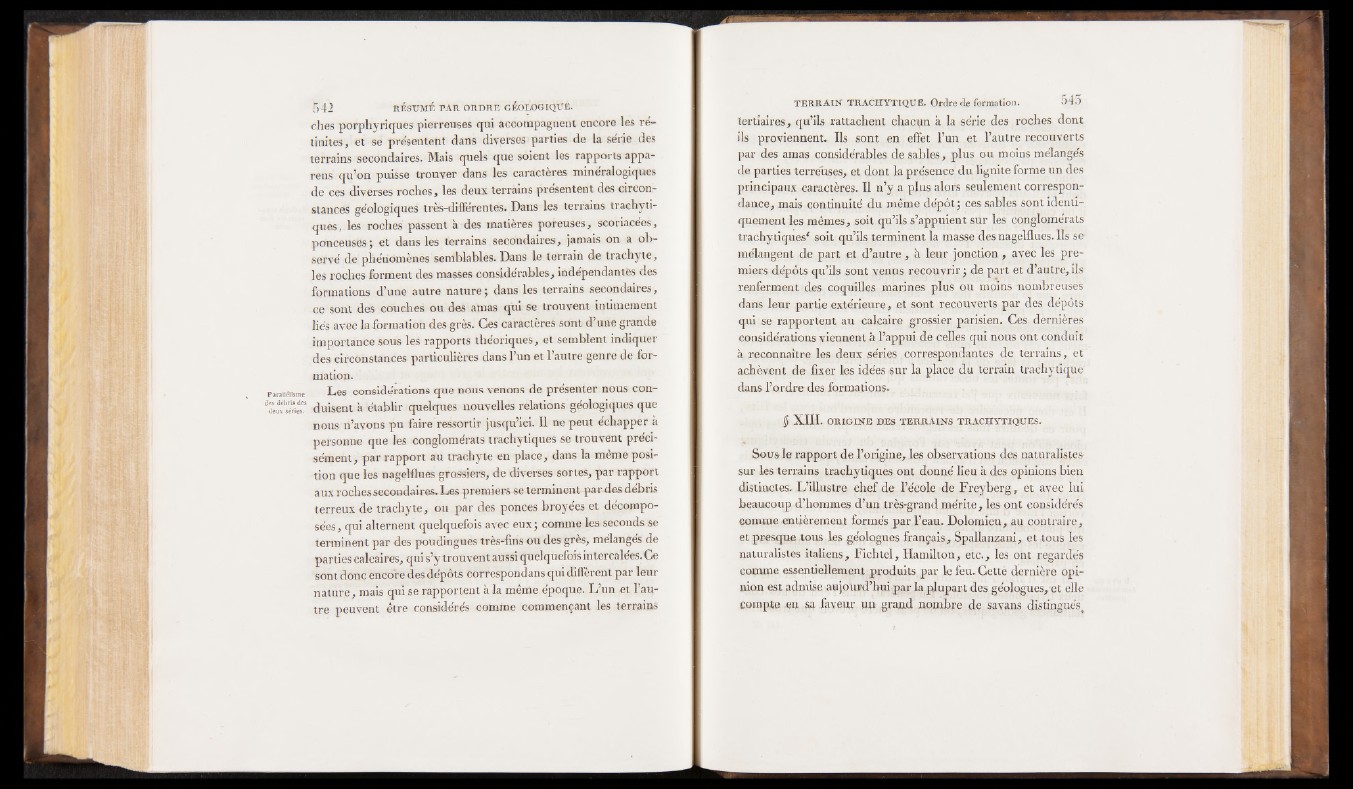
Parallélisme
des débris des
deux séries.
5 41 R É SU M É P A R O R D R E GÉO LO G IQ U Ê .
ches porphyriques pierreuses qui accompagnent encore les réduites,
et se présentent dans diverses parties de la sérié des
terrains secondaires. Mais quels que soient les rapports appareils
qu’on puisse trouver dans les caractères minéralogiques
de ces diverses roches, les deux terrains présentent des circonstances
géologiques très-différentes. Dans les terrains trachytiques
, les roches passent à des matières poreuses, scoriacées,
ponceuses ; et dans les terrains secondaires, jamais on a observé
de phénomènes semblables. Dans le terrain de trachyte,
les roches forment des masses considérables, indépendantes des
formations d’une autre nature; dans les terrains secondaires,
ce sont des couches ou des amas qui se trouvent intimement
liés avec la formation des grès. Ces caractères sont d’une grande
importance sous les rapports théoriques, et semblent indiquer
des circonstances particulières dans l’un et l’autre genre de formation.
Les considérations que nous venons de présenter nous conduisent
à établir quelques nouvelles relations géologiques que
nous n’avons pu faire ressortir jusqu’ici. Il ne peut échapper à
personne que les conglomérats trachytiques se trouvent précisément,
par rapport au trachyte en place, dans la même position
que les nagelflues grossiers, de diverses sortes, par rapport
aux roches secondaires. Les premiers se terminent par des débris
terreux de trachyte, ou par des ponces broyées et décomposées,
qui alternent quelquefois avec eux; comme les seconds se
terminent par des poudingues très-fms ou des grès, mélangés de
parties calcaires, qui s’y trouvent aussi quelquefois intercalées. Ce
sont donc encore des dépôts correspondans qui diffèrent par leur
nature, mais qui se rapportent à la même époque. L’un et l’autre
peuvent être considérés comme commençant les terrains
tertiaires, qu’ils rattachent chacun à la série des roches dont
ils proviennent. Ils sont en effet l’un et l’autre recouverts
par des amas considérables de sables, plus ou moins mélangés
de parties terreuses, et dont la présence du lignite forme un des
principaux caractères. Il n’y a plus alors seulement correspondance,
mais continuité du même dépôt ; ces sables sont identiquement
les mêmes, soit qu’ils s’appuient sur les conglomérats
trachytiques' soit qu’ils terminent la masse des nagelflues. Ils se
mélangent de part et d’autre , à leur jonction , avec les premiers
dépôts qu’ils sont venus recouvrir ; de part et d’autre, ils
renferment des coquilles marines plus ou moins nombreuses
dans leur partie extérieure, et sont recouverts par des dépôts
qui se rapportent au calcaire grossier parisien. Ces dernières
considérations viennent a l ’appui de celles qui nous ont conduit
à reconnaître les deux séries . correspondantes de terrains, et
achèvent de fixer les idées sur la place du terrain traehytîqüe
dans l’ordre des formations.
§ XIII. O R IG IN E D ES T E R R A IN S T R A C H Y T IQ U E S .
Sous le rapport de l’origine, les observations des naturalistes
sur les terrains trachytiques ont donné lieu à des opinions bien
distinctes. L’illustre chef de l’école de Freyberg, et avec lui
beaucoup d’hommes d’un très-grand mérite, les ont considérés
comme entièrement formés par l’eau. Dolomieu, au contraire,
et presque tous les géologues français,,Spallanzani, et tous les
naturalistes italiens, Fichtel, Hamilton, etc., les ont regardés
comme essentiellement produits par le feu.Cettè dernière opinion
est admise aujourd’hui par la plupart des géologues, et elle
compte en sa faveur un grand nombre de savans distingués