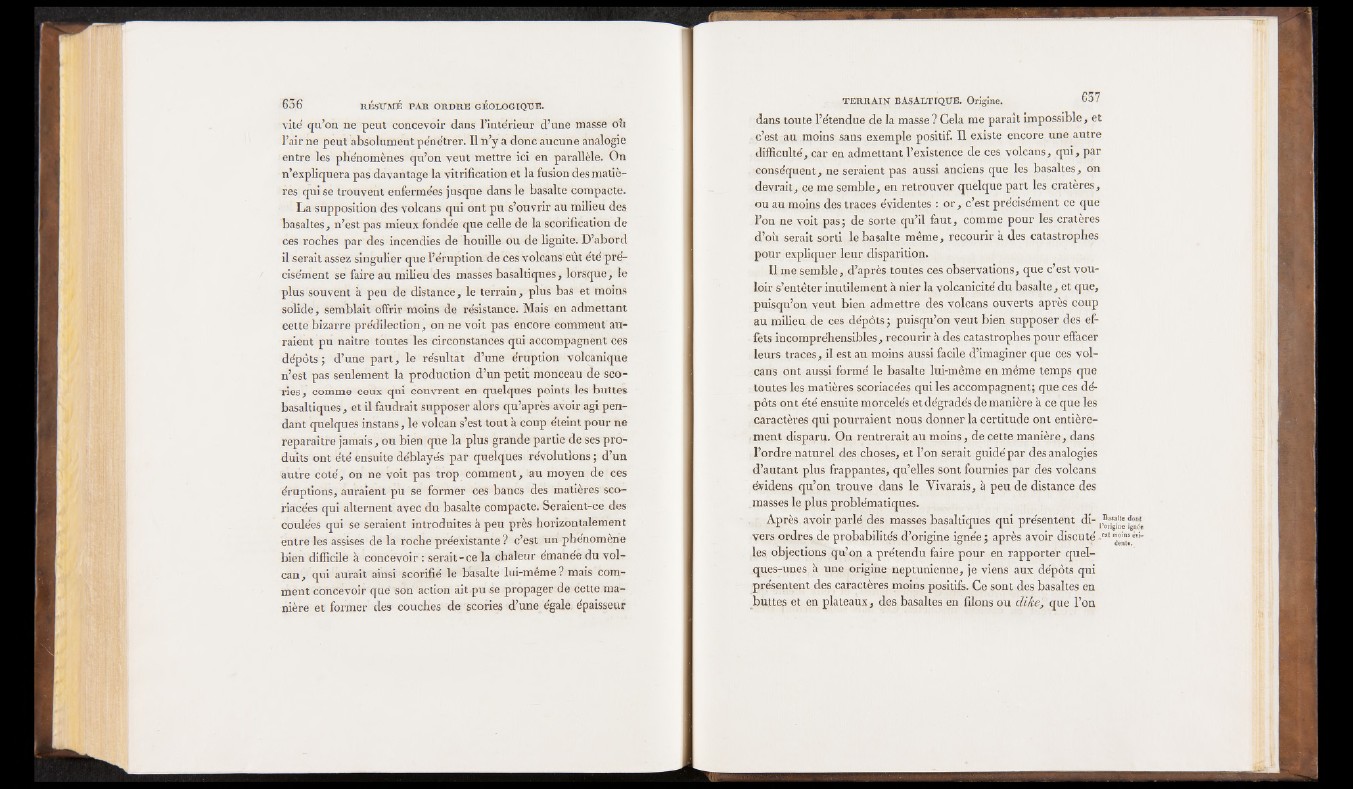
vite qu’on ne peut concevoir dans l’inte'rieur d’une masse oit
l’air ne peut absolument pe'ne'trer. Il n’y a donc aucune analogie
entre les phénomènes qu’on veut mettre ici en parallèle. On
n’expliquera pas davantage la vitrification et la fusion des matières
qui se trouvent enfermées jusque dans le basalte compacte.
La supposition des volcans qui ont pu s’ouvrir au milieu des
basaltes, n’est pas mieux fondée que celle de la scorification de
ces roches par des incendies de houille ou de lignite. D’abord
il serait assez singulier que l’éruption de ces volcans'eût été précisément
se faire au milieu des masses basaltiques , lorsque, le
plus souvent à peu de distance, le terrain, plus bas et moins
solide, semblait offrir moins de résistance. Mais en admettant
cette bizarre prédilection, on ne voit pas encore comment auraient
pu naître toutes les circonstances qui accompagnent ces
dépôts; d’une p art, le résultat d’une éruption volcanique
n’est pas seulement la production d’un petit monceau de scories,
comme ceux qui couvrent en quelques points les buttes
basaltiques, et il faudrait supposer alors qu’après avoir agi pendant
quelques instans, le volcan s’est tout à coup éteint pour ne
reparaître jamais, ou bien que la plus grande partie de ses produits
ont été ensuite déblayés par quelques révolutions; d’un
autre coté, on ne voit pas trop comment, au moyen de ces
éruptions, auraient pu se former ces bancs des matières scoriacées
qui alternent avec du basalte compacte. Seraient-ce des
coulées qui se seraient introduites à peu près horizontalement
entre les assises de la roche préexistante ? c’est un phénomène
bien difficile à concevoir : serait-ce la chaleur émanée du volcan,
qui aurait ainsi scorifié le basalte lui-meme? mais comment
concevoir que son action ait pu se propager de cette manière
et former des couches de scories d’une égale, épaisseur
dans toute l’étendue de la masse?Gela me paraît impossible, et
c’est au moins sans exemple positif. Il existe encore une autre
difficulté, car en admettant l’existence de ces volcans, qui, par
conséquent, ne seraient pas aussi anciens que les basaltes, on
devrait, ce me semble, en retrouver quelque part les cratères,
ou au moins des traces évidentes : o r, c’est précisément ce que
l’on ne voit pas; de sorte qu’il faut, comme pour les cratères
d’où serait sorti le basalte même, recourir à des catastrophes
pour expliquer leur disparition.
Il me semble, d’après toutes ces observations, que c’est vouloir
s’entêter inutilement à nier la volcanicité du basalte, et que,
puisqu’on veut bien admettre des volcans ouverts après coup
au milieu de ces dépôts ; puisqu’on veut bien supposer des effets
incompréhensibles, recourir à des catastrophes pour effacer
leurs traces, il est au moins aussi facile d’imaginer que ces volcans
ont aussi formé le basalte lui-même en même temps que
toutes les matières scoriacées qui les accompagnent; que ces dépôts
ont été ensuite morcelés et dégradés de manière à ce que les
caractères qui pourraient nous donner la certitude ont entièrement
disparu. On rentrerait au moins, de cette manière, dans
l’ordre naturel des choses, et l’on serait guidé par des analogies
d’autant plus frappantes, qu’elles sont fournies par des volcans
évidens qu’on trouve dans le Vivarais, à peu de distance des
masses le plus problématiques.
Après, avoir parlé des masses basaltiques qui présentent di-
vers ordres de probabilités d’origine ignée; après avoir discuté a“™™'"-
les objections qu’on a prétendu faire pour en rapporter quelques
unes à une origine neptunienne, je viens aux dépôts qui
présentent des caractères moins positifs. Ce sont des basaltes en
buttes et en plateaux, des basaltes en filons ou dike, que l’on