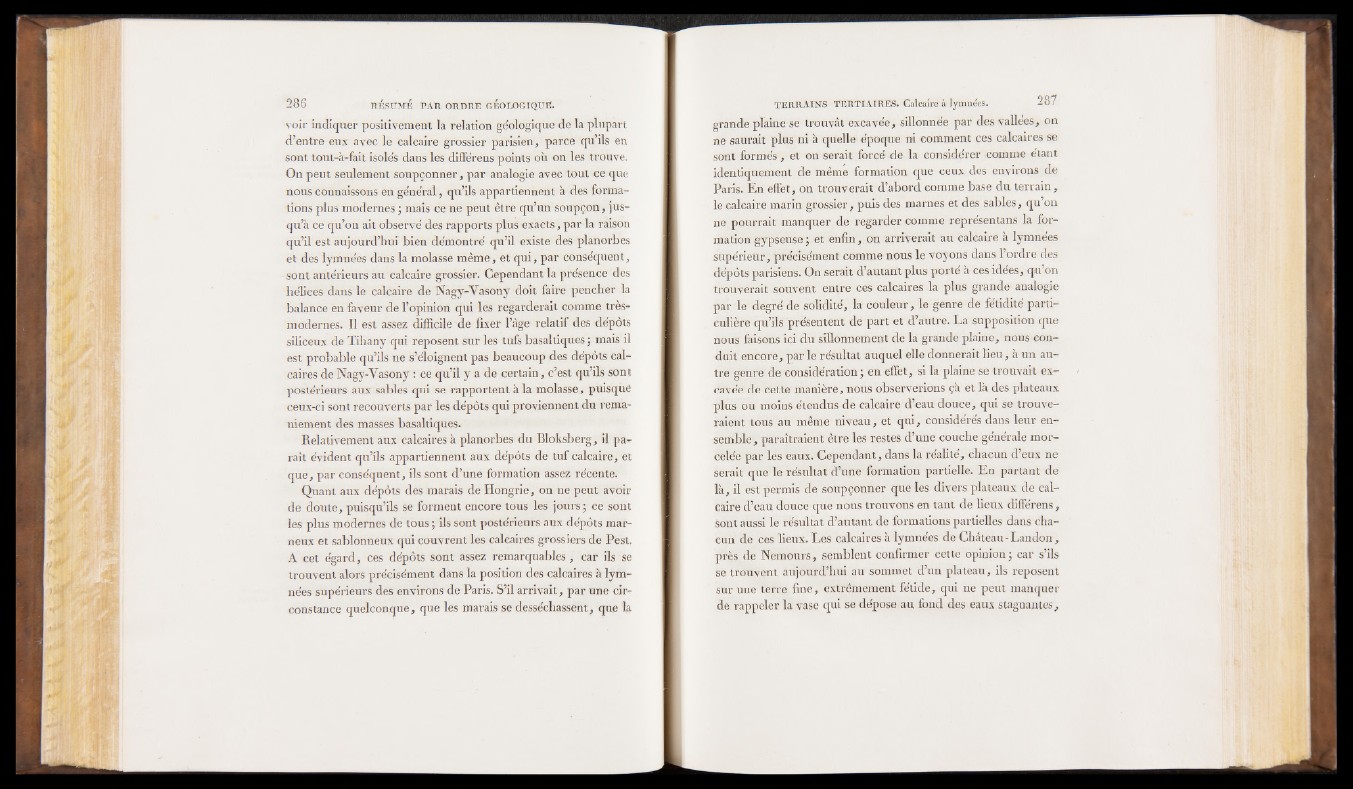
voir indiquer positivement la relation géologique de la plupart
d’entre eux avec le calcaire grossier parisien, parce qu’ils en
sont tout-à-fait isole's dans les difïërens points où on les trouve.
On peut seulement soupçonner, par analogie avec tout ce que
nous connaissons en ge'ne'ral, qu’ils appartiennent à des formations
plus modernes ; mais ce ne peut être qu’un soupçon, jusqu’à
ce qu’on ait observe' des rapports plus exacts, par la raison
qu’il est aujourd’hui bien démontre qu’il existe des planorbes
et des lymnées dans la molasse même, et qui, par conse'quent,
sont ante'rieurs au calcaire grossier. Cependant la pre'sence des
hélices dans le calcaire de Nagy-Vasony doit faire pencher la
balance en faveur de l’opinion qui les regarderait comme très-
modernes. Il est assez difficile de fixer l’àge relatif des dépôts
siliceux de Tihany qui reposent sur les tufs basaltiques ; mais il
est probable qu’ils ne s’éloignent pas beaucoup des dépôts calcaires
de Nagy-Vasony : ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils sont
postérieurs aux sables qui se rapportent à la molasse, puisque
ceux-ci sont recouverts par les dépôts qui proviennent du remaniement
des masses basaltiques.
Relativement aux calcaires à planorbes du Bloksberg, il paraît
évident qu’ils appartiennent aux dépôts de tuf calcaire, et
que, par conséquent, ils sont d’une formation assez récente.
Quant aux dépôts des marais de Hongrie, on ne peut avoir
de doute, puisqu’ils se forment encore tous les jours; ce sont
les plus modernes de tous ; ils sont postérieurs aux dépôts marneux
et sablonneux qui couvrent les calcaires grossiers de Pest,
A cet égard, ces dépôts sont assez remarquables , car ils se
trouvent alors précisément dans la position des calcaires à lymnées
supérieurs des environs de Paris. S’il arrivait, par une circonstance
quelconque, que les marais se desséchassent, que la
grande plaine se trouvât excavée, sillonnée par des vallées, on
ne saurait plus ni à quelle époque ni comment ces calcaires se
sont formés > et on serait forcé de la considérer comme étant
identiquement de même formation que ceux des environs de
Paris. En effet, on trouverait d’abord comme base du terrain,
le calcaire marin grossier, puis des marnes et des sables, qu’on
ne pourrait manquer de regarder comme représentans la formation
gypseuse; et enfin, on arriverait au calcaire à lymnees
supérieur, précisément comme nous le voyons dans l’ordre des
dépôts parisiens. On serait d’autant plus porté à ces idees, qu’on
trouverait souvent entre ces calcaires la plus grande analogie
par le degré de solidité, la couleur, le genre de fétidité particulière
qu’ils présentent de part et d’autre. La supposition que
nous faisons ici du sillonnement de la grande plaine, nous conduit
encore, par le résultat auquel elle donnerait lieu , à un autre
genre de considération ; en effet, si la plaine se trouvait excavée
de cette manière, nous observerions çà et là des plateaux
plus ou moins étendus de calcaire d’eau douce, qui se trouveraient
tous au même niveau, et qui, considérés dans leur ensemble,
paraîtraient être les restes d’une couche générale morcelée
par les eaux. Cependant, dans la réalité, chacun d’eux ne
serait que le résultat d’une formation partielle. En partant de
là, il est permis de soupçonner que les divers plateaux de calcaire
d’eau douce que nous trouvons en tant de lieux différens ,
Sont aussi le résultat d’autant de formations partielles dans chacun
de ces lieux. Les calcaires à lymnées de Château-Landon,
près de Nemours, semblent confirmer cette opinion; car s’ils
se trouvent aujourd’hui au sommet d’un plateau, ils reposent
sur une terre fine, extrêmement fétide, qui ne peut manquer
de rappeler la vase qui se dépose au fond des eaux stagnantes,