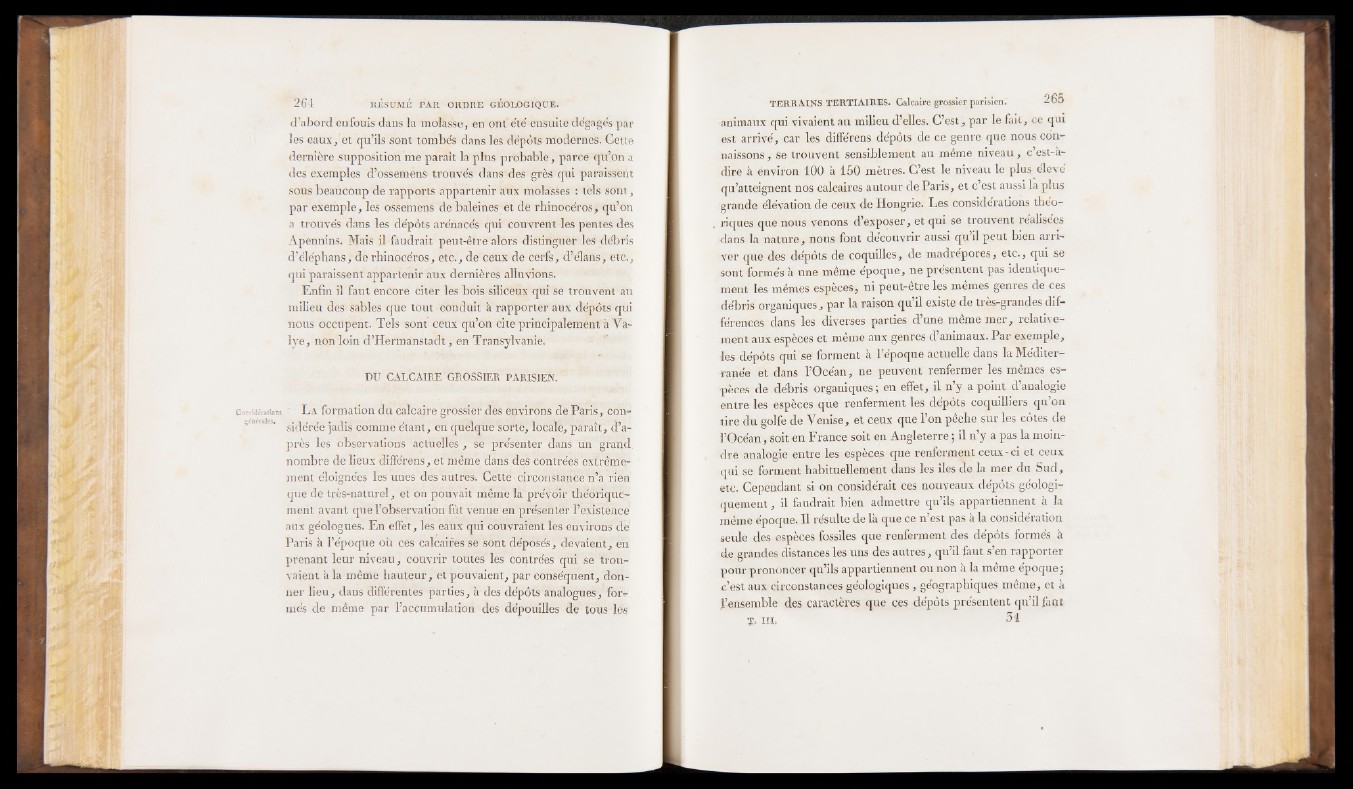
Considération
générales.
d’abord enfouis dans la molasse, en ont e'te' ensuite dégagés par
les eaux, et qu’ils sont tombés dans les dépôts modernes. Getie
dernière supposition me paraît la plus probable, parce qu’on a
des exemples d’ossemens trouvés dans des grès qui paraissent
sous beaucoup de rapports appartenir aux molasses : tels sont,
par exemple, les ossemens de baleines et de rhinocéros, qu’on
a trouvés dans les dépôts arénacés qui couvrent les pentes des
Apennins. Mais il faudrait peut-être alors distinguer les débris
d’éléphans, de rhinocéros, etc., de ceux de cerfs, d’élans, etc.,
qui paraissent appartenir aux dernières alluvions.
Enfin il faut encore citer les bois siliceux qui se trouvent au
milieu des sables que tout conduit à rapporter aux dépôts qui
nous occupent. Tels sont ceux qu’on cite principalement à Valve,
non loin d’Hermanstadt, en Transylvanie,
DU CALCAIRE GROSSIER PARISIEN,
■ La formation du calcaire grossier des environs de Paris, considérée
jadis comme étant, en quelque sorte, locale, paraît, d’après
les observations actuelles , se présenter dans un grand,
nombre de lieux différens, et même dans des contrées extrêmement
éloignées les unes des autres-. Cette ■ circonstance n’a rien
que de très-naturel, et on pouvait même la prévoir théoriquement
avant que l’observation fût venue en présenter l’existence
aux géologues. En effet, les eaux qui couvraient les environs de
Paris à l’époque où ces calcaires se sont déposés, devaient, en
prenant leur niveau, couvrir toutes les contrées qui se trouvaient
à la même hauteur, et pouvaient, par conséquent, donner
lieu, dans différentes parties, à des dépôts analogues, formés
de même par l’accumulation des dépouilles de tous les
animaux qui vivaient au milieu d’elles. C’est, par le fait, ce qui
est arrivé, car les différens dépôts de ce genre que nous connaissons
, se trouvent sensiblement au même niveau, c’est-à-
dire à environ 100 à 150 mètres. C’est le niveau le plus elevé
qu’atteignent nos calcaires autour de Paris, et c’est aussi la plus
grande élévation de ceux de Hongrie. Les considérations théoriques
que nous venons d’exposer, et qui se trouvent réalisées
dans la nature, nous font découvrir aussi qu’il peut bien arriver
que des dépôts de coquilles, de madrépores, etc., qui se
sont formés à une même époque, ne présentent pas identiquement
les mêmes espèces, ni peut-être les mêmes genres de ces
débris organiques, par la raison qu’il existe de très-grandes différences
dans les diverses parties d’une même mer, relativement
aux espèces et même aux genres d’animaux. Par exemple,
les dépôts qui se' forment à l’époque actuelle dans la Méditerranée
et dans l’Océan, ne peuvent renfermer les mêmes espèces
de débris organiques; en effet, il n’y a point d’analogie
entre les espèces que renferment les dépôts coquilliers qu’on
tire du golfe de Venise, et ceux que l’on pêche sur les côtes de
l’Océan, soit en France soit en Angleterre ; il n’y a pas la moindre
analogie entre les espèces que renferment ceux-ci et ceux
qui se forment habituellement dans les îles de la mer du Sud,
etc. Cependant si on considérait ces nouveaux dépôts géologiquement
, il faudrait bien admettre qu’ils appartiennent à la
même époque. Il résulte de là que ce n’est pas à la considération
seule des espèces fossiles que renferment des dépôts formés à
de grandes distances les uns des autres, qu’il faut s’en rapporter
pour prononcer qu’ils appartiennent ou non à la même époque ;
c’est aux circonstances géologiques , géographiques même, et à
l’ensemble des caractères que ces dépôts présentent qu’il faut
j, ni. 54