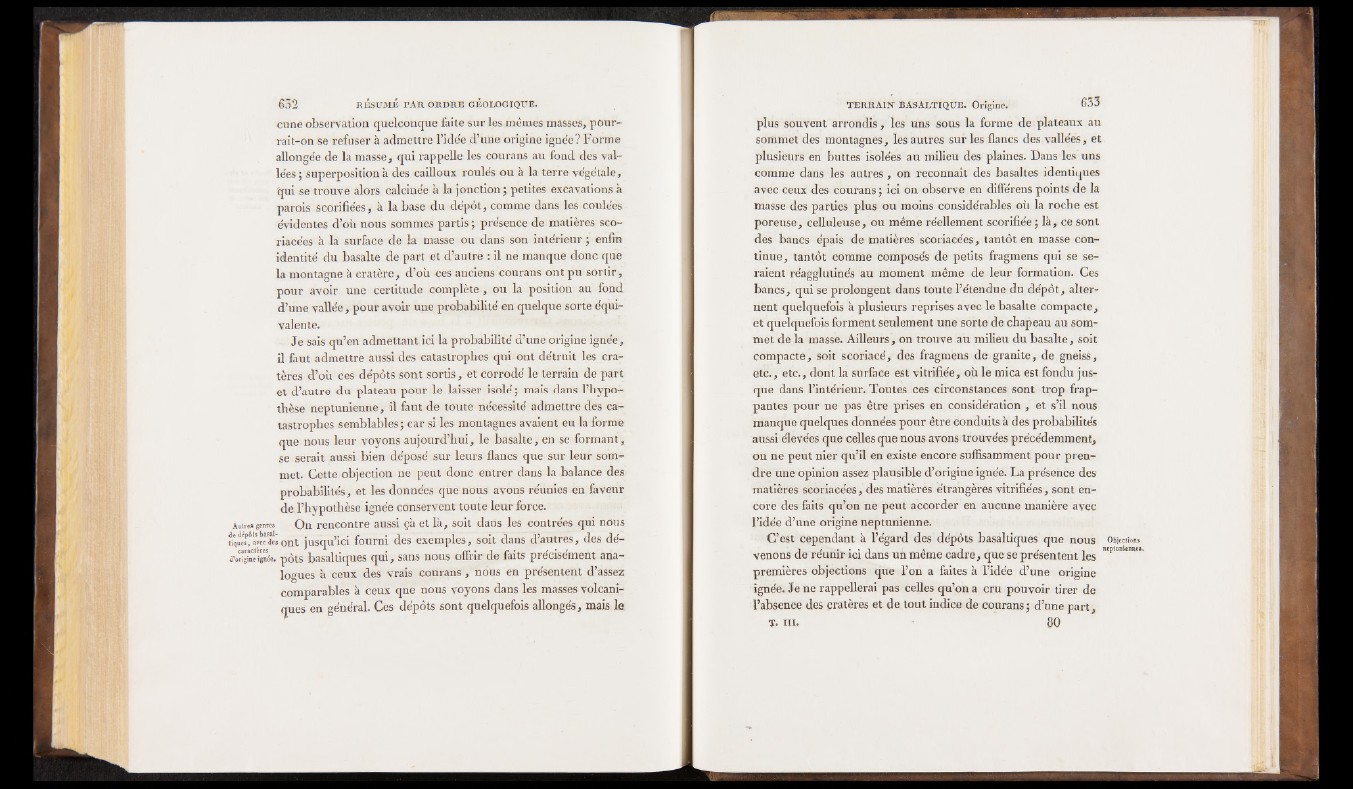
cune observation quelconque faite sur les mêmes masses, pourrait
on se refuser à admettre l’idée d’une origine igne'e? Forme
allonge'e de la masse, qui rappelle les courans au fond des vallées;
superposition à des cailloux roulés ou à la terre végétale,
qui se trouve alors calcinée à la jonction ; petites excavations à
parois scorifie'es, à la base du dépôt, comme dans les coulées
évidentes d’où nous sommes partis ; présence de matières scoriacées
à la surface de la masse ou dans son intérieur ; enfin
identité du basalte de part et d’autre : il ne manque donc que
la montagne à cratère, d’où ces anciens courans ont pu sortir,
pour avoir une certitude complète , ou la position au fond
d’une vallée, pour avoir une probabilité en quelque sorte équivalente.
Je sais qu’en admettant ici la probabilité d’une origine ignée,
il faut admettre aussi des catastrophes qui ont détruit les cratères
d’où ces dépôts sont sortis, et corrodé le terrain de part
et d’autre du plateau pour le laisser isolé ; mais dans l’hypothèse
neptunienne, il faut de toute nécessité admettre des catastrophes
semblables; car si les montagnes avaient eu la formé
que nous leur voyons aujourd’hui, le basalte, en se formant,
se serait aussi bien déposé sur leurs flancs que sur leur sommet.
Cette objection ne peut donc entrer dans la balance des
probabilités, et les données que nous avons réunies en faveur
de. l’hypothèse ignée conservent toute leur force.
Autres genres On rencontre aussi çà et là, soit dans les contrées qui nous
avecàejont jusqu’ici fourni des exemples, soit dans d’autres, des dé-
pôts basaltiques qui, sans nous offrir de faits précisément analogues
à ceux des vrais courans, nous en présentent d’assez
comparables à ceux qne nous voyons dans les masses volcaniques
en général. Ces dépôts sont quelquefois allongés, mais Je
plus souvent arrondis, les uns sous la forme de plateaux au
sommet des montagnes, les autres sur les flancs des vallées, et
plusieurs en buttes isolées au milieu des plaines. Dans les uns
comme dans les autres, on reconnaît des basaltes identiques
avec ceux des courans ; ici on observe en différens points de la
masse des parties plus ou moins considérables où la roche est
poreuse, celluleuse, ou même réellement scorifiée; là, ce sont
des bancs épais de matières scoriacées, tantôt en masse continue,
tantôt comme composés de petits fragmens qui se seraient
réagglutinés au moment même de leur formation. Ces
bancs, qui se prolongent dans toute l’étendue du dépôt, alternent
quelquefois à plusieurs reprises avec le basalte compacte,
et quelquefois forment seulement une sorte de chapeau au sommet
de la masse. Ailleurs, on trouve au milieu du basalte, soit
compacte, soit scoriacé, des fragmens de granité, de gneiss,
etc., etc., dont la surface est vitrifiée, où le mica est fondu jusque
dans l’intérieur. Toutes ces circonstances sont trop frappantes
pour ne pas être prises en considération , et s’il nous
manque quelques données pour être conduits à des probabilités
aussi élevées que celles que nous avons trouvées précédemment,
on ne peut nier qu’il en existe encore suffisamment pour prendre
une opinion assez plausible d’origine ignée. La présence des
matières scoriacées, des matières étrangères vitrifiées, sont encore
des faits qu’on ne peut accorder en aucune manière avec
l’idée d’une origine neptunienne.
C’est cependant à l’égard des dépôts basaltiques que nous Obje«îou
. a i t •% neptunienne*. venons de reumr ici dans un meme cadre, que se présentent les
premières objections qne l’on a faites à l’idée d’une origine
ignée. Je ne rappellerai pas celles qu’on a cru pouvoir tirer de
l’absence des cratères et de tout indice de courans ; d’une part,
T. III, - 80