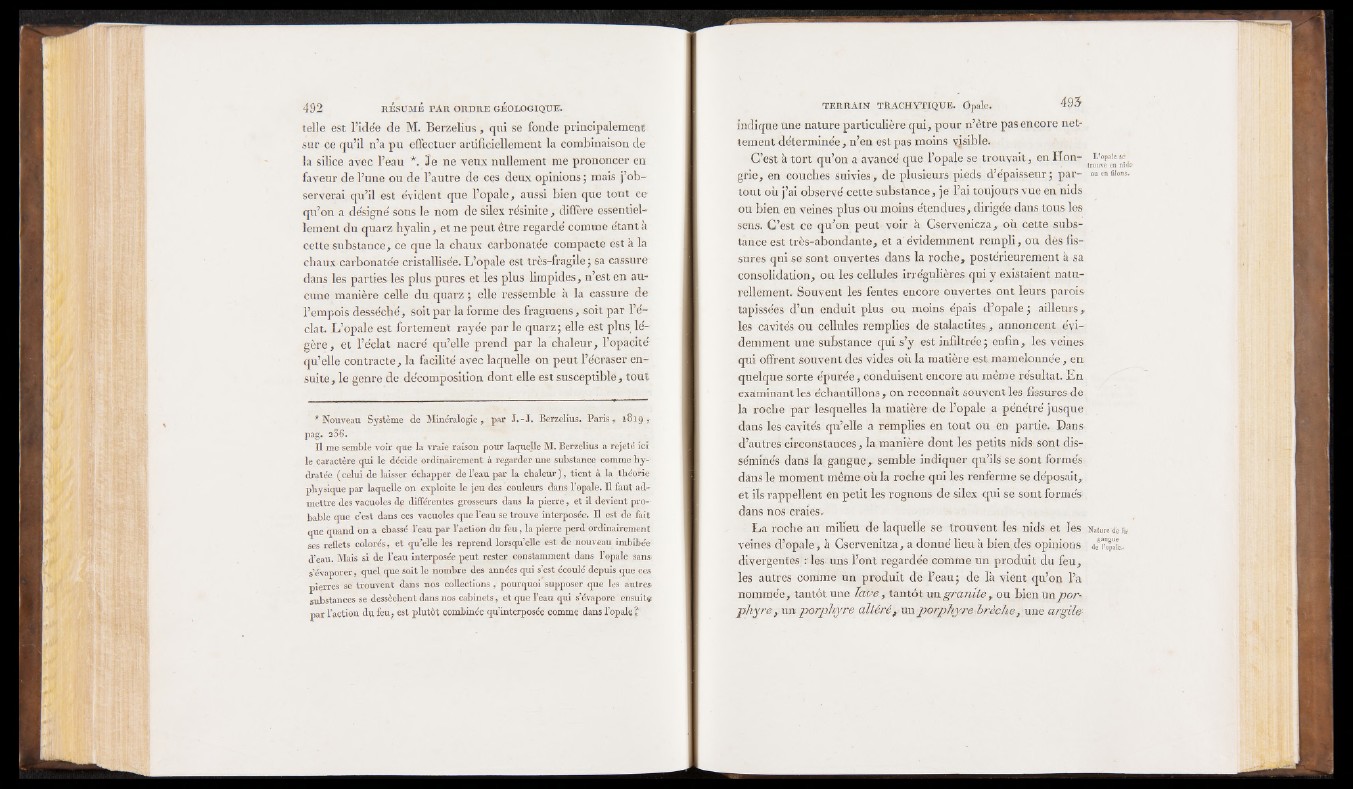
telle est l’idée de M. Berzelius, qui se fonde principalement
sur ce qu’il n’a pu effectuer artificiellement la combinaison de
la silice avec l’eau *. Je ne veux nullement me prononcer en
faveur de l’une ou de l’autre de ces deux opinions ; mais j’observerai
qu’il est évident que l’opale, aussi bien que tout ce
qu’on a désigné' sous le nom de silex re'sinite, diffère essentiellement
du quarz hyalin, et ne peut être regarde' comme e'tant à
cette substance, ce que la chaux carbonate'e compacte est à la
chaux carbonate'e cristallise'e. L ’opale est très-fragile ; sa cassure
dans les parties les plus pures et les plus limpides, n’est en aucune
manière celle du quarz ; elle ressemble à la cassure de
l’empois desse'che', soit par la forme des fragmens, soit par l’éclat.
L’opale est fortement raye'e par le quarz; elle est plusi légère
, et l’éclat nacré qu’elle prend par la chaleur, l’opacité
qu’elle contracte, la facilité avec laquelle on peut l’écraser ensuite,
le genre de décomposition dont elle est susceptible, tout
* Nouveau Système de Minéralogie, par J.-J . Berzelius* Paris, 1 8 1 9 ,
pag. a36.
Il me semble voir que la vraie raison pour laquelle M. Berzelius a rejeté ici'
le caractère qui le décide ordinairement à regarder une substance comme hydratée
(celui de laisser échapper de l’eau par la chaleur), tient à la théorie
physique par laquelle on exploite le jeu des couleurs dans l’opale. H faut admettre
des vacuoles dp différentes grosseurs dans la pierre, et il devient probable
que c’est dans ces vacuoles que l’eau se trouve interposée. Il est de fait
que quand on a chassé l’eau par l’action du feu, la pierre perd ordinairement
ses reflets colorés, et qu’elle les reprend lorsqu’elle est de nouveau imbibée
d’eau. Mais si de l’eau interposée peut rester constamment dans l’opale sans;
s’évaporer, quel que soit le nombre des années qui s’est écoulé depuis que ces
pierres se trouvent dans nos collections , pourquoi supposer que les autres
substances se dessèchent dans nos cabinets, et que l’eau qui s’évapore ensuite;
par l’action du feu? est plutôt combinée qu’interposée comme dans l’opale?
indique une nature particulière qui, pour n’être pas encore nettement
déterminée, n’en est pas moins vjsible.
C’est à tort qu’on a avancé que l’opale se trouvait, en Hon- , Kgr! “ds
gfie, en couches suivies, de plusieurs pieds d’épaisseur; par- ■»“ *>>•
tout où j’ai observé cette substance, je l’ai toujours vue en nids
ou bien en veines plus ou moins étendues, dirigée dans tous les
sens. G’est ce qu’on peut-voir à Cservenicza,, où cette substance
est très-abondante, et a'évidemment rempli, ou dès fissures
qui se sont ouvertes dans la roche, postérieurement à sa
consolidation, ou les cellules irrégulières qui y existaient naturellement,
Souvent les fentes encore ouvertes ont leurs parois
tapissées d’un enduit plus ou moins épais d’opale ; ailleurs,
les cavités ou cellules remplies de stalactites , annoncent évidemment
une substance qui s’y est infiltrée; enfin, les veines
qui offrent souvent des vides où la matière est mamelonnée, en
quelque sorte épurée, conduisent encore au même résultat. En
examinant les échantillons , on reconnaît souvent les fissures de
la roche par lesquelles la matière de l’opale a pénétré jusque
dans les cavités qu’elle a remplies en tout ou en partie. Dans
d’autres circonstances, la manière dont les petits nids sont disséminés
dans la gangue, semble indiquer qu’ils se Sont formés1
dans le moment même où la roche qui les renferme se déposait,
et ils rappellent en petit les rognons de silex qui se sont formés;
dans nos craies,
La roche au milieu de laquelle se trouvent les nids et les Nam« * &
veines d’opale, à Cservenitza, a donné lieu à bien des opinions de8r”piL
divergentes r les uns Font regardée comme un produit du feu,
les autres comme un produit de l’eau; de là vient qu’on Fa
nommée, tantôt une Icive , tantôt un granité + ou bien ünporphyre,,
un porphyre altéré, un porphyre brèche, une argile