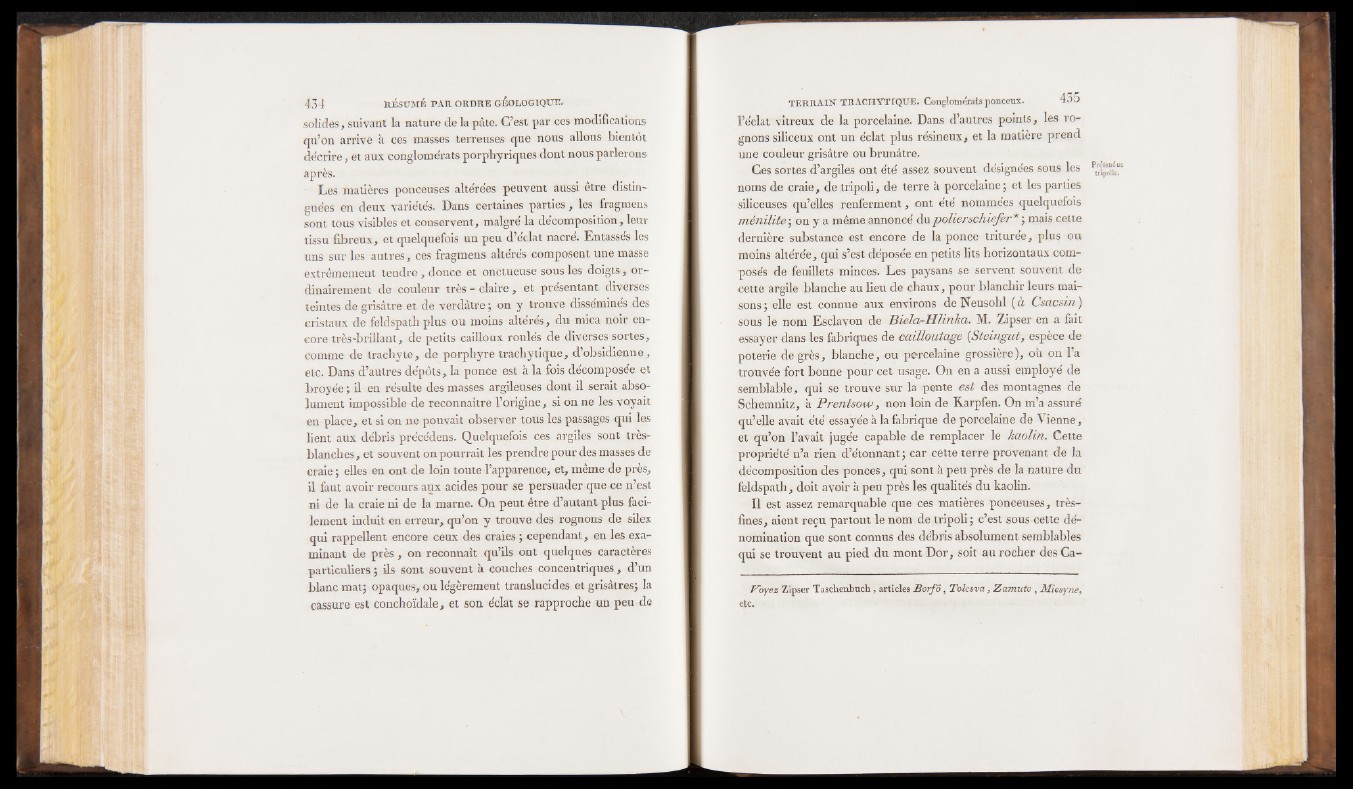
solides, suivant la nature die la pâte. C’est par ces modifications
qu’on arrive à ces masses terreuses que nous allons bientôt
décrire, et aux conglomérats porphyriques dont nous parlerons
après.
Les matières ponceuses altérées peuvent aussi être distinguées
en deux variétés. Dans certaines parties, les fragmens
sont tous visibles et conservent, malgré la décomposition, leur
tissu fibreux, et quelquefois un peu d’éclat nacré. Entassés les
uns sur les autres , ces fragmens altérés composent une masse
extrêmement tendre, douce et onctueuse sous les doigts, ordinairement
de couleur très - claire , et présentant diverses
teintes de grisâtre et de verdâtre ; on y trouve disséminés des
cristaux de feldspath plus ou moins altérés, du mica noir encore
très-brillant, de petits cailloux roulés de diverses sortes,
comme de trachyte, de porphyre trachytique, d’obsidienne,
etc. Dans d’autres dépôts, la ponce est à la fois décomposée et
broyée ; il en résulte des masses argileuses dont il serait absolument
impossible de reconnaître l’origine, si on ne les voyait
en place, et si on ne pouvait observer tous les passages qui les
lient aux débris précédens. Quelquefois ces argiles sont tres-
blanches , et souvent on pourrait les prendre pour des masses de
craie; elles en ont de loin toute l’apparence, et, même de près,
il faut avoir recours aux acides pour se persuader que ce n’est
ni de la craie ni de la marne. On peut être d’autant plus facilement
induit en erreur, qu’on y trouve des rognons de silex
qui rappellent encore ceux des craies ; cependant, en les examinant
de près , on reconnaît qu’ils ont quelques caractères
particuliers ; ils sont souvent à couches concentriques, d’un
blanc mat; opaques, ou légèrement translucides et grisâtres; la
cassure est conchoïdale, et son éclat se rapproche un peu de
l’éclat vitreux de la porcelaine. Dans d’autres points, les rognons
siliceux ont un éclat plus résineux, et la matière prend
une couleur grisâtre ou brunâtre.
Ces sortes d’argiles ont été assez souvent désignées sous les
noms de craie, de tripoli, de terre à porcelaine ; et les parties
siliceuses qu’elles renferment, ont été nommées quelquefois
ménilite; on y a même annoncé du polierschiefer* ; mais cette
dernière substance est encore de la ponce triturée, plus ou
moins altérée, qui s’est déposée en petits lits horizontaux composés
de feuillets minces. Les paysans se servent souvent de
cette argile blanche au lieu de chaux, pour blanchir leurs maisons;
elle est connue aux environs de Neusohl (à Csacsin)
sous le nom Esclavon de Biela-Hlinka. M. Zipser en a fait
essayer dans les fabriques de cailloutage (Steingut, espèce de
poterie degrés, blanche, ou porcelaine grossière), où on l’a
trouvée fort bonne pour cet usage. On en a aussi employé de
semblable, qui se trouve sur la pente est des montagnes de
Schemnitz, à Prentsow, non loin de Karpfen. On m’a assuré
qu’elle avait été essayée à la fabrique de porcelaine de Vienne,
et qu’on l’avait jugée capable de remplacer le kaolin. Cette
propriété n’a rien d’étonnant; car cette terre provenant de la
décomposition des ponces, qui sont à peu près de la nature du
feldspath, doit avoir à peu près les qualités du kaolin.
Il est assez remarquable que ces matières ponceuses, très-
fines, aient reçu partout le nom de tripoli; c’est sous cette dénomination
que sont connus des débris absolument semblables
qui se trouvent au pied du mont D or, soit au rocher des Ca-
Vayez Zipser Taschenbuch, articles Borfo, Tolcsva, Zamuto, Micsyne,
etc.
Prétendus
tripolis