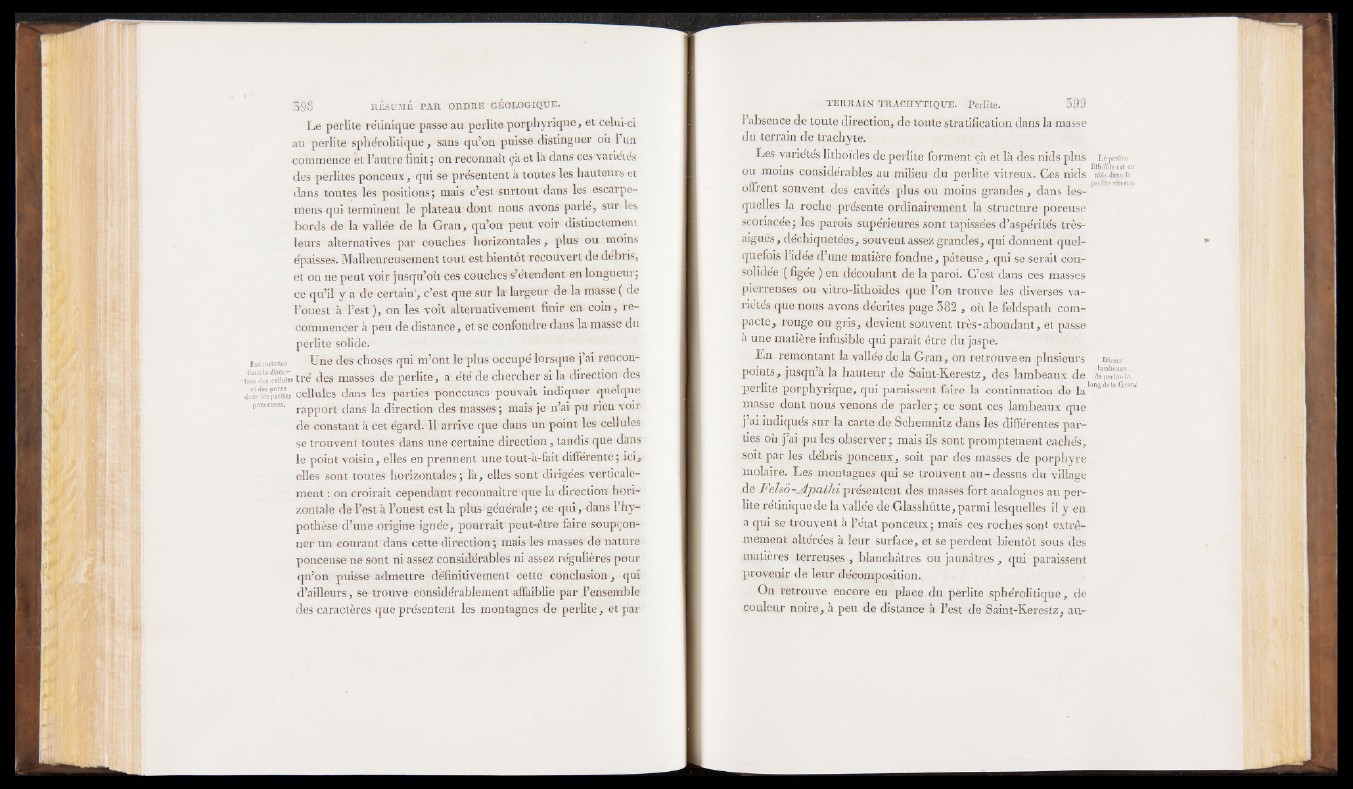
Le perlite rétinique passe au perlite porphyrique, et celui-ci
au perlite sphérolitique , sans qu’on puisse distinguer où l’un
commence et l’autre finit ; on reconnaît ça et là dans ces variétés
des perlites ponceux, qui se présentent à toutes les hauteurs et
dans toutes les positions; mais c’est surtout dans les escarpe-
mens qui terminent le plateau dont nous avons parle, sur les
bords de la vallée de la Gran, qu’on peut voir distinctement
leurs alternatives par couches horizontales, plus ou moins
épaisses. Malheureusement tout est bientôt recouvert de débris,
et on ne peut voir jusqu’où ces couches s’étendent en longueur;
ce qu’il y a de certain', c’est que sur la largeur de la masse ( de
l’ouest à l’est ), on les voit alternativement finir en coin, recommencer
à peu de distance, et se confondre dans la masse du
perlite solide.
incmsiance Une des choses qui m’ont le plus occupé lorsque j’ai rencon-
-i?oTdêscïï»tré des masses de perlite, a été de chercher si la direction des
< â f P & cellules dans les parties ponceuses- pouvait indiquer quelque
ponceuses, rapp0rt (]ans ia direction des masses-; mais je n’ai pu rien voir
de constant à cet égard. 11 arrive que dans un point les cellules
se trouvent toutes dans une certaine direction, tandis que dans
le point voisin, elles en prennent une tout-à-fait différente ; ici,
elles sont toutes horizontales; là, elles sont dirigées verticalement
: on croirait cependant reconnaître que la direction horizontale
de l ’est à l’ouest est la plus générale ; ce qui, dans l’hypothèse
d’une origine ignée, pourrait peut-être faire soupçonner
un courant dans cette direction ; mais les masses de nature
ponceuse ne sont ni assez considérables ni assez régulières pour
qu’on puisse- admettre définitivement cette conclusion, qui
d’ailleurs, se trouve considérablement affaiblie par l’ensemble
des caractères que présentent les montagnes de perlite, et par
l’absence de toute direction, de toute stratification dans la masse
du terrain de trachyte.
Les variétés lithoïdes de perlite forment çà et là des nids plus leperiae
ou moins considérables au milieu du perlite vitreux. Ces nids
offrent souvent des cavités plus ou moins grandes , dans les- P
quelles la roche présente ordinairement la structure poreuse
scoriacée; les parois supérieures sont tapissées d’aspérités très-
aiguës, déchiquetées, souvent assez grandes, qui donnent quel- **
quefois l’ide,e d’une matière fondue, pâteuse, qui se serait consolidée
( figée ) en découlant de la paroi. C’est dans ces masses
pierreuses ou vitro-lithoïdes que l’on trouve les diverses variétés
que nous avons décrites page 382 , où le feldspath compacte,
rouge ou gris, devient souvent très-abondant, et passe
à une matière infusible qui paraît être du jaspe.
En remontant la vallée de la Gran, on retrouveen plusieurs Divers
points, jusqu’à la hauteur de Saint-Kerestz, des lambeaux de aeîSte
perlite porphyrique, qui paraissent faire la continuation de ja lo"8'lelaGra"'
masse dont nous venons de parler; ce sont ces lambeaux que
j’ai indiqués sur la carte de Schemnitz dans les différentes parties
où j’ai pu les observer; mais ils sont promptement cachés,
soit par les débris ponceux, soit par des masses de porphyre
molaire. Les montagnes qui se trouvent au-dessus du village
de Felso-jjpathi présentent des masses fort analogues au perlite
rétinique de la vallée de Classhütte, parmi lesquelles il y en
a qui &e trouvent à l’état ponceux; mais ces roches sont extrêmement
altérées à leur surface, et S.e perdent bientôt sous des
matières terreuses „ blanchâtres ou jaunâtres , qui paraissent
provenir de leur décomposition.
On retrouve encore en place du perlite sphérolitique, de
couleur noire, à peu de distance à l’est de Saint-Kerestz, au