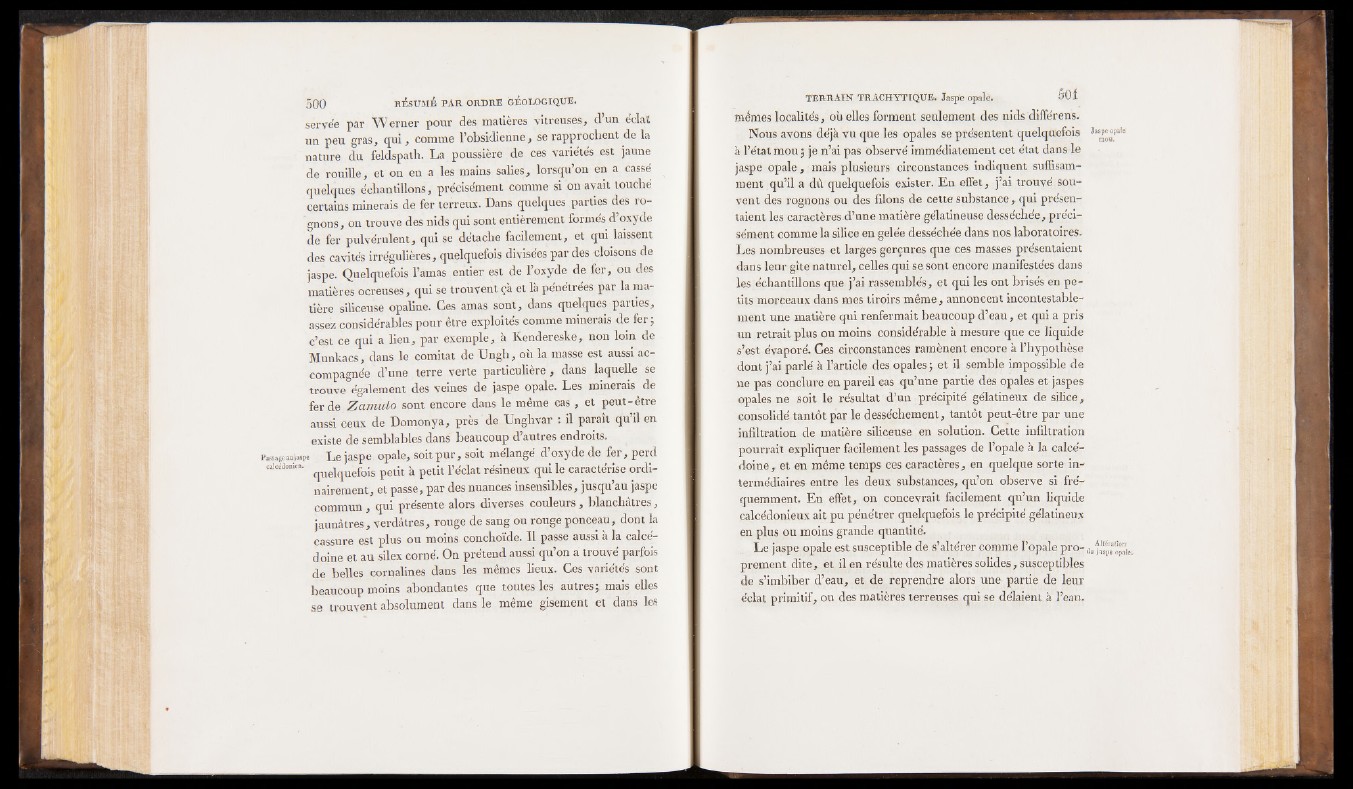
servée par W ern er pour des matières vitreuses, d u n éclat
un peu gras, q u i, comme l’obsidienne, se rapprochent de la
nature du feldspath. La poussière de ces varie'te's est jaune
de rouille, et on en a les mains salies, lorsqu on en a cassé
quelques échantillons, précisément comme si on avait touché
certains minerais de fer terreux. Dans quelques parties des rognons,
on trouve des nids qui sont entièrement formés d’oxyde
de fer pulvérulent, qui se détache facilement, et qui laissent
des cavités irrégulières, quelquefois divisées par des cloisons de
jaspe. Quelquefois l’amas entier est de l’oxyde de fer, ou des
matières ocreuses, qui se trouvent çà et là pénétrées par la matière
siliceuse opaline. Ces amas sont, dans quelques patties,
assez considérables pour être exploités comme minerais de fer ;
c’est ce qui a lieu, par exemple, à Kendereske, non loin de
Munkacs, dans le comitat de Ungh, où la masse est aussi accompagnée
d’une terre verte particulière, dans laquelle se
trouve également des veines de jaspe opale. Les minerais de
fer de Z am u to sont encore dans le même cas , et peut-être
aussi ceux de Domonya, près de Unghvar : il parait qu il en
existe de semblables dans beaucoup d autres endroits.
Passage au jaspe Le jaspe opale, soit p u r, soit mélangé d oxyde de fer, perd
caicédonîen. lcjuef0;s pelj t à petit l’éclat résineux qui le caractérise ordinairement,
et passe, par des nuances insensibles, jusqu’au jaspe
commun , qui présente alors diverses couleurs, blanchâtres,
jaunâtres, verdâtres, rouge de sang ou rouge ponceau, dont la
cassure est plus ou moins conchoïde. Il passe aussi à la calcédoine
et au silex corné. On prétend aussi qu’on a trouvé parfois
de belles cornalines dans les mêmes lieux. Ces variétés sont
beaucoup moins abondantes que toutes les autres; mais elles
se trouvent absolument dans le même gisement et dans les
mêmes localités, où elles forment seulement des nids diffe'rens.
Nous avons déjà vu que les opales se présentent quelquefois
à l’état mou ; je n’ai pas observé immédiatement cet état dans le
jaspe opale , mais plusieurs circonstances indiquent suffisamment
qu’il a dû quelquefois exister. En effet, j’ai trouvé souvent
des rognons ou des filons de cette substance, qui présentaient
les caractères-d’une matière gélatineuse desséchée, précisément
comme la silice en gelée desséchée dans nos laboratoires.
Les nombreuses et larges gerçures que ces masses présentaient
dans leur gîte naturel, celles qui se sont encore manifestées dans
les échantillons que j’ai rassemblés, et qui les ont brisés en petits
morceaux dans mes tiroirs même, annoncent incontestablement
une matière qui renfermait beaucoup d’eau, et qui a pris
un retrait plus ou moins considérable à mesure que ce liquide
s’est évaporé. Ces circonstances ramènent encore à l’hypothèse
dont j’ai parlé à l’article des opales; et il semble impossible de
ne pas conclure en pareil cas qu’une partie des opales et jaspes
opales ne soit le résultat d’un précipité gélatineux de silice,
consolidé tantôt par le dessèchement, tantôt peut-être par une
infiltration de matière siliceuse en solution. Cette infiltration
pourrait expliquer facilement les passages de l’opale à la calcédoine,
et en même temps ces caractères, en quelque sorte intermédiaires
entre les deux substances, qu’on observe si fréquemment.
En effet, on concevrait facilement qu’un liquide
calcédonieux ait pu pénétrer quelquefois le précipité gélatineux
en plus pu moins grande quantité.
Le jaspe opale est susceptible de s’altérer comme l’opale proprement
dite, et il en résulte des matières solides, susceptibles
de s’imbiber d’eau, et de reprendre alors une partie de leur
éclat primitif, ou des matières terreuses qui se délaient à l’eau.
Jaspe opale
mots.
Alféralfoiï
3u jaspe opale;