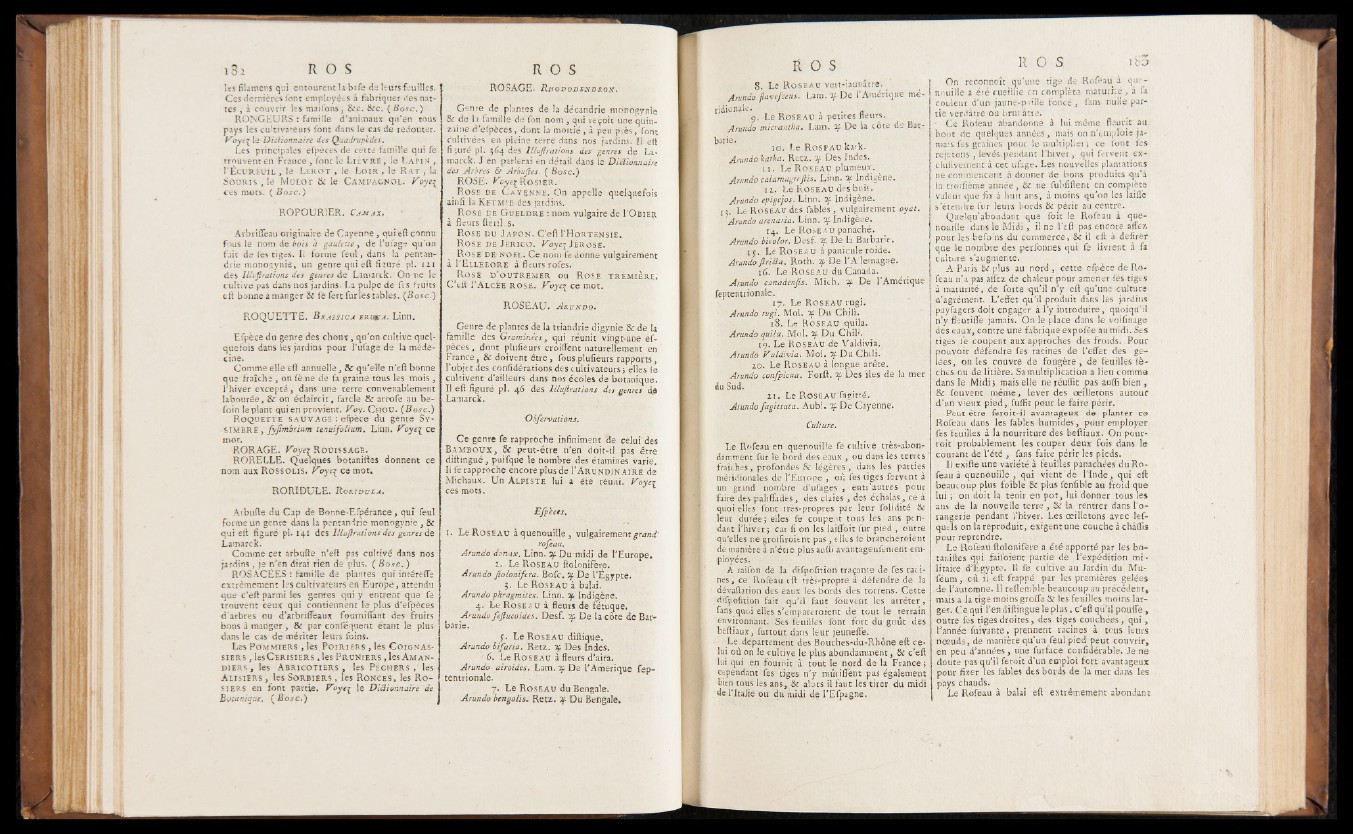
les filamens qui entourent la bafe de leurs feuilles.
Ces dernières font employées à fabriquer des nattes
, à couvrir les rriaifons, & c . &c. ( B osc.)
RONGEURS : famille d’ animaux qu’en tous
pays les cultivateurs font dans le cas de redouter.
Voye^ le Dictionnaire des Quadrupèdes.
Les principales efpèces de cette famille qui fe
trouvent en France, font le Liè v r e , le La p in ,
I’Écureuil , le Lerot , le Loir , le R at , la
Souris , le Mulot & le Campagnol. V o y e^
ces mots. {B o s c .)
ROPOURIER. Ca m a x .
Arbriffeau originaire de Cayenne, qui eft connu
fous le nom de bois a gaulette, de l’ufage qu'on
fait de les tiges. Il forme feul, dans la pentan-
drie monogynie, un genre qui eft figuré pi. m
des Illufirations des genres de Lamartk. On ne le
cultive pas dans nos jardins. La pulpe de fes fruits
eft bonne à manger & fe fert fur les tables. {Bosc.)
RO Q U E T TE . B rassica eruka. Linn.
Efpèce du genre des choux, qu’on cultive quelquefois
dans les jardins pour Tufage. de la médecine.
Comme elle eft annuelle, & qu’elle n'eft bonne
que fraîche, on fème de fa graine tous les mois ,
l’hiver excepté, dans une terre convenablement
labouréej & on éclaircit, farcie & arrofe au be-
foin le plant qui en provient. Voy. C hou. ( B osc.)
Roquette sauvage : efpèce du genre Sy -
5IMBRE, fyfimbrium tenuifolium. Linn. Voye[ ce
mot.
RORAGE. yoyei Rouissage.
RORELLE. Quelques botaniftes donnent ce
nom aux Rossolis. Voye^ ce mot.
RORIDULE. R o r îd u l a .
Arbufte du Cap de Bonne-Efpéranee, qui feul
forme un genre dans la pentandrie monogynie , &
qui eft figuré pl. 141 des Illufirations des genres de
Lamarck.
Comme cet arbufte n’ eft pas cultivé dans nos
jardins, je n’en dirai rien de plus. (B o s c .)
ROSACÉES : famille de plantes qui imérefife
extrêmement les cultivateurs en Europe, attendu
que c ’eft parmi les genres qui y entrent que fe
trouvent ceux qui contiennent le plus d’elpèces
d ’arbres ou d’arbriffeaux fourniffant des fruits ;
bons à mariger , & par conféquent étant le plus :
dans le cas de mériter leurs foins.
Les Pommiers , les.Poiriers , les C oignas- !
siers , les C erisiers , les Pruniers , les Aman- i
DiERs,les Abricotiers, les Pêchers , ' les j
A lisiers , les Sorbiers , les Ronces, les Ro- j
SIERS en font partie. V o y e ^ le D i f t io n n a i r e d e
b o ta n iq u e . ( B o s c . )
ROSAGE. R ho d o d en dr on.
Genre de plantes de la décandrie monogynie
& de la famille de fon nom , qui reçoit une quinzaine
d ’efpèces, dont la moitié, à peu près, font
i cultivées en pleine terre dans nos jardins. Il eft
j figure pl. 564 des Illufirations des genres de Lamarck.
J en parlerai en détail dans le Diâlionnaire
des Arbres & Arbuftes. ( Base.)
ROSE. y^ye\ Rosier.
Rose de C ayenne. On appelle quelquefois
ainfi la Ketmie, des jardins.
Rose de Gueldre : nom vulgaire de 1’Obier
! à fleurs ftéril s.
Rose du Japon. C’eft I’Hortensie.
Rose de Jérico. Voyei Jérose.
Rose de noel. Ce nom fe donne vulgairement
à I’Elléeore à fleurs rofes.
Rose d’outremer ou Rose trémiêre.
C ’ tft I’Alcée rose. Voyei ce mot.
ROSEAU. A ru n d o .
Genre de plantes de la triandrie digynie & de la
famille des Graminées, qui réunit vingt-une efpèces
, dont pliifieurs croiflent naturellement en
France, & doivent être, fousplufieurs rapports,
l’objet des confédérations des cultivateurs* elles (e
cultivent d’ailleurs dans nos écoles de botanique.
Il eft figuré pl. 46 des Illufirations des genres cfd
Lamarck.
■Obfervations.
C e genre fe rapproche infiniment de celui des
Bamboux, & peut-être n’en doit-il pas être
diftingué, puifque le nombre des étamines varie.
Ii fe rapproche encore plus de I’Arundinaire de
Michaux. Un A lpiste lui a été réuni. Voyei
ces mots.
Efpéees.
1. Le Roseau à quenouille, vulgairement grand'
rofeau.
Arundo donax. Linn. if Du* midi de l’Europe.
2. Le Roseau ftolonifère.
Arundo fiolonifera. Bofc. If De l’Égypte.
3. Le Roseau à balai.
Arundo pkragmites. Linn. if Indigène.
4. Le Roseau à fleurs de fétuque.
Arundo fefiucoides; Desf. if De-la côte de Barr
barie.
y. Le Roseau diftique.
Arundo bifaria. Retz, if Des Indes.
' 6. Le Roseau à fleurs d’airà.
Arundo- airoides. Lam. if De i’Amérique fep-
tentrionale.
7. Le Roseau du Bengale.
Arundo bengalis- Retz, if Du Bengale.
8. Le Roseau vert-jaunâtre.
Arundo fiavefeens. Lam. if De l’Amérique méridionale
* x . a
9. Le Roseau a petites fleurs.
Arundo micrantha. Lam. if De la côte de Barbarie^
I _ _ I .
10. Le Roseau kark.
Arundo karka. Retz, if Des. Indes.
11. LéRosEAU plumeux.
Arundo calamagroftis. Linn. if Indigène. |
12. Le Roseau des bois.
Arundo epigejos. Linn. if Indigène.
13. Le Roseau des fables, vulgairement oyat.
Arundo arenaria. Linn. ^Indigène.
14. Le Roseau panaché.
Arundo bicolor. Desf. if De 1a Barbarie,
iy. Le Roseau à panicule roide.
Arundo firicia. Roth. i fD e l’A lemagne.
16. Le Roseau du Canada.
Arundo canadenfis. Mich. if De l'Amérique
feptentrionale.
17. Le Roseau rugi.
Arundo rugi. Mol. if Du Chili.
18. Le Roseau quila.
Arundo quila. Mol. if Du Chili.
19. Le.Roseau de Valdivia.
Arundo Valdivia. Mol. if Du Chili.
20. Le Roseau à longue arête.
Arundo confpicua. Eorft. if Des îles de la mer
du Sud.
21. Le Roseau fagitté.
Arundo fagittata. Aubl. if De Cayenne.
Culture.
Le Rofeau en quenouille fe cultive très-^abon-
damment fur le bord des eaux , ou dans les terres
fraîches, profondes & légères, dans les parties
méridionales de l’Europe , où les tiges fervent à
un grand nombre d’ ufages , esitr’autres pour
faire des paliffades, des claies , des échalas, ce à
quoi elles font très-propres par leur folidité &
leur durée* elles fe coupent tous les ans pendant
l’hiver * car fi on les laifloit fur pied , outre
qu'elles ne groffiroient pas, elles fe brancheroient
de manière à n’être plus aufli avantageufement employées
i
A raifon de la difpofition traçante de fes racines,
ce Rofeau eft très-propre à défendre de la
dévaftation des eaux les bords des torrens. Cette
difpofition fait qu’ il faut fouvent les arrêter,
fans quoi elles s’empareroient de tout le terrain
environnant. Ses feuilles font fort du goût des
beftiaux, furtout dans leur jeuneffe.
Le département des Bouches-du-Rhône eft celui
où on le cultive le plus abondamment, & c’eft
lui qui en fournit à tout le nord de la France*
cependant fes tiges n’y mûriffent pas également
bien tous les ans, & alors il faut les tirer du midi
de l’Italie ou du midi de l’Èfpagne.
On reconnc-ît qu’une tige de Rofeau à quenouille
a été cueiilie en complète maturité, à fa
couleur d’ un jaune-pfille foncé, fans nulle partie
verdâtre ou brunâtre.
■ Ce Rofeau abandonné à lui même fleurit au
bout de quelques années, mais on n’emploie jamais
fes graines pour le multiplier ; ce font fes
rejetons , levés pendant l'hiv e r , qui fervent ex-
clulïvement à cet ufage. Les nouvelles plantations
ne commencent à donner de bons produits qu’à
la troifième année, & ne fub.fi fient en complète
valeur que fix à huit ans, à moins qu’on les laifîe
s'étendre fur leurs bords & périr au centre.
Quelqu’abondant que foie le Rofeau à quenouille
dans le Midi , il ne l'eft pas encore affez
pour les befoins du commerce, & il eft à defirëf
que le nombre des perfonnes qui fe livrent à. fa
culture s’augmente.
A Paris & plus au nord, cette efpèce de Rofeau
n'a pas affez de chaleur pour amener fes tiges
à maturité, de forte qu’ il n’y eft qu’une culture
û’agrément. L’effet qu'il produit dans les jardins
payfagers doit engager à l’y introduire, quoiqu’ il
n’y fleuri fie jamais. On le place dans le voifinage
des eaux, contre une fabrique expofée au midi. Ses
tiges fe coupent aux approches des froids. Pour
pouvoir défendre fes racines de l'effet des gelées,
on les couvre de fougère, de feuilles lè ches
ou de litière. Sa multiplication a lieu comme
dans le Midi 5 mais elle ne réuflit pas aufli bien ,
& fpuvent même, lever des oeilletons autour
d’un vieux pied, fuflit pour le faire périr.
• Peut-être feroit-il avantageux de planter ce
Rofeau dans les fables humides, pour employer
fes feuilles à la nourriture des beftiaux. On pour-
roit probablement les couper deux fois dans le
courant de l’été , fans faire périr les pieds.
Il exifte une variété à feuilles panachées du R ofeau
à quenouille , qui vient de l'Inde, qui eft
beaucoup plus foible 8c plus fenfible au froid que
lui ; on doit la tenir en pot, lui donner tous les
ans de la nouvelle terre , 8c la rentrer dans l'orangerie
pendant l’hiver. Les oeilletons avec lesquels
on la reproduit, exigent une couche à châflis
pour reprendre.
Le Rofeau ftolonifère a été apporté par les bo-
taniftes qui faifoient partie de l’expédition militaire
d’Égypte. Il fe cultive au Jardin du Mu-
féum, où il eft frappé par les premières gelées
de l’automne. Il reffemble beaucoup au précédent,
mais a la tige moins groffe & les feuilles moins larges.
Ce qui l’en diftingué le plus, c’eft qu’il pouffe,
outre fes tiges droites, des tiges couchées, q u i,
l’année fuivante, prennent racines à tous leurs
noeuds, de manière qu’un feul pied peut couvrir,
en peu d’années, une furface confidérabîe. Je ne
doute pas qu’il feroit d’ un emploi fort avantageux
pour fixer les fables des bords de la mer dans les
pays chauds.
Le Rofeau à balai eft extrêmement abondant