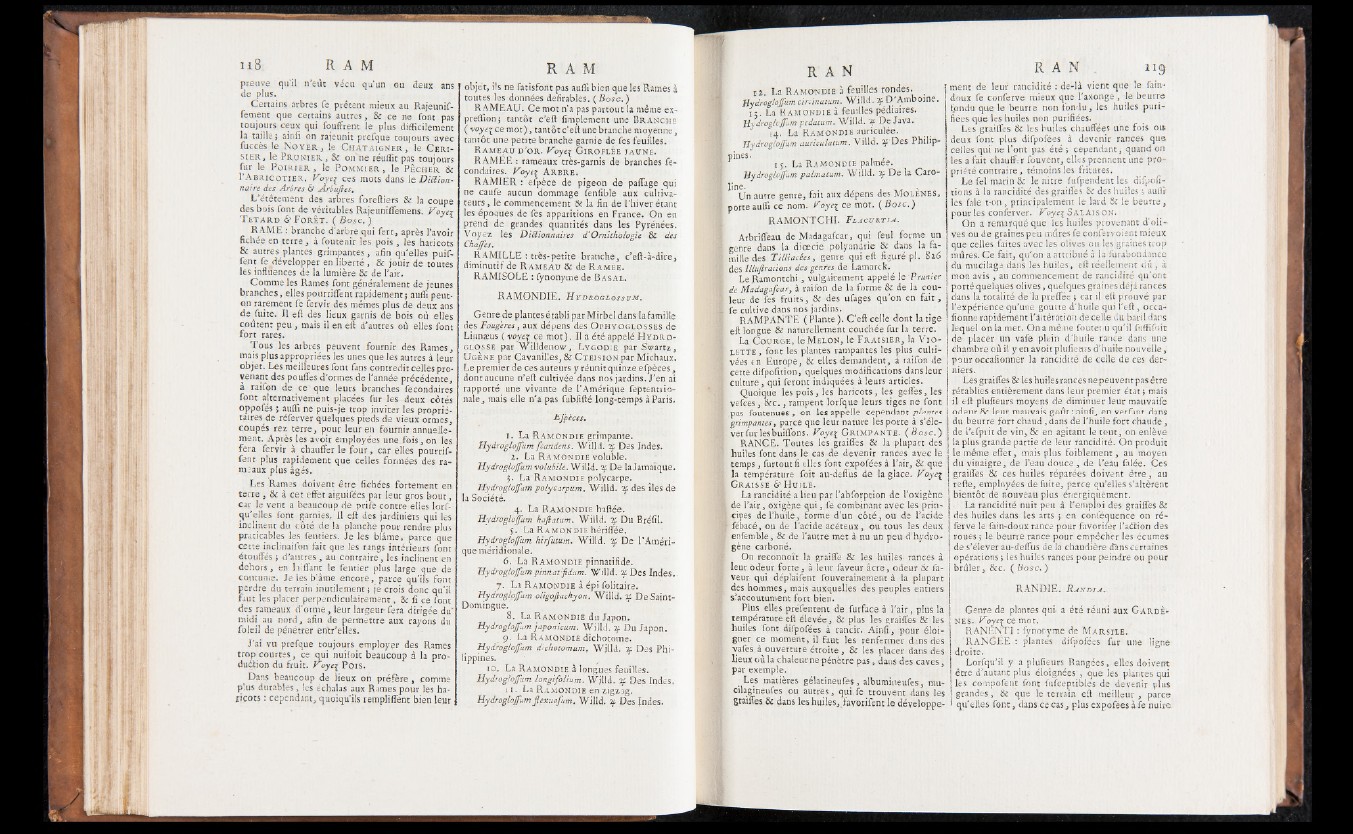
preuve qu'il n’eût vécu qu’un ou deux ans
de plus.
Certains arbres fe. prêtent mieux au Rajeunif-
fement que certains autres, & ce ne font pas
toujours ceux qui fouffrent le pius difficilement
la taille; ainfi on rajeunit prefque toujours avec
fuccès le No y e r , le Chataigner, le C eris
ier, le Prunier , & on ne réulfit pas toujours
fur le Po ir ie r , le Pommier, le Pêcher &
I’A bricotier. Koyej ces mots dans \s Dictionnaire
des Arbres & Ârbuftes,
L’étêtement des arbres forefiiers & la coupe
des bois font de véritables Rajeuniffemens. Foyer
T êtard & Forêt. ( Rose. )
RAME : branche d’arbre qui fert, après l’avoir
fichée en terre, à foutenir les p ois , les haricots
& autres plantes grimpantes, afin qu’elles puif-
fent fe développer en liberté , & jouir de toutes
les influences de la lumière & de l’air.
Comme les Rames font généralement de jeunes
branches, elles pourtiffentrapidement; aufli peut-
on rarement fe fervir des mêmes plus de deux ans
de fuite. Il efl des lieux garnis de bois où elles
coûtent p eu, mais il en eft d’autres où elles font
fort rares.
Tous les arbres peuvent fournir des Rames,
mais plus appropriées les unes que les autres à leur
objet. Les meilleures font fans contredit celles provenant
des pouffes d’ormes de l’année précédente,
à raifon de ce que leurs branches fecondaires
font alternativement placées fur les deux côtés
oppofés ; aulfi ne puis-je trop inviter les propriétaires
de réferver quelques pieds de vieux ormes,
coupés rez terre, pour leur en fournir annuelle-,
ment. Après les avoir employées une fo is , on les
fera fervir à chauffer le fo u r , car elles pourrif-
fent plus rapidement que celles formées des ra-
m:-aux plus âgés.
Les Rames doivent être fichées fortement en
terre , & à cet effet aiguifées par leur gros bout,
car le vent a beaucoup de prife contre elles Iorf-
qu’elles font garnies, 11 eft des jardiniers qui les
inclinent du côté de la planche pour rendre plus
praticables les fentiers. Je les blâme, parce que
cette inclinaifon fait que les rangs intérieurs font
étouffés ; d’autres, au contraire, les inclinent en
dehors, en biffant le fentier plus large que de
coutume. Je les blâme encore, parce qu’ils font
perdre du terrain inutilement ; je crois donc qu’il
faut les placer perpendiculairement, & fi ce font
des rameaux d’orme, leur largeur-fera dirigée du"
midi au nord, afin de permettre aux rayons du
foleil de pénétrer enfr’elles.
J’ai vu prefque toujours employer des Rames
trop courtes, ce qui nuifoit beaucoup à la production
du fruit. Foyer Pois.
Dans beaucoup de lieux on préfère , comme
plus durables, les échalas aux Rames pour les haricots
: cependant, quoiqu’ils rempliffent bien leur
objet, ils ne fatisfont pas auflî bien que les Rames à
toutes les données defirables. ( B osc.)
RAMEAUi C e mot n’a pas partout la même ex-
preflionj tantôt c ’eft Amplement une Branche
(voyei ce m ot), tantôt c’eft une branche moyenne,
tantôt une petite branche garnie de Tes feuilles.
Rameau d’or. Voye[ Giroflée jaune.
RAMEE : rameaux très-garnis de branches fecondaires.
f^oyei Arbre.
RAMIER : efpèce de pigeon de paffage qui
ne caufe aucun dommage fenfible aux cultivateurs
, le commencement & la fin de l’hiver étant
les époques de fes apparitions en France. On en
prend de grandes quantités dans les Pyrénées.
Voyez les Dictionnaires <L‘ Ornithologie & des
Chajfes.
RAMILLE : très-petite branche, c’eft-à-dire,
diminutif de Rameau & de Ramée.
RAMJSOLE : fynonyme de Basal.
RAMONDIE. H ydroglossum.
Genre de plantes établi par Mirbel dans la famille
des Fougères y aux dépens des Ophyoglosses de
Linnæus ( voye% ce mot). II a été appelé Hydro-
glosse par Willdenov/, Lygodie par Swartz,
UgÉne par Cavanille$,&CTEisioNpar Michaux.
Le premier de ces auteurs y réunit quinze efpèces,
dont aucune n’ eft cultivée dans nos jardins. J’en ai
rapporté une vivante de l’Amérique feptentrio-
nale ^ mais elle n’ a pas fubfifté long-temps à Paris.
Efpèces»
i . La Ramondie grimpante.
Hydroglojfum feandens. Willd. if Des Indes.
2. La Ramondie voluble.
Hydroglojfum volubile. Willd. 2(■ De la Jamaïque.
3. La Ramondie polycarpe.
Hydroglojfum polycarpum. Willd. if des îles de
la Société.
4. La Ramondie haftée.
Hydroglojfum hajlatum. Willd. If Du Bréfii.
y. La Ramondie hériffée.
Hydroglojfum hirfutum. Willd. if De l ’Améri-
que méridionale.
6 . La Ramondie pinnatifide.
Hydroglojfumpinnat'Jidum. Willd. If Des Indes.
7. La Ramondie à épi folitaire.
Hydroglojfum oligojiachyon, Willd. 7f De Saint-
Domingue.
8. La Ramondie du Japon.
Hydroglojfum japonicum. Willd. if Du Japon.
9. La Ramondie dichotome.
Hydroglojfum dichotomum. Willd. if Des Philippines.
10. La Ramondie à longues feuilles.
Hydroglojfum longifolium. Willd. if Des Indes,
11. La Ramondie en zigzag.
Hydroglojfum fiexuofum. Willd. if Des Jndes.
12. La Ramondie à feuilles rondes. ^ i
Hydroglojfum circinatum. Willd. If D’Amboine.
is . La Ramondie à feuilles pédiaires.
Hydroglojfum pedatum. Willd. 2{■ De Java.
14. La Ramondie auriculée.
Hydroglojfum auriculatum. Villd. ‘i f Des Philippines.
, ,
15. La Ramondie palmee.
Hydroglojfum palmatum. Willd. if D e là Caro-
Un autre genre, fait aux dépens des Molénes,
porteaufii ce nom. Foye[ ce mot. (B o s c .)
RAMONTCHI. Fl a c u r t i a .
Arbriffeau de Madagafcar, qui feul forme un
genre dans la dioecie polyandrie & dans la famille
des Tilliacées, genre qui eft figuré pl. 826
des Illufiraiions des genres de Lamarck.
LeRamontchi, vulgairement appelé le Prunier
de Madagafcar3 à raifon de la forme & de la couleur
de fes fruits, & des ufages qu’on en fa it ,
fe cultive dans nos jardins.
RAMPANTE (Plante). C ’eft celle dont la tige
eft longue & naturellement couchée fur la terre.
La Courge, le Melon, le Fraisier, la Vio lette
, font les plantes rampantes les plus cultivées
en Europe, & elles demandent, à raifon de
cette difpofition, quelques modifications dans leur
culture, qui feront indiquées à leurs articles.
Quoique les pois, les haricots, les geffes, les
vefees, & c . , rampent lorfque leurs tiges ne font
,pas foutenues , on les appelle cependant plantes
grimpantes y parce que leur nature les porte à s’élever
fur les buiflons. Hoyei Grimpante. ( B osc.)
RANCE. Toutes les graiffes & la plupart des
huiles font dans le cas de devenir rances avec le
temps, furtout fi elles font expofées à l’air, & que
la température foit au-deflus de la glace. Ho.ye^
Graisse & Huile.
La rancidité a lieu par l’abforption de l’oxigène
1 de l’air, oxigène qui, fe combinant avec les prin-
| cipes de l’huile, forme d’un cô té , ou de l’acide
f-fébacé, ou de l ’acide acéteux, ou tous les deux
! enfemble, & de l’autre met à nu un peu d’hydrogène
carboné.
On reconnoît la graiffe & les huiles rances à
, leur odeur for.te, à leur faveur âcre, odeur & fa^
veur qui déplaifent fouverainement à la plupart
des hommes, mais auxquelles des peuples entiers
s’accoutument fort bien.
Plus elles préfentent de furface à l’air, plus là
température eft élevée,. & plus les graiffes & les
huiles font difpoféès à rancir. Ainfi, pour éloigner
ce moment, il faut les renfermer dans des
vafes. à ouverture étroite, & les placer dans des
lieux où la chaleur ne pénètre pas, dans des caves,
par exemple. 3 Les matières gélatineufes, albumineufes, mu-
cilagineufes ou autres, qui fe trouvent dans les
graiffes & dans les huiles, favorifent le développement
de leur rancidité : de-là vient que le fain»
doux fe conferve mieux que l’axonge, le beurre
tondu que le beurre non fondu, les huiles purifiées
que les huiles non purifiées.
Les graiffes & les huiles chauffées une fois 01»
deux font plus difpoféès à devenir rances que
celles qui ne l’ont pas été j cependant, quand on
les a fait chauff.r fouvent, elles prennent une propriété
contraire, témoins les fritures.
Le fel marin & le nitre fufpendent les difpofi-
tions à la rancidité des graiffes & des huiles s aufiï
les Taie t-on, principalement le lard & le beurre,
pour les conferver. Hoye^ Salaison.
On a remarqué que les huiles provenant d’olives
ou de graines peu mûres fe confervoient mieux
que celles faites avec les olives ou les graines trop
mûres. Ce fait, qu’on a attribué à la furabondance
du mucilage dans les huiles, eft réellement dû , à
mon avis , au commencement de rancidité qu’ont
porté quelques olives, quelques graines déjà rances
dans la totalité de la preffée j car il eft prouvé par
l’expérience qu’une goutte d’huile qui l’eft, occa-
fionne rapidement réitération de celle du baril dans
lequel on la met. On a même foutenu qu’il fuffifoit
de placer un vafe plein d ’huile rance dans une
chambre où il y en avoit plufietus d’huile nouvelle,
pour occafionner la rancidité de celle de ces derniers.
Les graiffes & les huiles rances ne peuvent pas être
rétablies entièrement dans leur premier état} mais
il eft plufieurs moyens de diminuer leur mauvaife
odeur & leur mauvais goût : ainfi, en verfant dans
du beurre fort chaud, dans de l’huile fort chaude,
de l’cfprit de vin, & en agitant le tout, on enlève
la plus grande partie de leur rancidité. On produit
le même effet, mais plus foiblement, au moyen
du vinaigre, de l’eau douce, de l’eau falée. Ces
graiffes & ces huiles réparées doivent ê tre , au
refte, employées de fuite, parce qu’elles s’altèrent
bientôt de nouveau plus énergiquement.
La rancidité nuit peu à l’emploi des graiffes &
des huiles dans les arts j. en conféquence on ré-
ferve le fain-doux rance pour favorifer l’aûion des
roues j le beurre rance pour empêcher les écumes
de s’élever au-deffus de la chaudière dans certaines
opérations > les huiles rances pour peindre ou pour
brûler, &c. (B o s c .)
RANDIE. Ra n d ia ..
Genre de plantes qui a été réuni aux G a r d é -
NES.. Voye% ce mot.
RANENTI : fynonyme de Marsile.
RANGÉE : plantes difpoféès fur line ligne
droite.
Lorsqu’ il y a plufieurs Rangées,. elles doivent
être d’autant plus éloignées , que les plantes qui
les compofent font fufceptibles de devenir plus
grandes, & que le terrain eft meilleur, parce
qu’ elles font, dans ce cas, plus expofées à Te nuire