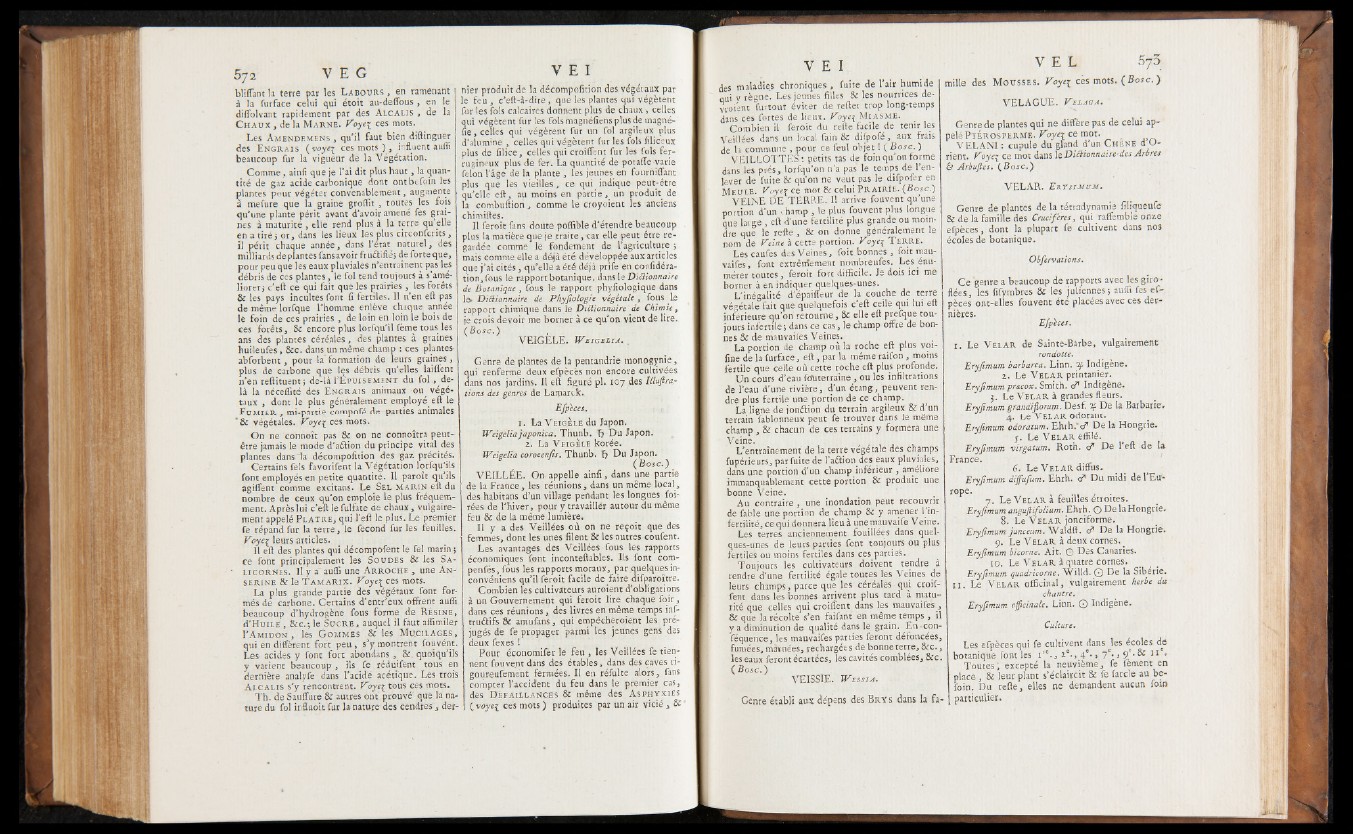
bliffant la terre par les L abours , en ramenant
à la furface celui qui étoit au-deffous, en le
difïolvant rapidement par des A lca lis , de la
C h a u x , de la Ma r n e . Voye^ ces mots.
Les A mende mens , qu’ il faut bien diftinguer
des En g r a is ( voye{ ces mots ) , influent auffi
beaucoup fur la vigueur de la "Végétation.
Comme Û ainfi que je l’ ai dit plus hau t, la quantité
de gaz acide carbonique dont ontbefoin les
plantes pour végéter convenablement, augmente
a mefure que la graine groffit , toutes les fois
qu’une plante périt avant d’avoir amené fes graines
à maturité , elie rend plus à la terre qu’elle
en a tiré} o r , dans les lieux les plus circonfcrits ,
il périt chaque année , dans l’état naturel, des
milliards de plantes fans avoir fructifies de forte que,
pour peu que lés eaux pluviales n’entraînent pas les
débris de ces plantes, le fol tend toujours à s’améliorer
j c’eft ce qui fait que les prairies , les forêts
& les pays incultes font fi fertiles. Il n’en eft pas
de même lorfque l’ homme enlève chaque année
le foin de ces prairies , de loin en loin le bois de
ces forêts, & encore plus lorfqu’ il fème tous les .
ans des plantes céréales, des plantes à graines
huileufes, & c . daiislun même champ : ces plantes-
abforbent, pour la* formation de leurs graines,
plus de carbone que les débris qu’elles laiflenc
n’en reftituentj de-là I’É puisement du fol , delà
la néceflité des E n g r a is animaux ou végétaux
, dont le plus généralement employé eft le
F u m ie r , mi-partie compofé de parties animales
*& végétales. Voye£ ces mots.
On ne connoît pas & on ne connoîtra peut-
être jamais le mode d’aCtion du principe vital des
plantes dans~ta décompofition des gaz précités.
Certains fels favorifent la Végétation lorfqu’ils
font employés en petite quantité. Il paroît qu’ils
agiffent comme excitans. Le Sel m a r in eft du
nombre de ceux qu’on emploie le plus fréquemment.
Après lui c ’eft le fulfate de chaux, vulgairement
appelé Pl â t r e , qui l ’eft le plus. Le premier
fe répand fur la terre, le fécond fur les feuilles.
Voyeç leurs articles.
Il eft des plantes qui décompofent le fel marin ;
ce font principalement les S oudes & les S a l
ic o r n e s . II y a' auffi une A rro che , une A n -
serine & le T a m a r ix . Voyei ces mots.
La plus grande partie des végétaux font formés
de carbone. Certains d’entr’ eux offrent auffi
beaucoup d’hydrogène fous forme de Rés ine,
d’HuiLE, & c .; le Su c r e , auquel il faut affimiler
I’A midon , les G ommes & les Mucilages ,
qui en different fort p eu , s’y montrent fouvént.
Les- acides y font fort abondans , & . quoiqu’ ils
y varient beaucoup, ils fe téduifent tous en
dernière analyfe dans l’ acide acétique. Les trois
A l c a l i s s'y rencontrent. Voyeç tous ces mots.
Th. de Sauffure & autres ont prouvé que la nature
du fol infiuoit fur la nature des cendres, dernier
produit de la décompofition des.végétaux par
le feu , c’eft-à-dire, que les plantes qui végètent
fur les fols calcaires donnent plus de chaux, celles
qui végètent fur les fols magnéfiens plus de magné-
fie , celles qui végètent fur un fol argileux plus
d’alumine , celles qui végètent fur les fols filiceux
plus de filice, celles qui croiffent fur les fols ferrugineux
plus de fer. La quantité de potaffe-yarie
félon l’âge de la plante , les jeunes en fourniffant
plus que les vieilles, ce qui indique peut-être
qu’ elle e ft, au moins en partie, un produit de
la combuftion, comme le croyoient les anciens
chimiftes.
Il feroit fans doute poffible d’étendre beaucoup
plus la matière que je .traite, car elle peut être regardée
comme le fondement de l’agriculture >
mais comme elle a déjà été développée aux articles
que j’ ai cités, qu’elle a été déjà prife en confidéra-
tion,fous le rapport botanique, dans le Diâionnaire
de Botanique , fous le rapport phyfiologique dans
la. Diéiionnaire de Phyfiologie végétale , fous le
rapport chimique dans le DiHionnaire de Chimie,
je crois devoir me borner à ce qu’on vient de lire.
(B o s c . ) ,
VEIGELE. We ig eh a ,. .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie,
qui renferme deux efpècès non encore cultivées
dans nos jardins. Il eft figuré pl» 107 des Illufira,-
lions des genres de Lamarck.
Efpec.es.
1. La V eigÉle du Japon.
TVeigeliajaponica. Thunb. Du Japon.
2. La V eigèle korée.
IVeigelia coroeenfis. Thunb. I7 Du Japon.
* ' (B o s e .)
V EILLÉE. On appelle ainfi, dans une partie
de la France , les réunions > dans un même local,
des habitans d’un village pendant les longues Moirées
de l’hiver» pour y travaillër autour du même
feu & de la même lumière.
Il y a des Veillées où on ne reçoit que des
femmes, dont les unes filent & les autres coufent.
Les avantages des Veillées fous les rapports
économiques font inconteftables. Ils font com-
penfés, fous les rapports moraux, pa r ^quelques in-
convéniens qu’ il feroit facile de faire difparoître.
Combien les cultivateurs auroient d’obligations
à un Gouvernement qui feroit lire chaque foir,
dans ces réunions, des livres en même temps inf-
tru&ifs & amufans, qui empêcheroient les préjugés
de fe propager parmi les jeunes gens des
deux fexes l . . .
Pour économifèr le feu , les Veillées fe tiennent
Couvent dans des étables, dans des caves ri-
goureufemènt fermées. Il en réfulte alors, fans
compter l’accident du feu dans le premier cas,
des D é fa illanc es & même des A sphyxies
I C P P f ces mots ) produites par un air vicié a &
des maladies chroniques, fuite de l’air humide
qui v règne’. Les jeunes filles & les nourrices dev
a ien t furtout éviter de refter trop long-temps
dans ces fortes de lieux. Voye\ Mia sm e .
Combieu il feroit du reine facile de tenir les
Veillées dans un local fain & difpofé, aux frais
de la commune , pour ce feul objet ! ( B o s c .)
V E IL LO T T E S : petits tas de foin qu’on forme
dans les prés, lorfqu’on n’a pas le temps de l’enlever
de fuite & qu’on ne veut pas le difpofer en
Meu le. Voye% ce mot & celui P r a ir ie . {B osc.)
VEINE DE TERRE. Il arrive fouvent qu’une
portion d’ un ^hamp , le plus fouvent plus longue
que la rge, eft d’une fertilité plus grande ou moindre
que le refte , & on donne généralement le
nom de Veine à cette portion. Ko yq T erre.
Les caufes des Veines, foit. bonnes , foit mauvaifes,
font extrêmement nombreufes. Les énumérer
toutes, feroit fort difficile. Je dois ici me
borner à en indiquer quelques-unes.
L’ inégalité d’épaiffeur de la couche de terre
végétale fait que quelquefois c’eft ceile qui lui eft
inférieure qu’on retourne, & elle eft prefque toujours
infertile5 dans ce cas, le champ offre de bonnes
& de mauvaifes Veines.
La portion de champ où la roche eft plus voi-
fine de la furface, e ft, par la même raifon , moins
fertile que celle où cette roche eft plus profonde.
Un cours d’eau fdüterraine , ou les infiltrations
de l’eau d’ une rivière, d’ un étang, peuvent rendre
plus fertile une portion de ce champ.
La ligne de jonétion du terrain argileux & d’ un
terrain fablonneux peut fe trouver dans le même
champ, & chacun de ces terrains y formera une
Veine.
L’entraînement de la terre végétale des champs
fupérieurs, par fuite de l’aétion des eaux pluviales,
dans une portion d’ un champ inférieur , améliore
immanquablement cette portion & produit une
bonne Veine.
Au contraire, une inondation peut recouvrir
de fable une portion de champ & y amener 1 infertilité,
ce qui donnera lieu à unemauvaife Veine.
Les terres anciennement fouillées dans quelques
unes de leurs parties font toujours ou plus
fertilés ou moins fertiles dans ces parties.
Toujours les cultivateurs doivent tendre à
rendre d’une fertilité égale toutes les Veines dé
leurs champs, parce que les céréales qui croiffent
dans les bonnes arrivent plus tard à maturité
que celles qui croirfent dans les mauvaifes ,
& que la récolte s’ en faifant en même temps , il
y a diminution de qualité dans le grain. En-con-
féquence, les mauvaifes parties feront défoncées,
fumées, marnées, rechargées de bonne terre, & c . ,
les eaux feront écartées, les cavités comblées, & c .
( Bosc. )
VEISSIE. W essia.
Genre établi aux dépens des Br y s dans la famille
des M ou s se s . Voyei cês mots. (B o s c . )
V E LAGUE . V mlaca.
Genre de plantes qui ne diffère pas de celui appelé
Ptérosperme. Voye^ ce mot. ^
V E L AN I : cupule du gland d'un C hene d O-
rient. Voye% ce mot d&iis lQ Diftionnaire'des Arbres
& Arbuftes. {B o s c .)
V E LAR . Er y s im um .
Genre- de plantes de la tétradynamie fiiiqueufe
Sç de la famille des Crucifères, qui raffemble onze
efpèces, dont la plupart fe cultivent dans nos
écoles de botanique.
Obfervations.
C e genre a beaucoup de rapports avec les giroflées,
les fifymbres & les juliennes 5 auffi fes efpèces
ont-elles fouvent été placées avec ces dernières.
Efpèces.
I . Le V e l a r de Sainte-Barbe, vulgairement
rondotte.
Eryftmum barbarea. Linn. Indigène.
2. Le Velar printanier.
Eryfimum pr&cox. Smith, a* Indigène.
3. Le Velar à grandes fleurs.
Eryfimum grandiflorum. Desf. De la Barbarie*
4. Le Velar odorant.
Eryfimum odoratum. Ehrh.'cr’’ De la Hongrie.
5. Le V elar effilé.
Eryfimum virgatum. Roth, De 1 eft de la
France.
6 . Le Velar diffus.
Eryfimum difiufum. Ehrh. d* Du midi de l’Europe.
. . .
7. Le V e l a r à feuilles étroites.
Eryfimum angufiifolium. Ehrh. O D elaHongrie.
8. Le Velar jonciforme.
Eryfimum j une eum. Waldft. d^ De la Hongrie.
9. Le V elar à deux cornes.
Eryfimum bicorne. Ait. G) Des Canaries.
10. L e V elar à quatre cornes.
Eryfimum quadricorne. Wàlld. (•) De la Sibérie.
I I . Le V elar officinal, vulgairement herbe du
chantre.
Eryfimum officinale. Linn. O Indigène.
Culture.
Les efpèces qui fe cultivent dans les ecolès de
botanique font les i re. , i c., 4e* » 7e* j 9** ^ 11 r
Tou tes; excepté la neuvième, fe fement en
place , & leur plant s’éclaircit & fe farcie au be-
foin. Du refte, elles ne demandent aucun foin
particulier.