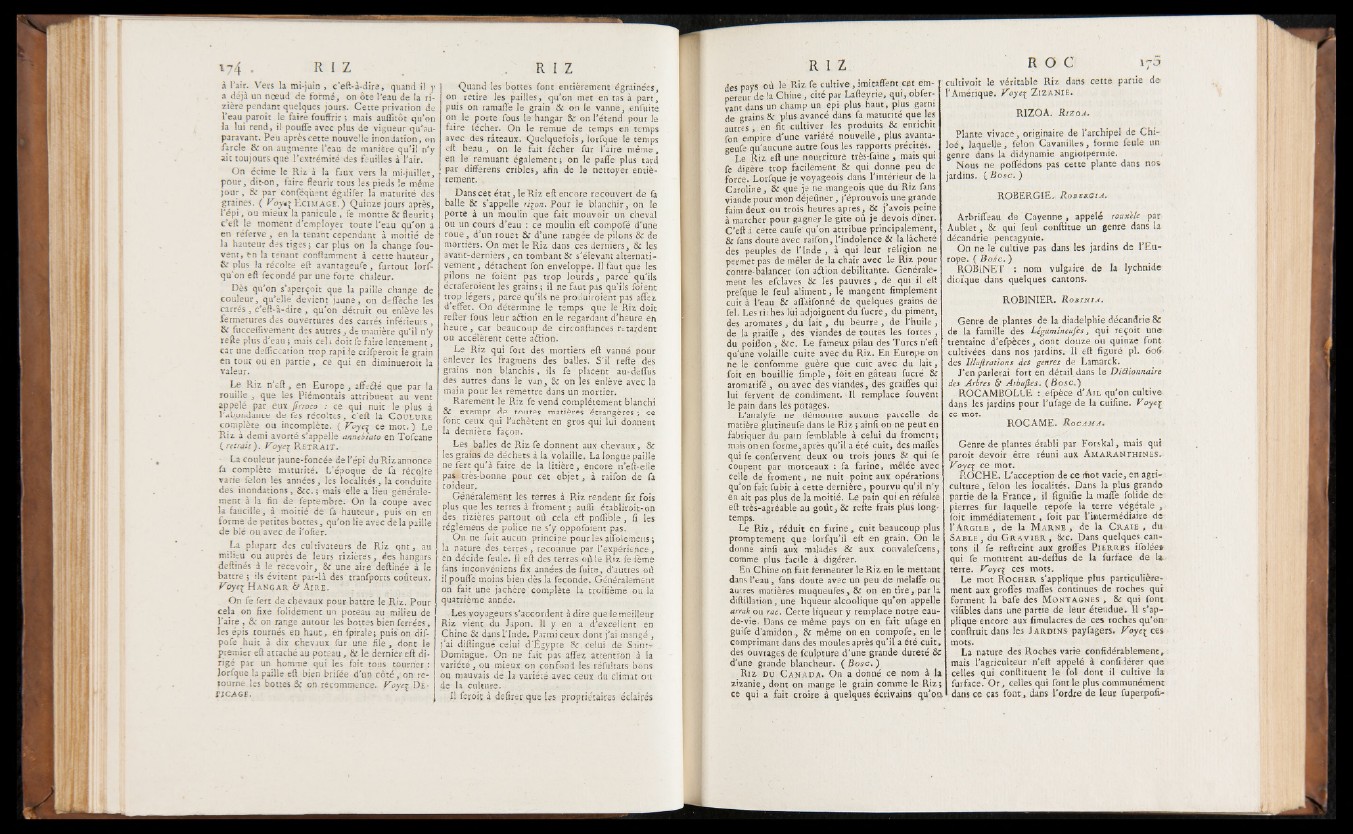
174 • R I Z
à l’air. Vers la mi-juin, c’eft-à-dire, quand il y
a déjà un noeud de formé, on ôte l’eau de la rizière
pendant quelques jours. Cette privation de
l’eau paroît le faire fouffrir ; mais auffitôt qu’on
la lui rend, il pouffe avec plus de vigueur qu’au-
paravant. Peu après cette nouvelle inondation, on
farcie & on augmente l’eau de manière qu’il n’y
ait toujours que l’extrémité des feuilles à l’air.
On écime le Riz à la faux vers la mi-juillet,
pour, dit-on, faire fleurir tous les pieds le même
jour, & par conséquent égalifer la maturité des
graines. ( V Ecimage.) Quinze jours après,
l’epi, ou mieux la panicule , fe montre & fleurit 5.
c’eft le moment d’employer toute l’eau qu’on a
en réferve, en la tenant cependant à moitié de
la hauteur des tiges j car plus on ja change fou-
vent, en la tenant conftamment à cettehauteur,
& plus la récolte eft avantageufe, furtout lôrf-
qu’on eft fécondé par une forte chaleur.
Dès qu’on s’aperçoit que la paille change de
couleur, qu’elle devient jaune, on deffèche les
carrés , c’eft-â-dire , qu’on détruit ou enlève les
fermetures des ouvertures des carrés inférieurs, :
& fucceflivement des autres, de manière qu’il n’y
refte plus d’eau ; mais cela doit fe faire lentement,
car une defliccation trop rapide crifperoit le grain j
en tout où en partie, ce qui en diminueroit la
valeur.
Le Riz n’eft, en Europe, affrété que par la
rouille , que les Piémontais attribuent au vent
appelé par eux Jirroco : ce qui nuit - le plus à
l'abondance de fes récoltes, c’eft la C oulure
complète ou incomplète. ( Voye^ ce mot. ) Le
Riz a demi avorté s’appelle an.nehiq.to en Tofcane
( retrait) . Voye£ RETRAIT.
- La couleur jaune-foncée de l’épi du Riz annonce
fa complète maturité. L’époque de fa récqjte
varie félon les années, les localités, la conduite
des inondations, &c. ; mais elle a lieu généralement
à la fin de feptembre. On la coupe avec
la faucille, à moitié de' fa hauteur, puis on en
forme de petites bottes, qu’on lie avec de la paille
de blé ou avec de i’ofier.
La plupart des cultivateurs de Riz ont, au
milieu ou auprès de leurs rizières, des hangars
deftinés à le recevoir, & une aire deftinéé à le
battre} ils évitent par-là des traofports coûteux.
Voye£ Hanqar & Air e .
On fê fert de chevaux pour battre le Riz. Pour
cela on fixe folidement un poteau au milieu de I
l’aire , & on range autour les bottes bien ferrées,
les épis tournés en haut, en fpirale; puis"on dif-
pofe huit à dix chevaux fur une file, dont le
premier eft attaché au poteau, & le dernier eft dirigé
par un homme qui lés fait tous tourner :
lorfque la paille eft bien brifée d’un côté, on retourne
les bottes & on recommence. Voye% DÉ-
fJCAGE.
R I Z
Quand les battes font entièrement égrainées,
on retire les pailles, qu’on met en tas à part,
puis on ramafl’e le grain & on le vanne, enfuite
on le porte fous le hangar & on l’étend pour le
faire fécher. On le remue de temps en temps
avec des râteaux. Quelquefois, lorfque le temps
1 eft beau, on le fait fécher fur l’aire même,
en le remuant également} on le paffe plus tard
par différens cribles, afin de le nettoyer entièrement.
.
Dans cet état, le R iz eft encore recouvert de fa
balle & s’appelle ri^on. Pour Je blanchir, on le
porte à un moulin que fait mouvoir un cheval
ou un cours d’eau : ce moulin eft compofé d’une
roue, d’un rouet & d’une rangée de pilons & de
mortiers. On met le Riz dans ces derniers, & les
avant-derniers, en tombant & s’élevant alternativement
, détachent fon enveloppe. Il faut que les
pilons ne foient pas trop lourds, parce qu’ils
écraferoient les grains ; il ne faut pas qu’ils foient
trop légers, parce qu’ ils ne produiroient pas affez
d’effet. On déterminé le temps que le Riz doit
refter fous leur aétion en le regardant d’heure en
heure, car beaucoup de circonftances retardent
ou accélèrent cette aétion.
Le Riz qui fort des mortiers eft vanné pour
enlever les fragmens des balles. S’ il refte des
grains non blanchis, ils fe placent au-deffus
des autres dans le van, & on les enlève avec la
main pour les remettre dans un mortier,
j Rarement le Riz fe vend complètement blanchi
i & exempt de toutes matières étrangères} ce
font ceux qui l’achètent en gros qui lui donnent
la dernière façon.
Les balles de Riz fe donnent aux chevaux, &
les grains de déchets à la volaille. La longue paille
ne fert qu’ à faire de la litière, encore n’eft-elle
pas, très-bonne pour cet objet, à raifon de fa
ioideur.. .
Généralement les terres à Riz rendent fix fois
plus que les terres à froment} auffi établiroit-on
des rizières partout où cela eft- poflible, fi les
réglemens de police ne s’y oppofoient pas.
On ne fuit aucun principe pour les affolemens ;
la nature des terres, reconnue par l’expérience,
en décide feule. Il eft des terres où le Riz fe fème
fans inconvéniens fix années de fuite, d’autres où
il pouffe moins bien dès la fécondé. Généralement
on fait une jachère complète la troifième ou la
quatrième année.
Les voyageurs s’accordent à dire que Je meilleur
Riz vient au Japon. Il y en a d’excellent en
Chine & dans l’Inde. Parmi ceux dont j’ai mangé ,
j’ai diftingué celui d’Égypte & . celui de Saint-
Domingue. On ne fait pas affez attention à la
v ariété, ou mieux on confond les réfultats bons
ou mauvais de la variété avec ceux du climat ou
de la culture.
Il feroif à defirer que les propriétaires éclairés
des pays où le Riz fe cultive, imitaffeht cet empereur
de la Chine, cité par Lafteyrie, qui, obfer-
vant dans un champ un épi plus haut, plus garni
de grains & plus avancé dans fa maturité que les
autres}.en fit cultiver les produits, & enrichit
fon empire d’une variété nouvelle, plus avantageufe
qu’aucune autre fous les rapports précités.
Le Riz. eft une nourriture très-faine , mais qui
fe digère trop facilement & qui donne peu de
force. Lorfque je voyageois dans l’ intérieur de la
Caroline, & que je ne mangeois que du Riz fans
viande pour mon déjeûner, j’éprouvois une grande
faim deux ou trois heures après, & j’ avqis peine
à marcher pour gagner le gîte où je devois dîner.
C ’eft à cette caufe qu’on attribue principalement,
& fans doute avec raifon, l’ indolence & la lâcheté
des peuples de l’ Inde , à qui leur religion ne
permet pas de mêler de la chair avec le Riz pour
comre-balancer fon aélion débilitante. Généralement
les efclaves & les pauvres, de qui il eft
prefque le feul aliment, le mangent fimplement
cuit à l’eau & affaifonné de quelques grains de
fel. Les riches lui adjoignent du fucre, du piment,
des aromates, du la it , du beurre, de i’huile,
de la graiffe , des viandes de toutes les forces,
du poiffon, & c . Le fameux pilau des Turcs n’eft
qu’une volaille cuite avec du Riz. En Europe on
ne le confomme guère que cuit avec du laie,
foit en bouillie fimple, fôit en gâteau fucré 8:
aromatifé, ou avec des viandes, des graiffes qui
lui fervent de condiment. Il remplace fouvent
le pain dans les potages.
L’analyfe ne démontre aucune parcelle de
matière glutineufe dans le Riz j ainfi on ne peut en
fabriquer du pain femblable à celui du froment}
mais on en forme, après qu’ il a été cuit, des maffes
qui fe confervent deux ou trois jours & qui fe
coupent par morceaux : fa farine, mêlée avec
celle de froment, ne nuit point aux opérations
qu’on fait fubir à cette dernière, pourvu qu’ il n’ y
en ait pas plus de la moitié. Le pain qui en réfui ce
eft très-agréable au goût, & refte frais plus longtemps.
Le R iz , réduit en farine, cuit beaucoup plus
promptement que lorfqu’il eft en grain. On le
donne ainfi aux malades & aux convalefcens,
comme plus facile à digérer.
En Chine on fait fermenter le R iz en le mettant j
dans l’eau, fans doute avec un peu de mélaffe ou
autres matières muqueufes, & on en tire , par la
diftillation, une liqueur alcoolique qu’ on appelle
arrak ou rac. Cette liqueur y remplace notre eau-
de-vie. Dans ce même pays on en fait ufage en
guife d’amidon., & même on en compofe, en le
comprimant dans des moules après qu’ il a été cuit,
des ouvrages de fculpture d’une grande dureté &
d’une grande blancheur. ( B ose. )
R iz dü C a n a d a . On a donné ce nom à la
zizanie, dont on mange le grain comme le Riz}
ce qui a fait croire à quelques écrivains qu’ on
cultivoit le véritable Riz dans cette partie de»
l’Amérique. Voye% Z iz a n ie .
R1ZOA. R i z oa.
Plante vivace, originaire de l’archipel de Chi-
lo é , laquelle, félon Cavanilles-, forme feule un
genre dans la didynamie angiolpermie.
Nous ne poffédons pas cette plante dans no*
jardins. C Bosc. )
ROBERGIE. R ob ergia.
Arbriffeau de Cayenne , appelé rouxele par
A u b le t, & qui feul conftitue un genre dans la
décandrie pentagynie.
On ne le cultive pas dans les jardins de l’Europe.
( Rose. )
ROBINET : nom vulgaire de la Iychnide
dioïque dans quelques cantons.
ROBINIER. R o b in ia .
Genre de plantes de la diadelphie décandrie &
de la famille des Légumincufes, qui reçoit una
trentaine d’efpèces, dont douze ou quinze font
cultivées dans nos jardins. Il eft figuré pl. 6o(r.
des Illuflratiôns des genres de Lamarck.
J’en parlerai fort en détail dans le Diâtionnaire
des Arbres & Arbuftes. (B o s e .)
ROCAMBOLLE : efpèce d’AiL qu’on cultive
dans les jardins pour l’ufage de la cuifine. Voy*£
ce mot.
ROCAME. R o c am a .
Genre de plantes établi par Forskal, mais qui
paroît devoir être réuni aux A m a r an th in e s .-
Voyeç ce mot.
( ROCHE. L’acception de ce rfcot varie, en agriculture
, félon les localités. Dans la plus grand©
partie de la France, il fignifie la maffe folide de
pierres fur laquelle repofe la terre végétale ,
foit immédiatement , foit par l’intermédiaire de
1’A rgile , de la M a rn e , de la Gr a ie , du
Sa b le , du G r a v ie r , &c. Dans quelques cantons
il fe reftreint aux groffes Pie rre s ifolée*
qui fe montrent au-deffus de la furface de la
terre. Voyei ces mots.
Le mot Rocher s’applique plus particulièrement
aux groffes maffes continues de roches qui
forment la bafe des Montagnes , & qui font
vifibles dans une partie de leur étendue. Il s’applique
encore aux ftmulacres de ces roches qu’on
conftruit dans les Jardins payfagers. Voye[ ces
mots.
La nature des Roches varie confidérablement,
mais l’agriculteur n’eft appelé à eonfidérer que
celles qui conftituent le fol dont il cultive la
furface. O r , celles qui font le plus communément
dans ce cas font* dans l’ordre de leur fuperpofr