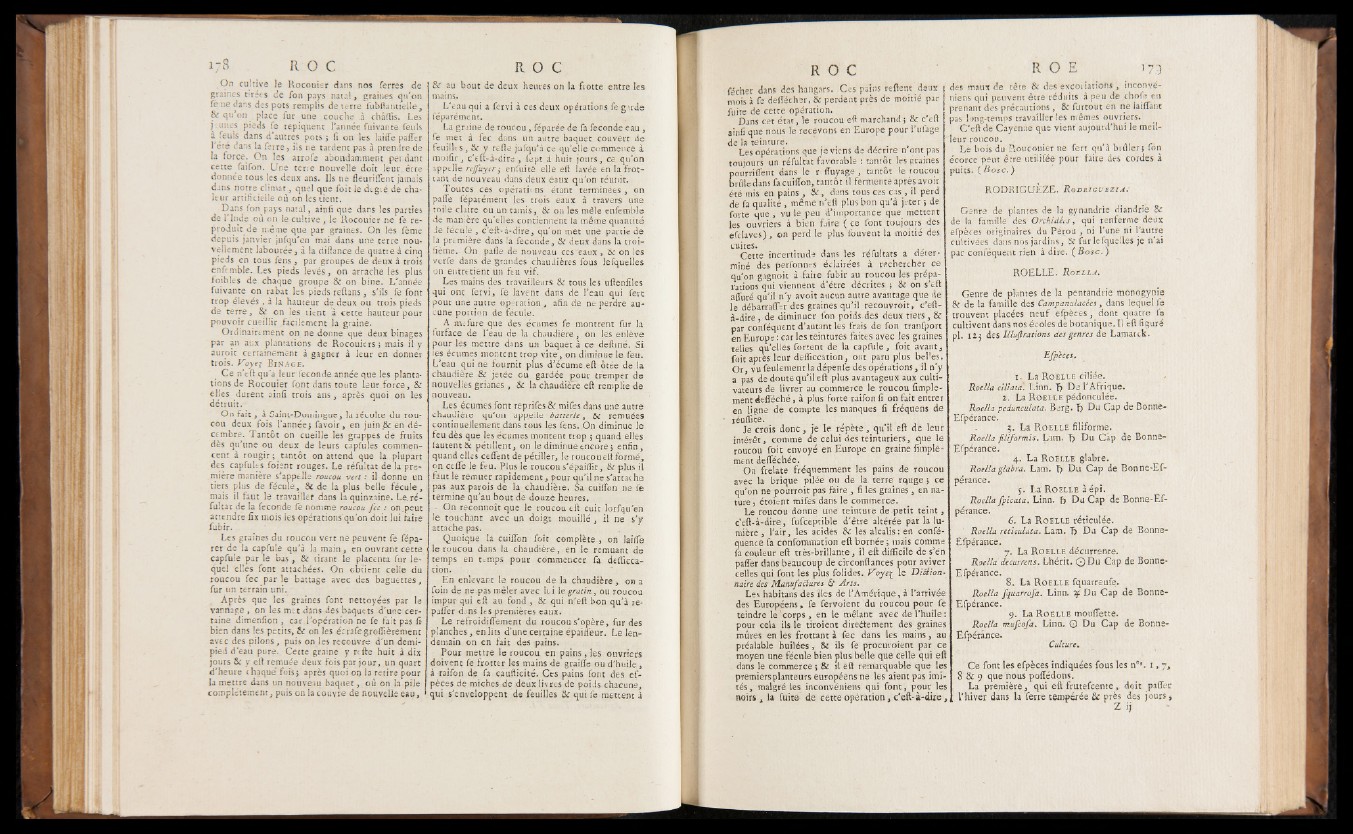
On cultive le Rocouier dans nos ferres de
graines tirées de fon pays natal, graines qu’on
fè.r.e dans des pots remplis de terre fubftantielle,
& qu’on place fur une couche i châffis. Les
j .unes pieds fe repiquent l’année fuivanto feuls
à feuls dans d’autres pots j fi on les laiffe pafler
l’été dans la ferre, ils ne tardent pas à prendre de
la force. On les arrofe abondamment perdant
cette faifon. Une terre nouvelle doit leur, être
donnée tous les deux ans. Ils ne fleurirent jamais
dans notre climat, quel que foie le degré de chaleur
artificielle où on les tient.
Dans fon pays natal, ainfi que dans les parties
de l’Inde où on le cultive, le Rocouier ne fe reproduit
de même que par graines. On les fème
depuis janvier jufqu’en mai dans une terre nouvellement
labourée, à la diflance de quatre à cinq
pieds en tous feus , par groupes de deux à trois
enfemble. Les pieds levés, on arrache les plus
foibles de chaque groupe & on bine. L’année
fuivante on rabat les pieds reûans, s’ils fe font
trop élevés , à la hauteur de deux ou trois pieds
de terre, & on les tient à cette hauteur pour
pouvoir cueillir facilement la graine.
Ordinairement on ne donne que deux binages
par an aux plantations de Rocouiers j mais il y
auroit certainement à gagner à leur en donner
trois. Voyex Binage.
Ce n’eft qu'a leurfeconde année que les plantations
de Rocouier font dans toute leur force, &
elles durent ainfi trois ans, après quoi on les
détruit.
On fait, à Saint-Domingue, la récolte du rou-
cou deux fois l’année 5 fa voir, en juin & en décembre.
Tantôt on cueille les grappes de fruits
dès qu’une ou deux de leurs capfules commencent
à rougir ; tantôt on attend que la plupart
des capfules foient rouges. Le réfultat de la première
manière s’appelle roucou vert : il donne un
tiers plus de fécule, 8c de la plus belle fécule,
mais il faut le travailler dans la quinzaine. Le. réfultat
de la fécondé fe nomme roucou. fcc : on.peut
attendre fix mois les opérations qu'on doit lui faire
fubir.
Les graines du roucou vert ne peuvent fe réparer
de la capfule qu’à la main, en ouvrant cette
capfule par le bas , & tirant le placenta fur lequel
elles font attachées. On obtient celle du
roucou fec par le battage avec des baguettes,
fur un terrain uni.
Après que les graines font nettoyées par le
vannage, on les met dans des baquets d’une certaine
dimenfion , car l’opération ne fe fait pas fi-
bien dans les petits, Sc on les écrafegroflièrement
avec des pilons, puis on les recouvre d’un demi-
pied d'eau pure. Cette graine y rtfte huit à dix
jours & y eft remuée deux fois par jour, un quart
d’heure chaque’ fois5 après quoi on la retire pour
la mettre dans un nouveau baquet, où on la pile
complètement, puis on la couvre de nouvelle eau,
8c au bout de deux heures on la frotte entre les
mains.
L’eau qui a fervi à ces deux opérations fe garde
féparément.
La graine de roucou, féparée de fa fécondé eau ,
fe mec à fec dans un autre baquet couvert de
feuilles, &r y refie jufqu’à ce qu’elle commence à
moifir, c’eft-à-dire , fept à huit jours, ce qu’on
appelle rejfuyer,• en fuite elle eft lavée en la frottant
de nouveau dans deux eaux qu’on réunit.
Toutes ces opérations étant terminées, on
pafie féparément les trois eaux à travers une
toile claire ou un tamis, & on les mêle enfemble
de manière qu’elles contiennent la même quantité
ie fécule , c’eft-à-dire, qu’on met une partie de
la première dans la fécondé, 8c deux dans la troisième.
O11 pafie de nouveau ces“eatix, & on les
verfe dans de grandes chaudières fous lefquelles
on entretient un feu vif.
Les mains des travailleurs 8c tous les uftenfiles
qui ont fervi, fe lavent dans de l’eau qui fert
pour une autre opération , afin de ne perdre aucune
pottion de fécule.
A mefure que des écumes fe montrent fur la
furface de l’eau de la chaudière, on lés enlève
pour les mettre dans un baquet à ce deftiné. Si
ies écumes montent trop vite, on diminue le feu.
L’eau qui ne fournit plus d’écume eft ôtée dé la
chaudière & jetée ou gardée pour tremper de
nouvelles grianes , 8c la chaudière eft remplie de
nouveau.
Les écumes font reprifes 8c mifes dans unè autre
chaudière qu’on appelle • batterie, 8c remuées
continuellement dans tous les fens. ,On diminue le
feu dès que les écumes montent trop $ quand elles
fautent & pétillent, on le diminue encore j enfin,
quand elles ceflent de pétiller, le roucou eit formé,
pn cefife le feu. Plus ie roucou s’épaiflit, 8c plus il
faut le remuer rapidement, pour qu’il ne s’attache
pas aux parois de la chaudière. Sa cuiflon ne fe
termine qu’au bout de douze heures.
On reconnoît que le roucou eft cuit lorfqu’en
le touchant avec un doigt mouillé, il ne s’y
attache pas.
Quoique la cuiflon foit complète , ori lailïe
le roucou dans la chaudière, en le remuant de
temps en temps pour commencer fa deflicca-
tion.
En enlevant le roucou de la chaudière, on a
foin de ne.pas mêler avec lui le gratin, ou roucou
impur qui eft au fond , 8c qui n’eft bon qu’à re-*
pafler dans les premières eaux.
Le refroidiflement du roucou s’opère, fur des
planches, en lits d’une certaine épaiiièur. Le lendemain
on en fait des pains.
Pour mettre le roucou en pains, les ouvriers
doivent fe frotter les mains de graiffe ou d’huile,
à raifon de fa caufticité. Ces pains font des espèces
de miches de deux livres de poids chacune,
qui s’enveloppent de feuilles 8c qui fe mettent à
fécher dans des hangars. Ces pains reftent deux
mois à fe deffécher, & perdent près de moitié par
fuite de cette opération.
Dans cet état, le roucou eft marchand j 8c c’eft
ainfi que nous le recevons en Europe pour i’ufage
de la teinture. ^ . ,
Les opérations que je viens de décrire n ont pas
toujours un réfultat favorable : tantôt les graines
pourriflent dans le r. ffuyage , tantôt le roucou
brille dans fa cuiflon, tantôt il fermente après avoir
été mis en pains , 8c, dans tous ces cas , il perd
de fa qualité, même n’eft plus bon qu’à ji'ter 5 de
forte que, vu le peu d’importance que mettent
les ouvriers à bien faire (ce font toujours des
efclaves), on perd le plus fouvent la moitié des
cuites.
Cette incertitude dans les réfultats a déterminé
1 des maux de tête 8c des excoriations, inconvé-
j niens qui peuvent être réduits à peu de chofe en
I prenant des précautions, 8c furtout en ne laiflant
pas long-temps travailler les mêmes ouvriers.
des perfonnes éclairées à rechercher ce
qu’on gagnoit à faire fubir au roucou les préparations
qui viennent d’étre décrites } 8c on s’eft
afîùré qu’il n'y avoit aucun autre avantage que de
le débarratfèr des graines qu’il recouvroit, c’eft-
à-dire, de diminuer fon poids des deux tiers, 8c
par conféquent d’autant les frais de fon tranfport
en Europe : car les teintures faites avec les graines
telles qu’elles fortenc de la capftile, foit avant,
foit après leur defliccation, ont paru plus belles.
Or, vu feulement la dépenfe des opérations, il n’y
a pas de doute qu’il eft plus avantageux aux cultivateurs
de livrer au commerce le roucou Amplement
defféché, à plus forte raifon fi on fait entrer
en ligne de compte les manques fi fréquens de
réuflite.
Je crois donc, je le répète , qu’il eft de leur
intérêt, comme de celui des teinturiers, que le
roucou foit envoyé en Europe en graine fimple-
ment deflechée.
On frelate fréquemment les pains de roucou
avec la brique pilée ou de la terre rquge j ce
qu’on ne pourroit pas faire, fi les graines, en nature
, étoient mifes dans le commerce.
Le roucou donne une teinture de petit teint,
c’eft-à-dire, fufceptible d’être altérée par la lumière,
l’air, les acides 8c les alcalis: en confé-
quence fa confommation eft bornée 5 mais comme
fa couleur eft très-brillante, il eft difficile de s’én ;
pafler dans beaucoup de circonftances pour aviver
celles qui font les plus Colides. yoye% le Di&ion•
nuire des Manufactures & Arts.
Les habitans des îles de l’Amérique, à l’arrivée
des Européens, fe fervorent du roucou pour fe
teindre le ’corps , en le mêlant avec de l’huile:
pour cela ils le tiroient direétement des graines
mûres en les frottant à fec dans les mains, au
préalable huilées, 8c ils fe procuroient par ce
moyen une fécule bien plus belle que celle qui eft
dans le commerce ; 8c il eft remarquable que les
premiers planteurs européens ne les aient pas imités
, malgré les inconvéniens qui font, pour les
noirs , la fuit& de cette opération, c’eft-à-dire,
C’eft de Cayenne que vient aujourd’hui le meille
u r roucou.
Le bois du Roucouler ne fert qu’à brûler j fon
écorce peut être utilifée pour faire des cordes à
puits. ( Bosc.)
RODRIGUÈZE. R o d r ig u e z ia :
Genre de plantes de la gynandrie diandriè 8c
de la famille des Orchidées, qui renferme deux
efpèces originaires du Pérou , ni l’une ni l’autre
cultivées dans nos jardins, & fur lefquelles je n’ai
par conféquent rien à dire. (Bosc.)
ROELLE. R o e l l a .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
8c de la famille des Campanulacées, dans lequel Ce
trouvent placées neuf efpèces, dont quatre fa
cultivent dans nos écoles de botanique. Il eft figure
pl. 123 des Illujlrations des genres de Lamarck.
Efpèces.
1. La Roelle ciliée^
Roella ciliata. Linn. T? De l’Afrique.
2. La Roelle pédonculée.
Roella pedunculata. Berg. b Du Cap de Bonne-
Efpérance.
La R.ÔELLE filiforme.
Roella filiformis. Lam. b Du Cap de Bonne**
Efpérance,
4. La Roelle glabre.
Roella glabra. Lam. b Du Cap de Bonne-E.f-
pérance.
y. La Roelle à épi.
Roella fpicata. Linn. b Du Cap de Bonne-Ef-
pérance.
6. La Roelle réticulée.
Roella reticulata. Lam. b Du Cap de Bonne-
Efpérance.
7. La Roelle décurrente.
Roella decurrens. Lhérit. ©Du Cap de Bonne-
Efpérance.
8. La Roelle fquarreufe.
Roella fquarrofa. Linn. y Du Cap de Bonne-
Efpérance.
9. La Roelle mouflette.
Roella mufeofa. Linn. O Du Cap de Bonne-
Efpérânce.
Culture.
Ce font les efpèces indiquées fous les n°s. 1 ,7 ,
8 8c 9 que nous poffedons.
La première, qui eft frutefeente, doit pafler
i’hiver dans la ferre tempérée & près des jours *
Z ij