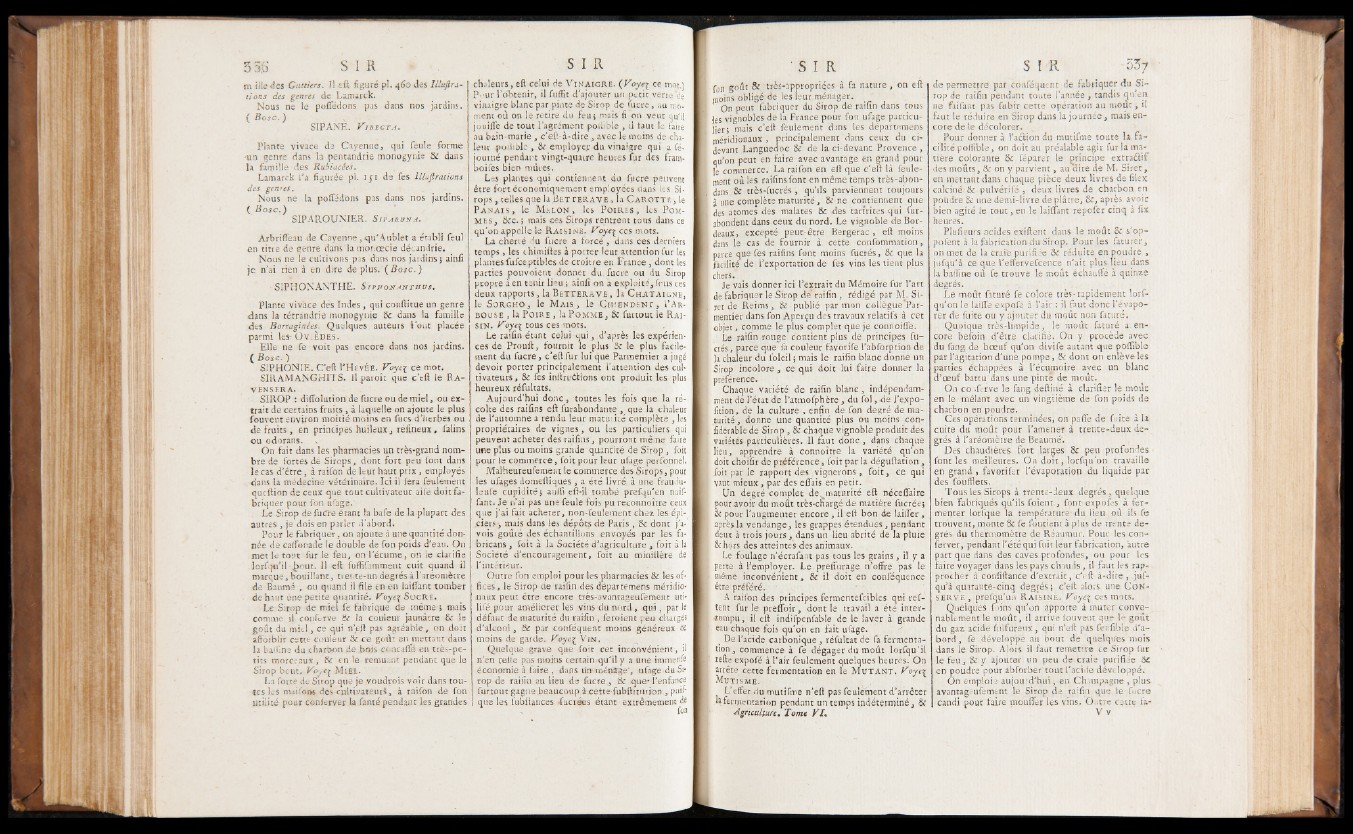
55p S I R
m ille des G at tiers. Tl eft figuré pl. 460 des IItufirations
des genres de Lamarck.
Nous ne le poffédons pas dans nos jardins.
( Bosc. )
SIPANE. V i r e c t a .
Plante vivace de Cayenne, qui feule forme
'un genre dans la pentandrie monogynie & dans
la famille des Rubiacées.
Lamarck l'a figurée pl. 151 de fes Ulufirations
des genres.
Nous ne la poffédons pas dans nos jardins.
( B o s c .)
SIPAROUNIER. S iparuna.
ArbrifiTeau de Cayenne A ublet a établi feul
en titre de genre dans la monoecie décandrie.
Nous ne le cultivons pas dans nos jardins 5 ainfi
je n’ai rien à en dire de plus. (B o s c .)
SIPHONANTHE. S ipitonanthus.
Plante vivace dés Indes, qui conftitue un genre
dans la tétrandrie monogynie & dans la famille
des Borraginces. Quelques, auteurs l ’ont placée
parmi les-OvièDES.
Elle ne fe voit pas encore dans nos jardins.
( B o s c .)
SIPHONIE. C ’eft I’Hevée. Voye% ce mot.
SIRAMANGHITS. Il paroîc que c'eft le Ra -
vensera.
SIROP : diffolution de fucre ou de miel , ou extrait
de certains fruits, à laquelle on ajoute le plus
fouvent environ moitié moins en fucs d ’herbes ou
de fruits , en principes huileux , réfineux, falins
ou odorans.
On fait dans les pharmacies un très-grand nombre
de fortes dé Sirops, dont fort peu (ont dans
le cas d’ étre, à raifon de leur haut prix , employés
dans la médecine vétérinaire. Ici il fera feulement
que (lion de ceux que tout cultivateur aifé doit fabriquer
pour fon ufage.
Le Sirop de fucTè étant fa bafe de la plupart dès
autres , je dois en parier d’abord.
Pour le fabriquer, on ajoute à une quantité donnée
de calfonade le double de fon poids d’eau. On ,
met le tout fur le feu, on l'écume, on le clarifie
lorfqu’il £ out* H eft fuffifamment cuit quand il
marque, bouillant, trente-un degrés à l ’aréomètre
de Baumé , ou quand il file en .en laiffant tomber
de haut une petite quantité. Voye% Su c r e .
Le Sirop de miel fe fabrique de même-.; mais
comme il conferve & la couleur jaunâtre & le
goût du miel, ce qui n’eft pas agréable „ on .doit
affaiblir cette couleur & .ce goût en mettant dans
la badine du charbon de .bois c-cncaffé en très-petits
morceaux , & en lê remuant pendant que le
Sirop bout. Voye\ Mi EX.
La forte de Sirop que je voudrois voir dans toutes
les maifons des cultivateur^, à raifon de fon
Utilité pour conlcrver la fanté pendant les grandes
S I R
chaleurs, eft celui de V inaigre. (Voye% ce mot.)
Pv'ur l’obtenir, il fuffit d’ajouter un petit verre'de
vinaigre blanc par pinte de Sirop de lucre, au moment
où on le retire du feu ; mais fi on veut qu’il
jouiffe de tout l ’agrément pollVbie , il faut le faire
au bain-marie, c’eft-à-dire, avec le moins de chaleur
poûible, & employer du vinaigre qui a fé-
journé pendant vingt-quatre heures fur des frara-
boifes bien mûres.
Les plantes qui contiennent du fucre peuvent
être fort économiquement employées dans (es Sirops
, telles que la B et terave , la C arotte , le
Pa n a i s , le Melon, les Poires; les Pommes,
&c. ; mais ces Sirops rentrent tous dans ce
qu’on appelle le Raisiné. Voye^ ces mots.
La cherté du fucre a fo r c é , dans ces derniers
temps, les thimiftes à porter leur attention fur les
plantesfufceptibles de croître en France, dont les
parties pouvoient donner du. fucre ou du Sirop
propre à en tenir lieu.; ainfi on a exploité, fous ces
deux rapports, la Better ave , la C hâtaigne,
le Sorgho, le Ma i s , le C hiendent, I’Ar-
bouse , la Poire , la Pomme , & furtout le Raisin.
Voye% tous ces mors.
Le raifin étant celui q u i, d’après les expériences
de Prouft, fournit le plus & le plus facilement
du fucre, c’eft fur lui que Parmentier a jugé
devoir porter principalement l’attention des cultivateurs,
& fes inftru&ions ont produit les plus
heureux réfultats.
Aujourd’hui donc, toutes les fois que la récolte
des raifins eft furabondante , que la chaleur
de l’automne a rendu leur maturité complète , les
propriétaires de v ignes, ou les particuliers qui
peuvent acheter des raifins, pourront même faire
une plus ou moins grande' quantité de Sirop, foit
pour le commerce, foit pour leur ufage perfonnel.
Malheureufement le commerce des Sirops, pour
les ufages domeftiques, a été livré à une fraudu-
leufe cupidité; auffi eft-il tombé prefqu’ en naif-
fant. Je n’ai pas une feule fois pu reconnoître ceux
que j’ ai fait acheter, non-feulement chez les épi-
.ciers-, mais dans les dépôts de Paris , & dont j’a-
vois goûté des échantillons envoyés par les fa-
bricans, foit à la Société d’agriculcure , foit à la
Société d’encouragement, foit au miniftère de
l’intérieur.
Outre fon emploi pour les pharmacies & les offices,
le Sirop de raifin des départemens méridionaux
peut être encore très-avantageufement uti-
lifé .pour améliorer les vins du nord , q u i, par le
défaut de maturité du raifin, feroient peu chargés
d’alcool, & par conféquent moins généreux &
moins de garde. Voye£ Vin.
Quelque grave que foit cet inconvénient, il
n’en relie pas moins certain .qu’ il y a une imnienfe
économie à faire , dans tin- ménage’, ufage du Sirop
de raifin au lieu de fucre., & que* l’enfance
furtout gagne beaucoup à cette-fubftituri'on , puisque
les fubftances -fucrées étant extrêmement de
S I R
fon goût & très-appropriées-à fa nature, on eft 1
moins obligé de les leur ménager.
On peut fabriquer du Sirop de raifin dans tous
les vignobles de la France pour fon ufage particulier;
mais c’ eft feulement dans les départemens
méridionaux, principalement dans ceux du ci-
devant Languedoc & de la ci-devant Provence,
qu’on peut en faire avec avantage en grand pour
Je commerce. La raifon en eft que c’eft là feulement
où les raifins font en même temps très-abon-
dans.& très-fucrés, qu’ils parviennent toujours
3 une complète maturité, & ne contiennent que
des atomes des malates & des tartrites qui fur-
abondent dans ceux du nord. Le vignoble de Bordeaux,
excepté peut-être Bergerac , eft moins
dans le cas de fournir à cette confommation,
parce que fes raifins font moins fucrés, & que la
facilité de l’exportation de fes vins les tient plus
chéris.
Je vais donner ici l’extrait du Mémoire fur l’ art
de fabriquer le Sirop de raifin , fédigé par M. Si-
ret de Reims, & publié par mon collègue Parmentier
dans fon Aperçu des travaux relatifs à cet
objet, comme le plus complet que je connoiffe.
Le raifin rouge contient plus de principes fucrés.,
parce que fa couleur favorife l’abforption de
la chaleur du foleil ; mais le raifin blanc donne un
Sirop incolore, ce qui doit lui faire donner la
préférence.
Chaque variété de raifin blanc, indépendamment
de l’çtat de l’atmofphère, du fo l, de l’ e,xpo-
lîtion, de la culture , enfin de fon degré de maturité
, donne une quantité plus ou moins con-
fidérablede Sirop, & chaque vignoble produit des
variétés particulières. Il faut d onc, dans chaque
lieu, apprendre à connoître la variété qu’ on
doit choifir de préférence, foit par la déguftation,
.foit par le rapport des vignerons, fo it , ce qui
vaut mieux, par des effais en petit.
Un degré complet devmaturité eft néceffaire
pour avoir du moût très-enargé de matière fucrée;
& pour l’augmenter encore, il eft bon de laiffer,
aprè^la vendange, les grappes étendues, pendant
deux à trois jours , dans un lieu abrité de la pluie
& hors des atteintes des animaux.
Le foulage n’écrafant pas tous les grains, il y a
.perte à l’employer. Le preifurage n’offre pas le
même, inconvénient, & il doit en conféquence
être préféré.
A raifon des principes fermentefcibles qui refont
furie preffoir, dont le travail a été interrompu,
il eft indifpenfable de le laver à grande
eau chaque fois qu’on en fait ufage.
’j De.l’acide carbonique, réfultat de fa fermentation,
commence à fe dégager du moût lorfqu’ il
refte expofé à l’air feulement quelques heures. On
arrête cette fermentation en le Mutant. V o y e%
Mutisme.
L’effet du mutifme n’eft pas feulement d’arrêter
U fermentation pendant un temps indéternfiné , &
Agriculture. Tome VI.
S I R -557
de permettre par conféquent de fabriquer du Sirop
de raifin pendant toute l’année , tandis qu’en
ne faifant pas fubir cette opération au moût, il
faut le réduire en Sirop dans la journée, mais encore
de le décolorer.
Pour donner à l’aétion du mutifme toute la facilité
poffible, on doit au préalable agir fur la matière
colorante & féparer le principe extraéiif
des moûts, & on y parvient, au dire de M. Siret,
en mettant dans chaque pièce deux livres de filex
calciné & pulvérifé , deux livres de charbon en
poudre & une demi-livre de plâtre, & , après avoir
bien agité le tout, en le laiffant repofer cinq à fix
heures.
Plufieurs acides exifterit dans le moût & s’op-
pofent à la fabrication du Sirop. Pour les faturer,
on met de la craie purifiée & réduite en poudre ,
jufqu’ à ce que l’effervefcençe n’ait plus lieu dans
la b a (fine où fe trouve le moût échauffé à quinze
degrés.
Le moût faturé fe colore très-rapidement lorf-
qu’on le laiffe expofé à l’air : il faut donc l’évaporer
de fuite ou y ajouter du moût non faturé;
Quoique très-limpide, le moût faturé a. encore
befoin d’être clarifié. On y procède avec
du fang de boeuf qu’ on divife autant que poffible
par l’agitation d’une pompe, Si dont on enlève les
parties échappées à l’écumoire avec un blanc
d’oeuf battu dans une pinte de moût.
On cor.ffrve le fang deftiné à clarifier le moût
en le mêlant avec un vingtième de fon poids de
charbon en poudre.
Ces opérations terminées, on paffe de fuite à la
cuite du moût pour l’amener à trente-deux 4e*
grés à l’aréomètre de Beaumé’.
Des chaudières fort larges & peu profondes
| font les meilleures. On d o it, lorfqu’on travaille
; en grand , favorifer l’évaporation du liquide par
! des fôufflets.
j Tous les Sirops à trente-deux-degrés, quelque
bien Fabriqués qu’ ils foien t, font expofes à fermenter
lorfque la température' du lieu où ils fe
trouvent, monte & fe foutient à plus de trente degrés
du thermomètre de Réaumur. Pour les con-
ferver, pendant l’été qui fuie leur fabrication, autre
part que dans des caves profondes, ou pour les
faire voyager dans les pays chauds, il faut les rapprocher
à confiftance d’extrait, c’eft à-dire, jufqu’à
quarante-cinq degrés; c ’eft alors une C onse
r v e , prefqu’un Raisiné. Voyeç ces mots.
Quelques foins qu’ on apporte à muter convenablement
le moût, il arrive (ouvent que le goût
du gaz acide fnlfureux, qui n’eft pas fenfibie d’ abord,
fe.développe au bouc de quelques mois
dans le Sirop. Alors il faut remettre ce Sirop fur
le feu, & y ajouter un peu de craie purifiée 6c
en poudre pour abforber'tout l’acide développé.
On emploie aujourd’h u i, en Champagne , plus
avancageufement le Sirop de raifin que. le fucre
candi pour faire mouffer les vins, Outre cette fa-
' . V v