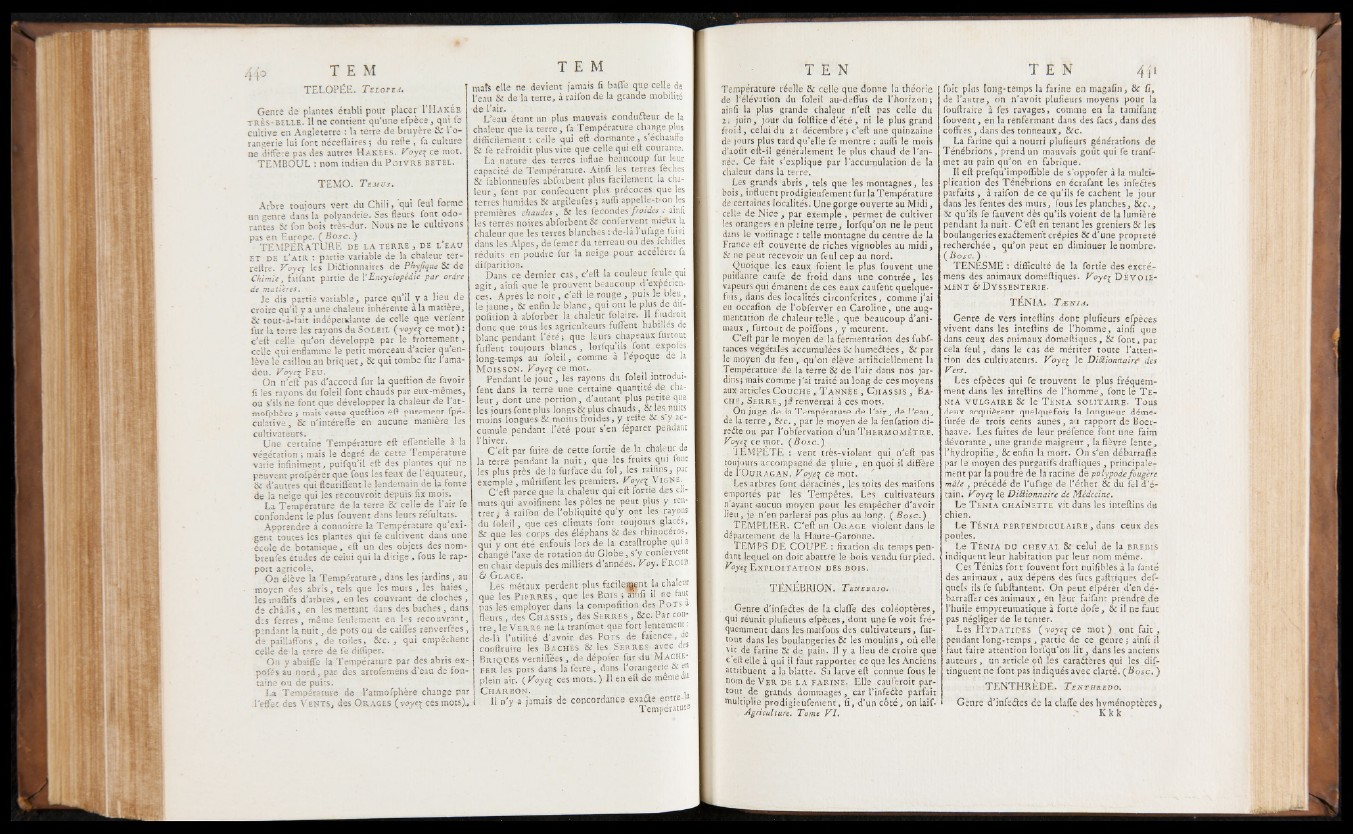
T E M
TELOPÉE. Tezopza.
Genre de plantes établi pour placer I’Hakee
très-belle. Il ne contient qu’une efpèce , qiù fe
cultive en Angleterre : la terre de bruyère & l'o rangerie
lui font néceflaires, du re lie , fa culture
ne diffère pas des autres Hakêes. Voyez ce mot.
TEMBOUL : nom indien du Poivre betel.
TEMO. T e.mus.
Arbre toujours vert du Chili , qui feul forme
un genre dans la polyandrie. Ses fleurs font odorantes
fon bois très-dur. Nous ne le cultivons
pas en Europe. ( Bosc. )
TEMPÉRATURE de la terre , de l’eau
et de l’air : partie variable de la chaleur ter-
reitre. Voyer les Dictionnaires de Phyfique & de
Chimie, faifant partie de Y Encyclopédie par ordre
de matières.
Je dis partie variable , parce qu’ il y a lieu de
croire qu’ il y a une chaleur inhérente à la matière,
& tout-à-fait indépendante de celle que verfent ;
fur la terre les rayons du Soleil {voyez ce mot) : j
c’eft celle qu’on développe par le frottement,
celle qui enflamme le petit morceau d’acier qu’enlève
le caillou au briquet, & qui tombe fur 1 amadou.
Voyez Feu. - .
On n’eft pas d’accord fur la queftion de lavoir
fi les rayons, du foleil font chauds par eux-mêmes,
ou s’ils ne font que développer la chaleur de l’at-
mofphère > mais cette queftion eft purement fpé-
culative, & n’ intéreffe en aucune manière les
cultivateurs.
Une certaine Température eft effentielle à la
végétation i mais le degré de cette Température
varie infiniment, puifqu’ il eft des plantes qui ne
peuvent profpérer que fous les feux de l’équateur,
& d’autres qui fteuriffent le lendemain de la fonte
de la neige qui les recouvroit depuis fix mois.
La Température de la terre & celle de l’ air fe
confondent le plus fouvent dans leurs réfultats. *:
Apprendre à connoître la Température qu’exigent
toutes les plantes qui fe cultivent dans une
école de botanique, eft un des objets des nom-
breufes études de celui qui la dirige, fous le rapport
agricole.
On élève la Température, dans les jardins, au
moyen des abris, tels que les murs , les haies,
les maflifs d’ arbres , en les couvrant de cloches ,
de châffis, en les mettant dans des bâches, dans j
des ferres, même feulement en les recouvrant, '
pendant la. nuit, de pots ou de cailles renverfées,
de paillaffons, de toiles, & c . , qui empêchent
celle de-la terre de fe diffiper.
On y abaifie la Température par des abris expo
fés au nord, par des arrofemens d’eau de fontaine
ou de puits.
La Température de l’atmofphère change par
l ’effet des V ents, des Orages {voyez ces mots)„
maïs elle ne devient jamais fi baffe que celle de
l’eau & de la terre, à raifon de la grande mobilité
L’ eau étant un plus mauvais conducteur de la j
chaleur que la terre, fa Température change plus
difficilement : celle qui eft dormante, s échauffé
& fe refroidit plus vite que celle qui eft courante.
La nature des terres influe beaucoup fur leur
capacité de Température. Ainfi les terres feches
& fablonneufes abforbent plus facilement la chale
u r , font par conféquent plus précoces que les
terres humides & argileufes > auffi appelle-t-on les I
premières chaudes, & les fécondés 'froides : ainfi
les terres noires abforbent & confervent miAix la |
chaleur que les terres blanches, î'de-là 1 ulage fuivi
dans les Alpes, de femer du terreau ou des fchiftes
réduits en poudre fur la neige .pour accélérer fa
difparition.
Dans ce dernier cas, c’eft la couleur feule qui
a g it, ainfi que le prouvent beaucoup d expériences.
Après le noir, c’eft le rouge , puis le bleu>
le jaune, & enfin le blanc, qui ont le plus de dil-
pofition à abforber la chaleur folaire. II faudroit
donc que tous les agriculteurs fuffent habilles de
blanc pendant l’été} que leurs chapeaux fur tout
fulfent toujours blancs, lorfqu’ite font expofés
long-temps au foleil, comme a 1 époque de la
Moisson. Voyez ce mot~
Pendant le jou r , les rayons du foleil introdui-1
fent dans la terre une certaine quantité de chaleur
, dont une portion, d’autant plus petite que |
les jours font plus longs & plus chauds, & les nuits
moins longues &. moins froides, y relie & s y accumule
pendant l’ été pour s’en féparer pendant
l’hiver.
C ’eft par fuite de cette fortie de la chaleur de
la terre pendant la nuit, que les fruits qui font
les plus près de la furface du fo l, les raifins, par 1
exemple, mûriffent les premiers. Voyez V igne.
C ’eft parce que la chaleur qui eft fortie des climats
qui avoifinent les pôles ne peut plus y rentrer
i à raifon de l’obliquité qu’y ont les rayons
du foleil, que ces climats font toujours glacés,
& que les corps des éléphans 8c des rhinocéros,
qui y ont été enfouis lors de la cataftrophe.qui a
changé l’axe de rotation du Globe, s y confervent
en chair depuis des milliers d’années. Voy. Froid
& Glace.
Les métaux perdent plus facilement la chaleur
que les Pierres, que les Bois ; aï h fi il ne faut
pas les employer dans la compofition des P ots a
fleurs, des C hâssis, des Serres , &c. Par contre,
le V erre ne la tranfmet que fort lentement,
de-îà l’utilité d’avoir des Pots de faïence, de
conftruire les Bâches & les Serres avec des
Briques verniflees, de dépofer fur du Mâchefer
les pots dans la ferre, dans l’orangerie & en
plein air. ( Voyez ces mots- ) ^ en m^nie dLl
C harbon. ,
Il n’y a jamais de concordance exacte entre-ia
J Température
Température réelle & celle que donne la théorie
de l’élévation du foleil au-deflus de l’horizon}
ainfi la plus grande chaleur n’eft pas celle du
2i juin, jour du folftice d’é t é , ni le plus grand
froid, celui du 21 décembre} c’eft une quinzaine
de jours plus tard qu’elle fe montre : auffi le mois
d’août eft-il généralement le plus chaud de l'année.
Ce fait s’explique par l'accumulation de la
chaleur dans la terre.
Les grands abris, tels que les montagnes, les
bois, influent prodigieufement fur la Température
de certaines localités. Une gorge ouverte au Midi,
celle de Nice , par exemple , permet de cultiver I
les orangers en pleine terre, lorfqu’ on ne le peut
dans le voifinage : telle montagne du centre de la
France eft couverte de riches vignobles au midi,
& ne peut recevoir un feul cep au nord.
Quoique les eaux foient le plus fouvent une
puilfanre caufe de froid dans une contrée, les
vapeurs qui émanent de ces eaux caufent quelquefois,
dans des localités circonfcrices, comme j’ai
eu occafîon de l’obferver en Caroline, une augmentation
de chaleur telle , que beaucoup d’ animaux,
furtout de poiffons, y meurent.
C ’eft par lé moyen de la fermentation des fubf- ’
tances végétales accumulées &r humeCtées, par
le moyen du feu , qu’on élève artificiellement la '
Température de la terre & de l’air dans nos jardins
; mais comme j ’ai traité au long de ces moyens
aux articles C ouche , T année , C hâssis , Bâ che,
Serre, jê renverrai à ces mots.
On juge de la Température de l’air, de l ’eau,
de la terre, & c . , par le moyen de la fenfation directe
ou par l’obferyation d’un T hermomètre.
Voyez ce mot. (B o s c .)
TEMPETE : vent très-violent qui n’eft pas
toujours accompagné de pluie, en quoi :il diffère
de l’OüRAfiAN. Voy^z ce mot.
Les arbres font déracinés, les tpits des maifons
emportés par les Tempêtes. Les cultivateurs
n’ayant «aucun moyen pour les empêcher d’avoir
lieu, je n’en parlerai pas plus au long. ( Bosc.)
TEMPLIER. C ’eft un Orage violent dans le
département de la Haute-Garonne.
TEMPS DE CO U P E : fixation -du temps pendant
lequel on doit abattre le bois vendu fur pied.
Voyez Exploitation des bois.
TÉNÉBRION. T enèbkio.
Genre d’ infeCtes de la claffe des coléoptères,
qui réunit plufieurs efpèces, dont une fe voit fréquemment
dans les maifons des cultivateurs, fur-
tqut dans les boulangeries & les moulins, où elle;
vit de farine & de pain. Il y a lieu de croire que
c ’eft elle à qui il faut rapporter ce que les Anciens
attribuent à la blatte. Sa larve eft connue fous le
Oom de Ver d e l a f a r i n e . Elle cauferoit partout
de grands dommages, car l’ infeCte parfait
multiplie prodigieufement, fi, d’un cô té , onlaif-
Àgriculture. Tome VI.
foit plus long-temps la farine en magafin, & fi,
de l’autre, on n’ avoit plufieurs moyens pour la
fouftraire à fes ravages, comme en la tamifanc
fouvent, en la renfermant dans des facs, dans des
coffres , dans des tonneaux, &c.
La farine qui a nourri plufieurs générations de
Ténébrions, prend un mauvais goût qui fe tranfmet
au pain qu’ on en fabrique.
Il eft prefqu’impoffible de s ’oppofer à la multi*
plication des Ténébrions en écrafant les infeCtes
parfaits , à raifon de ce qu’ils fe cachent le jour
dans les fentes des murs, fous les planches, & c . ,
& qu’ ils fe fauvent dès qu’ils voient de la lumière
pendant la nuit. C ’eft en tenant les greniers & les
boulangeries exactement crépies & d’une propreté
recherchée, qu’on peut en diminuer le nombre.
( Bosc. )
TENESME : difficulté de la fortie des excré-
mens des animaux domeftiques. Voyej Dévoiement
& Dyssenterie.
TÉNIA. Tæ n ia .
Genre de vers inteftins dont plufieurs efpèces
vivent dans les inteftins de l’homme, ainfi que
dans ceux des animaux domeftiques, & font, par
cela feul, dans le cas de mériter toute l’attention
des cultivateurs. Voyez le Diftionnaire» des
Vers.
Les efpèces qui fe trouvent le plus fréquemment
dans les inteftins de l’ homme, font le T énia
vulgaire & le T énia solitaire. T ous
: deux acquièrent quelquefois la longueur déme-
i furée de trois cents aunes, au rapport de Boer-
haave. Les fuites de leur préfence font une faim
dévorante, une grande maigreur , la fièvre lente,
l’hydropifie, & enfin la mort. On s’en débarraffe
par le moyen des purgatifs draftiques, principalement
par la poudre de la racine de polypode fougère
mâle 3 précédé de l’ ufage de l’éther & du fel d’étain.
Voyez le DiBionnaire de Médecine.
Le T énia chaînette vit dans les inteftins du
chien.
Lé T énia perpendiculaire , dans ceux des
poules.
Le T énia du cheval & celui de la brebis
indiquent leur habitation par leur nom même.
Ces Ténias for.t fouvent fort nuifibles à la fanté
des animaux , aux dépens des fucs gaftriques def-
quels ils fe fubftantent. On peut efpérer d’en dé-
barraffer ces animaux, en lèur faifant prendre de
l’huile empyreumatique à forte dofe, & il ne faut
pas négliger de le tenter.
Les Hydatides ( voyez ce mot ) , ont f a i t ,
pendant long-temps, partie de ce genre, ainfi il
faut faire attention lorfqu’on l i t , dans les anciens
auteurs, un article où les caractères qui les distinguent
ne font pas indiqués avec clarté. (B o s c . )
TENTH REDE . T enthredo.
Genre d’ infeCtes de la claffe des hyménoptères,
K k k