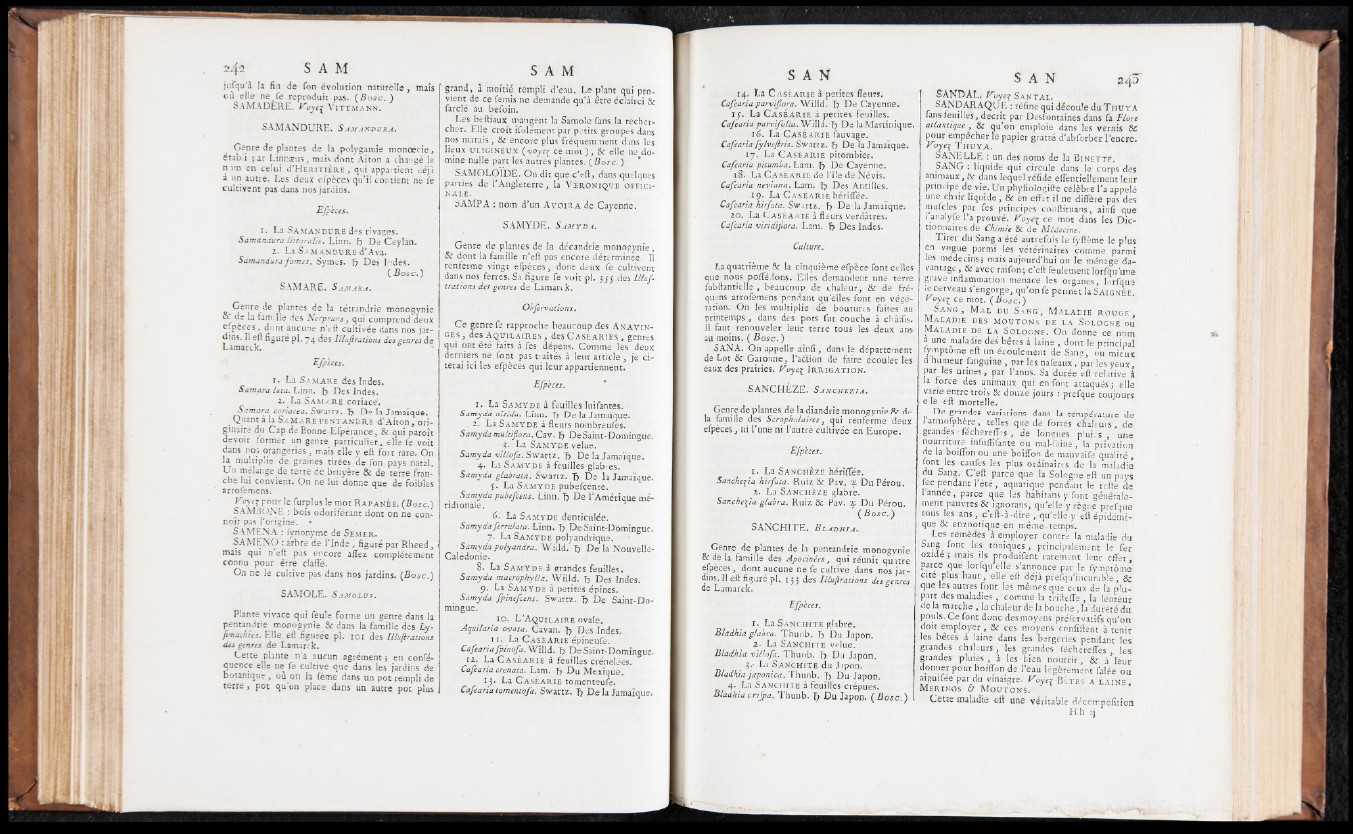
jufqu’à la fin de fon évolution naturelle, mais
où elle ne fe reproduit pas. ( B o s c . )
SAMADÈRE. V o y e ^ Vittmann.
SAMANDURE. S a m a s d u r a .
Genre de plantes de la polygamie monoecie,
établi par Linnæus, mais dont Aiton a changé lé
nim en celui d’HÉRmÉRE, qui appartient déjà
a un autre. Les deux efpèces qu’ il contient ne fe
cultivent pas dans nos jardins.
EJpéces.
i . La Sam an d u r e des rivages.
Samandura littoralis, Linn. b De Ceylan.
2. La Samandure d’ Ava.
Samandura fornes. Symes. b Des Indes.
I Bosc. |
SAMARE. S am a r a .
Genre de plantes de la tétrandrie monogynie
& de la famille des Nerpruns 3 qui comprend deux
efpèces, dont aucune n’tft cultivée dans nos jardins.
Il eft figuré pl. 74 des llluftrations des genres de
Lamarck.
Efpeces.
i . La S a m are des Indes.
Samara lata. Linn. b Des Indes.
2. La Sa m /.re coriace.
Samara coriacea. Swartz. b De la Jamaïque.
Quant à la Samare pentanDRe d’Aiton, originaire
du Cap de Bonne-Efpérance, & qui paroît
devoir former un genre particulier, elle fe voit
dans nos orangeries, mais elle y eft fort rare. On
la multiplie de graines tirées de-fon pays natal.
Un mélange de terre de bruyère & de terre franche
lui convient. On ne lui donne que de foibles
arrofemens.
V o y y pour le furplus le mot RapanÉE. ( B o s c .)
SAMBONE : bois odoriférant dont on ne con-
noîr pas Porigine. *
SAMENA : fynonyme de Semer.
SAMENO : arbre de l’ Inde, figuré par Rheed,
mais qui n eft pas encore a fiez complètement
connu pour être daffé.
On ne le cultive pas dans nos jardins. (Bosc.)
SAMOLE. S am o l u s.
Plante vivace qui feule forme un genre dans la
pentandrie monogynie & dans la famille des Ly-
fimachies. Elle eft figurée pl. lo i des llluftrations
des genres de Lamarck.
Cette plante n'a aucun agrément j en confé-
quence elle ne fe cultive que dans les jardins de
botanique, où on la fème dans un pot rempli de
terre, pot qu on place dans un autre pot plus
grand, à moitié rempli d’eau. Le plant qui provient
de ce femis ne demande qu’à être éclairci &
fardé au befoin.
Les beftiaux mangent la Samole fans la rechercher.
Elle croît ifolémenr par petits groupes dans
nos marais, & encore plus fréquemment dans les
lieux u l ï g i n e u x ( voyeç ce mot ) , & elle ne domine
nulle part les autres plantes. ( Bosc. )
SAMOLOÏDE. On dit que c ’eft, dans quelques
parties de l’Angleterre, la Véronique officinale.
SAMPA : nom d’un Avoira dp Cayenne.
SAMYDE. Sam yd a .
Genre de plantes de la décandrie monogynie,
& dont la famille n’eft pas encore déterminée. Il
renferme vingt efpèces, dont deux fe cultivent
dans nos ferres. Sa figure fe voit pl. 355 des llluftrations
des genres de Lamarck.
Obfervations.
Ce genre fe rapproche beaucoup des Anavin-
ges, des Aquilaires , des C aséaries , genres
qui ont été faits à fes dépens. Comme les deux
derniers ne font pas traités à leur article, je citerai
ici les efpèces qui leur appartiennent.
Efpeces.
1. La Samyde à feuilles luifantes.
Samyda nitida. Linn. b De la Jamaïque.
. La Samyde à fleurs nombreufes.
Samydamultifiora. Cav. b DeSàint-Domingue.
y La Samyde velue.
Samyda villofa. Swartz. b De la Jamaïque.
4. La Samyde à feuilles glabies.
Samyda glabrata. Swartz. b De la Jamaïque.
y. La Samyde pubefcente.
Samyda pubefcens. Linn. b De l’Amérique méridionale.
6 . La Samyde denticulée.
Samyda ferrulata. Linn. b De Saint-Domingue.
7. La Samyde polyandrique.
Samyda polyandra. W illd /b De la Nouvelle-
Calédonie.
8. La Samyde à grandes feuilles.
Samyda macrophylla. Willd. b Des Indes.
9. La Samyde à petites épines.
] Samyda fpinefcens. Swartz. b De Saint-Domingue.
10. L'Aquilaire ovale.
Aquilaria ovata. Cavan. b Des Indes.
11. La Caséarie épineufe.
Cafearia fpinofa. Willd. b DeSaint-Domingue.
12. La C aséarie à feuilles crénelées.
Cafearia crenata. Lam. b Du Mexique.
13* La C aséarie tomenteufe.
Cafearia tomentofa. Swartz. b De la Jamaïque.
14. La C aséarie à petites fleurs.
Cafearia parvifora.WiWd. b De Cayenne,
iy. La C aséarie à petites feuilles.
Cafearia parvifo/ia. Willd. b De la Martinique.
16. La C aséarie fauvage.
Cafearia fylveftris. S'warrz. b De la Jamaïque.
17. La Caséarie pitombier.
Cafearia pitumba. Lam. b De Cayenne.
18. La C aséarie de l’île de Névis.
Cafearia neviana. Lam. b Des Antilles.
19. La C aséarie hérilfée.
Cafearia hirfuta. Swartz. b De la Jamaïque.
20. La C aséarie à fleurs verdâtres.
Cafearia viridifiora. Lam. b Des Indes.
Culture.
La quatrième & la cinquième efpèce font celles
que nous poffédons. Elles demandent une terre
fubftantielle , beaucoup de chaleur, & de fré-
quens arrofemens pendant qu elles font en végétation.
On les multiplie de boutures faites au
printemps , dans des pots fur couche à châflïs.
Il faut renouveler leur terre tous les deux ans
au moins. ( Bosc. )
SANA. On appelle ainfî, dans le département
de Lot & Garonne, l’a&ion de faire ecouler les
eaux des prairies. Voye1 Irrigation.
SANCHEZE. S a n c h e z ia .
Genre de plantes de la diandrie monogynie & de
la famille des Scrophulaires, qui renferme deux
efpèces, ni l’une ni l’autre cultivée en Europe.
Efpeces.
1. La Sancheze hériffée.
Sanchezia hirfuta. Ruiz & Pav. Du Pérou.
2. La Sanchéze glabre.
Sanchezia glabra. Ruiz & Pav. y. Du Pérou.
( B o s c .)
SANCHITE. B l a d h ia .
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
& de la famille des Apocinées, qui réunit quitre
efpèces, dont aucune ne fe cultive dans nos jardins.
Il eft figuré pl. 133 des llluftrations des genres
de Lamarck.
Efpeces.
1. La Sanchite glabre.
Bladhia glabra. Thunb. b Du Japon.
2. La Sanchite velue.
Bladhia villofa. Thunb. b Du Japon.
3.- La Sanchite du Japon. .>
Bladhia japonica. Thunb. b Du Japon.
4. La Sanchite à feuilles crépues.
Bladhia crifpa. Thunb. b Du Japon. (B o s c .)
SANDAL. Voye\ S a n t a l .
SANDARAQUE : réfine qui découle du T huya
fans feuilles, décrit par Des fontaines dans fa Flore
atlantique, & qu’on emploie dans les vernis &
pour empêcher le papier gratté d’abforber l'encre.
Voy ei T h u ya .
SANELLE : un des noms de la Bin e t tf .
SANG : liquide qui circule dans le corps des
animaux, & dans lequel réfide effentiellement leur
principe de vie. Un phyfiologifte célèbre l’a appelé
une chair liquide, & en effet il ne diffère pas des
mufcles par fes principes conftituans, ainfi que 1 analyfe l’a prouvé. Voyeç ce mot dans les Dictionnaires
de Chimie & de Médecine.
Tirer du Sang a été autrefois le fyftème le plus
en vogue parmi les vétérinaires comme parmi
les médecins» mais aujourd’ hui on le ménage davantage,
& avec raifon; c’eft feulement lorfqu une
giave inflammation menace les organes, lorfque
le cerveau s’engorge, qu’on fe permet la Saignée.
Voyei ce mot. (B o s c .)
S a n g . M a l d u S a n g , M a l a d i e r o u g e ,
M a l a d i e d e s m o u t o n s d e l a So l o g n e ou
M a l a d i e d e l a S o l o g n e . On donne ce nom
a une maladie des bêtes à laine , dont le principal
lymptôme eft un écoulement de Sang, ou mieux
d humeur fanguine , par les nafeaux, par les yeux,
par les urines, par l’anus. Sa durée eft relative I
| la force des animaux qui en font attaqués} elle
varie entre trois &: douze jours : prefque toujours
: e.le eft mortelle.
De grandes variations dans la température de
l’atmofphère, telles que de forces chaleurs, de
grandes ■ fechereffes , de longues p'uics , une
nourriture infuffïfante ou mal-faine, la privation
de la boiflon ou une boiffon de mauvaife qualité ,
font les caufes les plus ordinaires de la maladie
. du Sang, G eft parce que la Sologne eft un pays
fec pendant l’é té , aquatique pendant le refte de
1 année, parce que les habitans y font généralement
pauvres & ignorans, qu’elle y règne prefque
tous les ans , c eft-a-dire , qu’ellè y eft épidémique
& enzootique en même-temps.
Les remèdes à employer contre la maladie du
Sang font les toniques, principalement le fer
oxidé j mais ils produifent rarement leur effet,
parce que lorfqu elle s'annonce par le fymptôme
cité plus haut, elle eft déjà prefqu'incurable, &
que les autres font les mêmes que ceux de la plupart
des maladies , comme la trifteffe , la lenteur
de la m arche, la chaleur de la bouche, la dureté du
pouls. Ce font donc des moyens préfervatifs qu’on
doit employer, & ces moyens confident à tenir
les bêtes à laine dans les bergeries pendant les
grandes chaleurs, les grandes féchereffe.s , les
grandes pluies, à les bien nourrir, & à*leur
donner pour boiffon de l’eau légèrement falée ou
ai gui fée par du vinaigre. Voyeç Bétes a l *une
M é r i n o s & M o u t o n s . '
Cette maladie eft une véritable décompofition
H h |