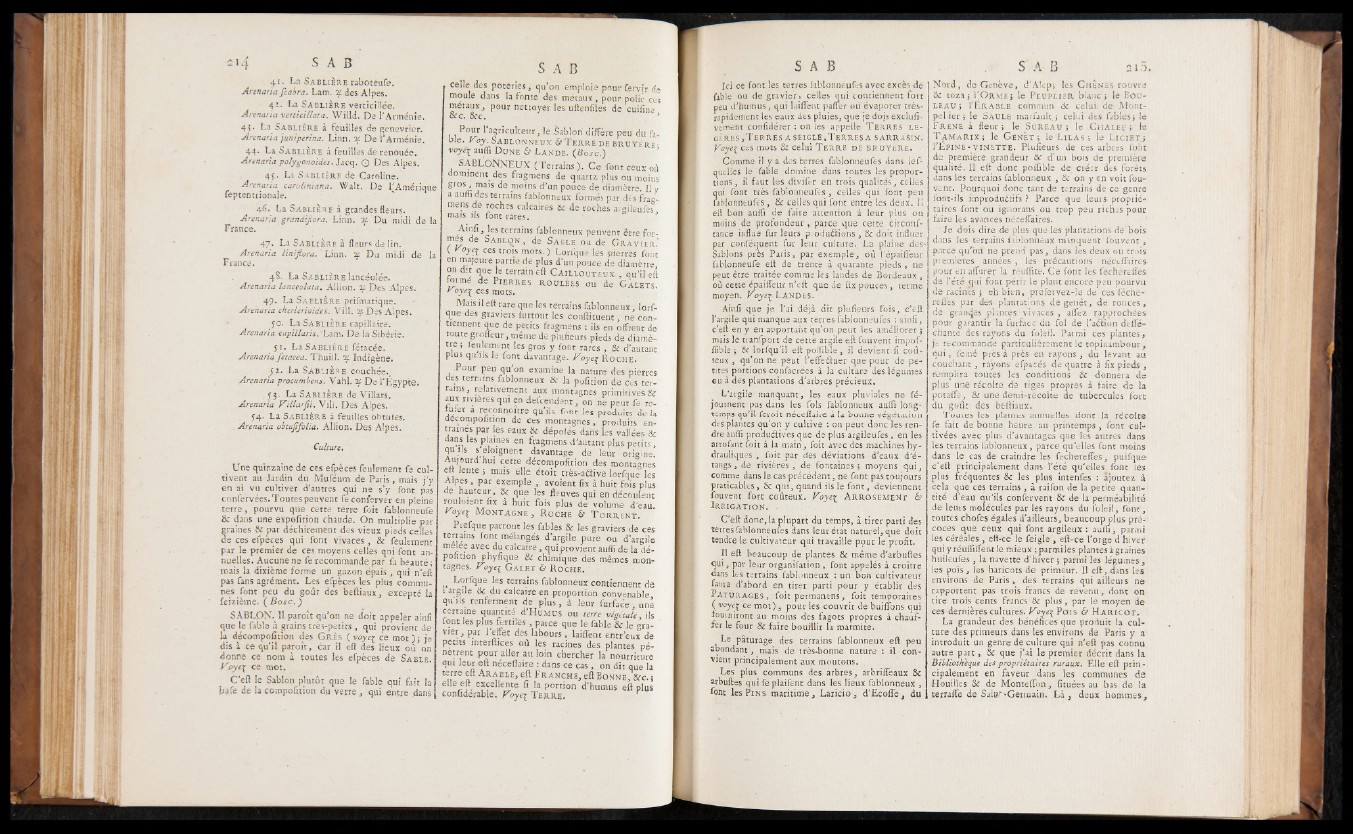
41. La Sablière raboteufe.
Arenariafcabra. Lam. ^des Alpes.
42. La Sablière verticillée.
Arenaria verticillata. Willd. De T Arménie.
43. La Sablière à feuilles de genevrier.
Arenaria juniperina. Linn. y. De l’Arménie.
44. La Sablière à feuilles de renouée.
Arenaria polygonoides. Jacq. O Des Alpes.
4f • La Sablière de Caroline.
Arenaria caroliniana. Walt. De l'Amérique
feptentrionale.
46. La Sablière à grandes fleurs.
Arenaria grandifora. Linn. 7f Du midi de la
France.
47. La Sablière à fleurs de lin.
Arenaria liniflora. Linn. Du midi de la
France»
48. La Sablière lancéolée.
Arenaria lanceolata. Aliion. "2f Des Alpes.
49. La Sablière prifmatique.
Arenaria ckerlerioides. Vül. % Des Alpes.
• 30. La Sablière capillaire.
Arenaria -capillaris. Lam. De la Sibérie.
51. La Sablière fétacée.
Arenaria fetacea. Thuill. If Indigène.
52. La Sa b l ièr e couchée.,
Arenaria procumbens. Vahl. 7f De l’Égypte.
55- La Sablière de Vijlars.
Arenaria Killarfii. VilJ. Des Alpes.
54- La Sablière à feuilles obtufes.
Arenaria obtufifolia. Aliion. Des Alpes.
Culture. '
Une quinzaine de ces efpèces feulement fe cultivent
au Jardin du Muféum de Paris, mais j ’y
en ai vu cultiver d’autres qui ne s’y font pas
confervées. Toutes peuvent feconferver en pleine
terre, pourvu que cette terre foit fablonneufe
& dans une expofition chaude. On multiplie par
graines & par déchiremént des vieux pieds celles
de ces efpèces qui font vivaces, & feulement
par le premier de ces moyens celles qui font annuelles.
Aucune ne fe recommande par fa beauté?
mais la dixième forme un gazon épais, qui n’eft
pas fans agrément. Les efpèces les plus communes
font peu du goût des beftiaux, excepté la
feizième. ( B o s ç . )
SABLQN. 11 paroît qu’on ne doit appeler ainfi
que le fable à grains très-petits, qui provient de
la décomposition des Grès (voyeç ce mo.t); je
dis à ce qu’il paroît, car il eft des lieux où on
donne ce nom à toutes les efpèces de Sable.
Vpye\ ce mot.
C ’eft le Sablon plutôt que le fable qui fait la
bafe de la compofition du v erre, qui entre dans
celle des poteries, qu’on emploie pour fervîr de
moule dans la fonte des métaus, pour polir ces
métaux, pour nettoyer les uflenfiles de cuifine
& c . & c . ; . . . ’
* agriculteur , le,Sablon diffère peu du fable.
Voy. Sablonneux & Terre de bruyère-
voycj; auflî Dune & Lanhe. (Bore.)
SABLONNEUX (Terrains). Ce font ceux où
dominent des fragmens de quartz plus ou moins'
gros , mais de moins d’un pouce de diamètre. Il y
a auflî des terrains fablonneux formés par dés frag-
mens de roches calcaires & de roches argileufes
mais ils font rares. - *
. .. „ „ luiiueux peuvent erre tormes
de Sablon, de Sable ou de Gravier."
( royeç ces trois mots.) Lorique les pierrès font
en majeure partie.de plus d’un pouce de diamètre,
on dit que le terrain eft Caillouteux-, qu’il eft
formé de Pierres roulées ou de Galets.
y oyt^ ces mots.
Mais il eft rare que les terrains fablonneux, lorf-
que des graviers furtout les conftituent, ne contiennent
que de petits fragmens : ils en offrent de
toute grofleur, même de plufieurs pieds de diamè-
tre; feulement les gros y font rares , & d’autant
plus qu.ils le font davantage. P’byej Ro ch e .
Pour peu qu’ on examine la nature des pierres
des terrains fablonneux & la poficion de ces terrains,
relativement aux montagnes primitives fie
aux rivières qui en defeendent, on ne peut fe retirer
a reconnoître qu’ils font les produits delà
decompohtion de ces montagnes, produits entraînes
par les eaux & dépotés dans les vallées &
dans les plaines en fragmens d’autant plus petits,
quiis éloignant davantage de leur origine.
Aujourd’hui cette décompofirion des montagnes
elt lente ; mais elle étoit très-aélive lorfque les
Alpes, par exemple , avoient fix à huit fois plus
de hauteur, & que les.fleuves qui en découlent
rouloient fix à huit fois plus de volume d’eau.
Y oy ei Montagne, Roche & T orrent.
Prefque partout les fables & les graviers de ces
terrains font mélangés d’argile pure ou d’argile
melee avec du calcaire, qui provient auflî de la dé-
pofition phyfîqu.e & chimique des mêmes montagnes.
V-jyef Galet & Roche.
Lorfque les terrains fablonneux contiennent de
argile & du calcaire en proportion convenable
qu’ils renferment de plus, à leur furfac'e, une
certaine quantité d Humus ou terre végétale ils
font les plus ferrites, parce que le fable & le gra- '
vier, par l ’effet des labours, laiffent entr’eux de
petits mterftices où les racines des plantes pénètrent
pour aller au loin chercher la nourriture
qui leur eft néceflaire : dans ce c a s , on die que la
terre eft Arable, eft Franche, eft Bonne,& c.;
efte eft excellente fi la portion d’humus eft plus
'■ onfiderable. Voyei Terre.
Ici ce font les terres fablonneufes avec excès de
fable ou de gravier* celles qui contiennent fort
peu d’humus, qui laiffent paffer ou évaporer très-
rapidement les eaux des pluies, que je dois exclufi-
vemenc confidérer : on les appelle T erres légères
T erres a seigle, T erres a sa r r a s in .
Voyei ces mots & celui Terre de bruyère.
Comme il y a des terres fablonneufes dans lef-
quelles le fable , domine dans toutes les proportions,
il faut les divifer en trois qualités, celles
qui font très fablonneufes, celles qui font peu
fablonneufes, & celles qui font entre les deux. I!
elt bon auflî de faire attention à leur plus ou
moins de profondeur, parce que cette circonf-
tancè influe fur leurs produirions , & doit influer
par conféquent fur leur culture.. La plaine des*
Sablons près Paris, par exemple, où l’épaiffeur
fablonneufe eft de trente à quarante pieds , ne
peut être traitée comme les landes de Bordeaux,
où cetfce épaiffeur n’ eft que de fix pouces, terme
moyen. Voye^ Landes.
Ainlï que je l’ai déjà dit plufieurs fois, c’efi
l’argile qui manque aux terres fablonneufes : ainfi,
c’eit en y en apportait qu’on peut les améliorer 3
mais le tranfport de cette argile eft fouvent impof-
flîble ; &" lorfqu’il eft poflible, il devient>fi coûteux
, qu’ on ne peut l’effeétuer que pour de petites
portions confacrées à la culture des légumes
eu à des plantations d’arbres précieux.
L'argile manquant, les eaux pluviales ne fé-
journent pas dans les fols fablonneux auflî longtemps
qu’ il feroit néceffaire à la bonne végétation
des plante.s qu’on y cultive : on peut donc les rendre
auflî productives que de plus argileufes, en les
arrofant foit à la main, foit avec des machines hydrauliques
, foie par des déviations d’eaux d’é tangs,
de rivières, de fontaines 5 moyens qui,
comme dans le cas précédent, ne font pas toujours
praticables, & qui, quand ils le font, deviennent •
fouvent fort coûteux. Voyeç Arrosement &
Irrigation. .
C ’eft donc, la plupart du temps, à tirer parti des
terres fablonneufes dans leur état naturel, que doit
tendre le cultivateur qui travaille ppur le profit.
Il eft beaucoup de plantes & même d’arbuftes
qui, par leur organifation , font appelés à croître
dans les terrains fablonneux : un bon cultivateur
faura d’abord en tirer parti pour y établir des
Pâturages, foit permanens, foit temporaires
( v°yei ce mot), pour les couvrir de buiffons qui
fourniront au moins des fagots propres à chauffer
le four & faire bouillir la marmite.
Le pâturage des terrains fablonneux eft peu
abondant, mais de très-bonne nature : il convient
principalement aux moutons.
Les plus communs des arbres, arbriffeaux &
arbuftes qui fe plaifent dans les lieux fablonneux ,
font les Pins maritime, La ricio , d’E coffe, du
Nord, de Genève, d’Alep? les Chênes rouvre
& toza 5 I’Orme? le Peuplier blanc 5 le Bouleau
? I’Erable commun & celui- de Montpellier?
le Saule marfaulc? celui des fables? le
Frêne à fleur? le Sureau; le Chaleç ? le
Tamarix? le Genet ; le Lilas ? le Lic ie t j
I’Épine-vinette. Plufieurs de ces arbres lo ht
de première grandeur & d'un bois de première
qualité. 11 eft donc poflible de créer des forêts
dans les terrains fablonneux , & on y en voit fou-
vent. Pourquoi donc tant d*e terrains de ce genre
font-ils improductifs ? Parce que leurs propriétaires
font ou ignorans ou trop peu riches pour
faire les avances néceffaires.
Je dois dire de plus que les plantations de bois
dans les terrains fablonneux minquent fouvent ,
parce qu’ on ne prend pas, dans les deux ou trois
premières années , les précautions néceffaires
pour en affurer la réuflite. Ce font les féchereffes
de l’été qui font périr le plant encore peu pourvu
de racines ; eh bien, préfervez-le de ces féche-
reffes par des plantations de genêt, de ronces,
de grandes plantes vivaces , affez rapprochées
pour garantir la furface du fol de l’aétion dtffé-
chante des rayons du foleil. Parmi ces plantes,
je recommande particulièrement le topinambour ,
q u i, femé près à près en rayons , du levant au
couchant, rayons efpaeés de quatre à fix pieds ,
remplira toutes les conditions & donnera de
plus une récolte de tiges propres à faire de la
potaffe, & une demi-récolte de tubercules fort
du goût des beftiaux.
Toutes les plantes annuelles dont la récolte
fe fait de bonne heure au printemps, font cultivées
avec plus d’avantages que les autres dans
les terrains fablonneux, parce qu elles font moins
dans le cas de craindre les féchereffes, puifque
c’ eft principalement dans l’été qu’elles font les
plus fréquentes & les plus intenfes : ajoutez à
cela que ces terrains , à raifon de la petite quantité
d’eau qu'ils confervent & de la perméabilité
de leurs molécules par les rayons du foleil, font,
toutes chofes égales d’ailleurs, beaucoup plus précoces
que ceux qui font argileux: auflî, parmi
les céréales, eft-ce le feigle , eft-ce l’orge d hiver
qui y réuflî fient le mieux ; parmi les plantes à graines
huileufes , la navette d’hiver? parmi les légumes,
les pois, les haricots de primeur. Il eft, dans les
environs de Paris, des terrains qui ailleurs ne
rapportent pas trois francs de revenu, dont on
tire trois cents francs & plus, par le moyen de
ces dernières cultures. F o y q P o is & Haricot.
La grandeur des bénéfices que produit la culture
des primeurs dans les environs de Paris y a
introduit un genre de culture qui n’eft pas connu
autre part, & que j’ai le premier décrit dans la
Bibliothèque des propriétaires ruraux. Elle eft principalement
en faveur dans les communes de
Houilles & de Monteffon, fituées au bas de la
terraffe de Saii*r'Germain. L à , deux hommes,