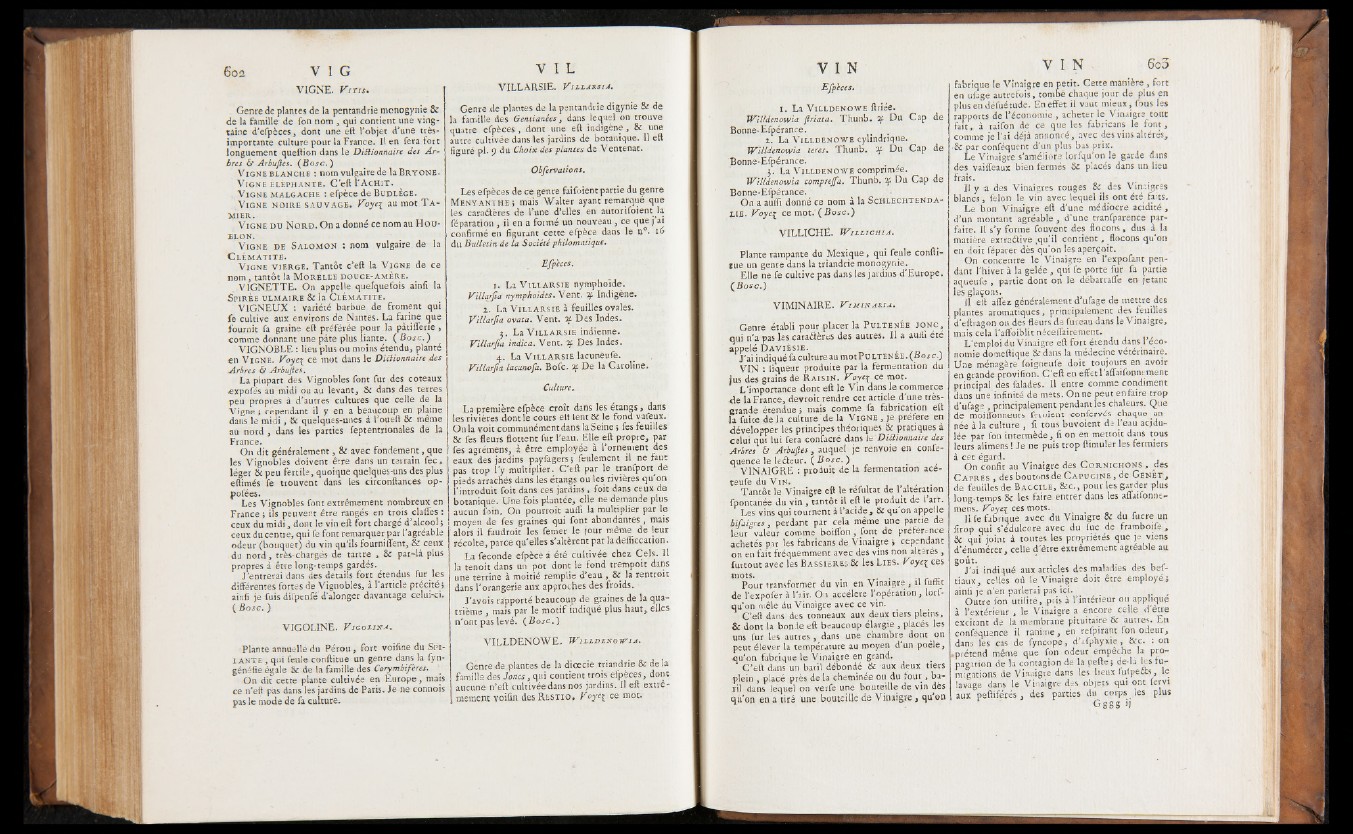
V I G
VIGNE. V i n s .
V I L
VILLARSIE. VlLLARSlA.
Genre de plantes de la pentandrie monogynie &
de la famille de fon nom * qui contient une vingtaine
d’ efpèces* dont une eft l'objet d'une très-
importante culture pour la France. Il en fera fort
longuement queftion dans le Dictionnaire des Arbres
& Arbuftes. (B o sc . )
V igne blanche : nom vulgaire de la Bryone.
V i g n e é l é p h a n t e . C'eft Ï’A c h i t .
, V igne malgache : efpèce de Budlêge.
V igne noire sauvage. Voyei au mot T a -
mier.
V igne du Nord . On a donné ce nom au Houblon.
V igne de Salomon : nom vulgaire de la
C lématite.
V igne vierge. Tantôt c’eft la V igne de ce
nom j tantôt la Morelle douce-amère.
. VIGNETTE. On appelle quelquefois ainfi la
5pir.ee ulmaire & la C lématite.
V 1GNEUX : variété barbue de froment qui
fe cultive aux environs de Nantes. La fàr*.ne Sue
fournit fa graine eft préférée pour la pâtifferie,
comme donnant une pâte plus liante. ( B o sc .)
VIGNOBLE : lieu plus ou moins étendu* planté
en Vigne. Voye\ ce mot dans le Dictionnaire des
Arbres & Arbujies.
La plupart des Vignobles font fur des coteaux
expofés au midi ou au levant* & dans des terres
peu propres à d'autres cultures que celle de la
Vigne 5 cependant il y en a beaucoup en plaine
dans le midi * & quelques-unes à l'oueft Sc même
au nord , dans les parties feptentrionales de la
France.
On dit généralement * & avec fondement, que
les Vignobles doivent être dans un terrain fec,
léger & peu fertile, quoique quelques-uns des plus
eftimés fe trouvent dans les circonftances op-
pofées.
Les Vignobles font extrêmement nombreux en
France ; ils peuvent être rangés en trois claffes :
ceux du midi * dont le vin eft fort chargé d alcool >
ceux du centre, qui fe font remarquer par l’agréable
odeur (bouquet) du vin qu’ils fourniffent* & ceux
du nord* très-chargés de tartre * & par-là plus
propres à être long-temps gardés.
J'entrerai dans des détails fort étendus fur les
différentes fortes de Vignobles, à l’article précité >
ainfi je fuis difpenfé d alonger davantage celui-ci.
( Bosc. )
VIGOLINE. V ig o l ina .
Plante annuelle du Pérou * fort voifine du S p i -
lante , qui feule conftitue un genre dans la fyn-
généfie égale & de la famille des Corymbifères. \
On dit cette plante cultivée en Europe* mais
ce n’eft pas dans les jardins de Paris» Je ne connois
pas le mode de fa culture.
Genre de plantes de la pentandrie digynie & de
la famille des Geniianées * dans lequel on trouve
quatre efpèces , donc une eft indigène, & une
autre cultivée dans les jardins de botanique. Il eft
figuré pl. 9 du Choix des plantes de Ventenat.
Obfervations.
Les efpèces de ce genre faifoient partie du genre
Menyanthe ; mais Walter ayant remarqué que
les caractères de l'une d’elles en autorifoient Ja
réparation * il en a formé un nouveau, ce que j'ai
confirmé en figurant cette efpèce dans le n°. 16
du Bulletin de la Société philomatique.
Efpèces.
i. La V illarsie nymphoïde.
Villarfia nymphoides. Vent. 2f Indigène.
2. La V illarsie à feuilles ovales.
Villarfia ovata. Vent. 2f Des Indes.
3. La V illarsie indienne.
Villarfia indica. Vent. y- Des Indes.
4. La V illarsie lacunëufe.
Villarfia lacunofa. Bofc. if. De la Caroline.
Culture.
La première efpèce croît dans les étangs > dans
les rivières dont le cours eft lent & le fond vafeux.
Onia voit communément dans la Seine } fes feuilles
& fes fleurs flottent fur l’eau. Elle eft propre* par
fes agrémens, à être employée à l’ornement des
eaux des jardins payfagers i feulement il ne faut
pas trop l ’y multiplier. C ’eft par le tranfport de
pieds arrachés dans les étangs ou les rivières qu’on
l’ introduit foit dans ces jardins, foit dans ceux de
botanique. Une fois plantée* elle ne demande plus
aucun foin. On pourroit auffi la multiplier par le
moyen de fes graines qui font abondantes, mais
alors il faudroit les femer le jour meme de leur
récolte* parce qu’ elles s’altèrent par la defliccation.
La fécondé efpèce i été cultivée chez Cels. Il
la tenoit dans un pot dont le fond trempoit dans
une terrine à moitié remplie d'eau , & la rentroit
dans l'orangerie aux approches des froids.
J’avois rapporté beaucoup de graines de la quatrième
* mais par le motif indiqué plus haut* elles
n’ ont pas levé. ( B o s c . )
V IL LDEN OW E . Willdeno tt ia .
Genre de,plantes de la dioecie triandrie & de la
famille des Joncs 3.qui contient trois efpèces* dont
aucune n’eft cultivée dans nos jardins. Il eft extrêmement
voiûn. des Restio. Voye£ ce mot.
Efpèces.
1. La Villdenowe ftriée.
Willdenowia ftriata. Thunb. 2f Cap de
Bonne-Efpérance.
1. La Villdenowe cylindrique.
Willdenowia teres. Thunb. 2^ Du Cap de
Bonne-Efpérance.
3. La V illdenowe comprimée.
Willdenowia comp>reffa. Thunb. 2f Du Cap de
Bonne-Efpérance. \
On a auffi donné ce nom à la Schlechtenda-
LIE. Voye^ ce mot. (B o s c .)
V I L L I C H É . W i l l i c h i a .
Plante rampante du Mexique, qui feule conftitue
un genre dans la triandrie monogynie.
Elle ne fe cultive pas dans les jardins d’Europe.
(B o s c .)
V IM IN A I R E . VIM IN ARIA.
Genre établi pour placer la P u l t e n é e j o n c *
oui n’ a pas les cara&ères des autres. Il a auffi été
appelé D a v i é s i e . , . .
J’ai indiqué fa culture au motPuLTENEE. (pose.)
VIN : liqueur produite par la fermentation du
jus des grains de Raisin. Voyeç ce mot.
L'importance dont eft le Vin dans le commerce
de la France, devroit rendre cet article d’une très-
grande étendue j mais comme fa fabrication eft
la fuice de la culture de la Vigne * je préfère en
développer les principes théoriques & pratiques à
celui qui lui fera confacré dans Dictionnaire des
Arbres & Arbuftes * auquel je renvoie en confe-
quence le le&eur. ( B o s c . )
VINAIGRE : produit de la fermentation acé-
teufe du V i n . , tJ , , .
Tantôt le Vinaigre eft le refultat de 1 alteration
fpontanée du vin , tantôt il eft le produit de l art.
Les vins qui tournent à l’acide* & qu on appelle
bifaigres * perdant par cela même une partie de
leur valeur comme boiffon * font de préférence
achetés par les fabricans de Vinaigre > cependant
on en fait fréquemment avec des vins non altérés *
furtout avec les Bassieres & les Lies. Voye[ ces
*n°ts. I . .
Pour transformer du vin en Vinaigre, il fumt
de l’expofer à l’air. On accéléré l’opération* lorf-
qu’on mêle du Vinaigre avec ce vin.
C ’eft dans des tonneaux aux deux tiers pleins,
& dont la bonde eft beaucoup élargie, placés les
uns fur les autres, dans une chambre dont on
peut élever la température au moyen d un poêle*
qu'on fabrique le Vinaigre en grand.
C ’ eft dans un baril débondé Sc aux deux tiers
plein * placé près de la cheminee ou du four » baril
dans lequel on verfe une bouteille de vin dès
qu’on en a tiré une bouteille de Vinaigre * qu’on
fabrique le Vinaigre en petit. Cette manière, fort
en ufage autrefois, tombe chaque jour de plus en
plus en défuétude. En effet il vaut mieux, fous les
rapports de l’ économie, acheter le Vinaigre tout
fait, à raifon de ce que les fabricans le font*
comme je l’ai déjà annoncé* avec des vins altérés* .
<& par conféquent d’un plus bas prix.
Le Vinaigre s’améliore lorfqu’on le garde dans
des vaiffeaux bien fermés Sc placés dans un lieu
frais.
Il y a des Vinaigres rouges & des Vinaigres
blancs * félon le vin avec lequel ils ont été faits.
Le bon Vinaigre eft d’une médiocre acidité,
d’un montant agréable * d’une tranfparence parfaite.
Il s'y forme fouvent des flocons, dus à la
matière extraélive kqu’ il contient, flocons qu’on
en doit féparer dès qu'on les aperçoit.
On concentre le Vinaigre en l’expofant pendant
l'hiver à la gelée * qui fe porte fur fa partie
aqueufe , partie dont on le débarraffe en- jetant
les glaçons.
Il eft affez généralement d’ ufage de mettre des
plantes aromatiques, principalement des feuilles
d'eftragon ou des fleurs de fureau dans le Vinaigre,
mais cela l'affoiblit néceflairement.
L ’emploi du Vinaigre eft fort étendu dans l’économie
domeftique & dans la medecine vétérinaire.
Une ménagère foigneufe doit toujours en avoir
en grande provifion. C'eft en effet 1 affaifonnement
principal des falades. Il entre comme condiment
dans une infinité de mets. On ne peut en faire trop
d’ ufage , principalement pendant les chaleurs. Que
de moiffonneurs fc-roient confervés chaque année
à la culture , fi tous buvoient de l’eau acidulée
par fon intermède* fi on en mettoic dans tous
leurs alimens! Je ne puis trop ftimuler les fermiers
à cet égard. . . . H ,
On confit au Vinaigre des C ornichons , des
C âpres , des boutons de C apucine , de Genet *
de feuilles de Baccile, & c., pour les garder plus
long-temps & les faire entrer dans les affaifonne--
mens. Voye% ces mots.
li fe fabrique avec du Vinaigre & du fucre un
firop qui s’édulcore avec du fuc de framboife *
& qui joint à toutes les propriétés que je viens
d’énumérer* celle d'être extrêmement agréable au
J’ai indiqué aux articles des maladies des bef-
tiaux* celles où le Vinaigre doit être employés
ainfi je n’en parlerai pas ici.
Outre fon utilité, pris à l'intérieur ou appliqué
à l’extérieur , le Vinaigre a encore celle detre
excitant de la membrane pituitaire & autres. En
conféquence il ranime * en refpirant fon odeur*
dans les cas de fyncope, d afphyxie, Scc. : on
•prétend même que fon odeur empêche la propagation
de la contagion de la pefte ; de-là les fumigations
de Vinaigre dans les lieux fulpeâs* le
lavage dans le Vinaigre des objets qui ont fervi
aux peftiférés * des parties du corps les plus
G g g g ij