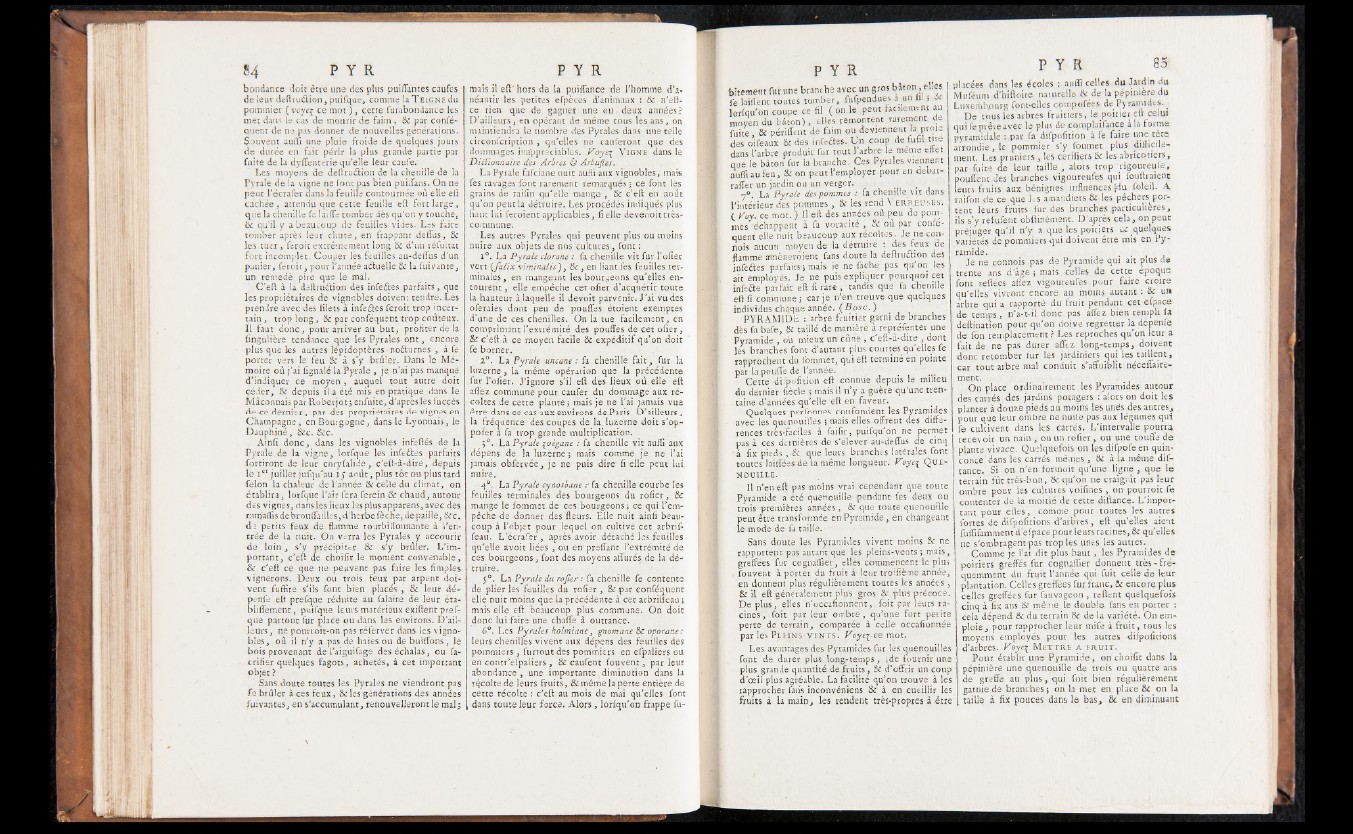
bondance doit être une des plus puiffantes caufes
de leur deftru&ion, puifque, comme la T eigne du
pommier (voyq; ce m o t ) , cette furabondance les
met dans le cas de mourir de faim , & par conféquent
de ns,pas donner de nouvelles générations.
Souvent suffi une pluie froide de quelques jours
de durée en fait périr la plus grande partie par
fuite de la dyffenterie qu’elle leur caufe.
Les moyens de deflruétion de la chenille de la
Pyrale de la vigne ne font pas bien puiffans, On ne
.peut l’écrafer dans la feuille contournée où elle eff
cachée, attendu que cette feuille eff fort large,
que la chenille fe 1 aille tomber dès qu'on y touche,
& qu'il y a beaucoup de feuilles vides. Les faire
tomber après leur chute, en frappant delïus, &
les tuer, feroit extrêmement long & d’un rëfuitat
fort incomplet. Couper les feuilles au-deflfus d'un
panier, feroit, pour l’année aétuelle & la fui van te ,
un remedè pire que le mal.
C ’eft à la daffruélion des infeétes parfaits, que
les propriétaires de vignobles doivent tendre. Les
prendre avec des Blets à infeétes feroit trop incertain
, trop long, & par conféquent trop coûteux.
Il faut donc, pour arriver au but, profiter de la
lingulière tendance que les Pyrales o n t , encore
plus que les autres lépidoptères noéturnes , à fe
porter vers le feu & à s’y brûler. Dans le Mémoire
où j’ai fignalé la Pyrale , je n’ai pas manqué
d’ indiquer ce moyen , auquel tout autre doit
céder, & depuis il a été mis en pratique, dans le
Maçonnais par Roberjot; erffuité, d’après les fuccès
de ce dernier, par des propriétaires de vignes en
Champagne, en Bourgogne, dans le Lyonnais, le
Dauphiné, &c. & c .
Ainfî donc, dans les vignobles infeftés de la
Pyrale de la vigne, lorfque les infeétes parfaits
fortiront de leur cnryfalide, c ’eft-à-dire, depuis
le Ier juillet jufqu’au i j août, plus tôt ou plus tard
félon la chaleur de l'année & celle du climat, on
établira, lorfque l’ air fera ferein & chaud, autour
des vignes, dans les lieux les plus apparens, avec des
ranfaffis de brouffailles, d’herbe fèche, de paille, ikc.
de petits feux de flamme tourbillonnante à Centrée
de la nuit. On verra les Pyrales y accourir
de lo in , s’y précipiter & s’y brûler. L’ important,
c’eft de choifir le moment convenable,
& c’ eft ce que ne peuvent pas faire les Amples
vignerons. Deux ou trois feux par arpent doivent
fuflire s’ ils font bien placés, & leur dé-
penfe eff prefque réduite au falaire de leur éta-
hliffement, puifque leurs matériaux exiftent prefque
partout fur place ou dans les environs. D ’ailleurs,
ne pourroit-on pas réferver dans les vignobles,
où il n’y a pas de haies ou de buiffons, le
bois provenant de l’aiguifage deséchalas, ou fa-
crifier quelques fagots, achetés, à cet important
objet ?
Sans doute toutes les Pyrales ne viendront pas
fe brûler à ces feux, &les générations des années
fuivantes, en s’accumulant, renouvelleront le mal ;
mais il eff' hors de la puiffance de l’homme d’anéantir
les petites efpèces d’animaux : & n’eft-
ce rien que de gagner une ou deux années ?
D ’ailleurs, en opérant de même tous les ans, on
maintiendra le nombre des Pyrales dans une telle
circonfcription , qu’elles ne eau feront que des
dommages inappréciables. Voye{ V igne dans le
DiSiicmnaire des Arbres & Arbufles.
La Pyrale fafeiane nuit aufli aux vignobles, mais
fes ravages font rarement remarqués ; ce font les
grains de raifin qu’elle mange, & c ’eff en août
qu’ on peut la détruire. Les procédés indiqués plus
haut lui feroient applicables, fi elle devenoit très-
commune.
Les autres Pyrales qui peuvent plus ou moins
nuire aux objets de nos cultures, font :
1°. La Pyrale clorane : fa chenille vit fur l’ofier
vert\ fq lix viminalis) , & , en liant/es feuilles terminales
, en mangeant les bourgeons qu’elles entourent
, elle empêche cet ofier d’acquérir toute
la hauteur à laquelle il devoit parvenir. J’ai vu des
oferaies dont peu de pouffes étoient exemptes
d’une de ces chenilles. On la tue facilement, en
comprimant l’extrémité des pouffes de cet ofier,
& c’eft à ce moyen facile & expéditif qu’on doit
fe borner.
2°. La Pyrale, uncane : fa chenille fa it , fur la
luzerne, la même opération que la précédente
fur l’ofier. J’ignore s’il eff des lieux où èlle eff
affez commune pour caufer du dommage aux récoltes
de cette plante ; mais je ne l’ai jamais vue
être dans ce cas aux environs de Paris. D’ailleurs,
la fréquence des coupes de la luzerne doit s’op-
pofer à fa trop grande multiplication.
3°. La Pyrale [oégane : fa chenille vit aufli aux
dépens de la luzerne 5 mais comme je ne l’ ai
jamaissobfervée, je ne puis dire'fi elle peut lui
nuire.
4®. La Pyrale cynosbane ? fa chenille courbe les
feuilles terminales des bourgeons du rofier, &
mange le fommet de ces bourgeons ; ce qui l’empêche
de donner des fleurs. Elle nuit ainfi beaucoup
à l’objet pour lequel on cultive cet arbrif-
feau. L ’écrafer , après avoir détaché les feuilles
qu'elle avoir liées , ou en preffanc l’extrémité de
ces bourgeons, font des moyens affurés de la détruire.
50. La Pyrale du rofier : fa chenille fe contente
de plier les feuilles du rofier , & par conféquent
elle nuit moins que la précédente à cet arbriffeau ;
mais elle eff beaucoup plus commune. On doit
donc lui faire une chaffe à outrance.
6°. Les Pyrales holmiane, gnomàne & oporane:
leurs chenilles vivent aux dépens des feuilles des
pommiers , furtout des pommiers en efpaliers ou
en contr’efpaliers, & caufent fouvent, par leur
abondance, une importante diminution dans la
récolte de leurs fruits, & même la perte entière de
cette récolte : c’ eft au mois de mai qu’elles font
, dans toute leur force. A lo r s , lorfqu’ on frappe fubitement
fur une branche avec un gros bâton .elles
fe biffent toutes tomber, fufpendues a un ni ; «
lorfqu'on coupe ce fil ( on le peut facilement au
moyen du bâton), elles remontent rarement de
fuite & .pénitent de faim ou deviennent b proie
des oiféaux & des infcâes. Un coup de fufil tire
dans l'arbre produit fur tout 1 arbre- le meme effet
que le bâton fur la branche. Ces Pyrales viennent
aufli au feu, & on peut l'employer pour en debar-
rafler un jardin ou un verger.
•70. La Pyrale des pommes : fa chenille vit dans
l’intérieur des pommes , & les rend V er reu se s.
( Voy. ce mot. ) Il eff des années où peu de pommes
échappent à fa voracité, & ou par confe-
quent elle nuit beaucoup aux récoltes. Je necon-
nois aucun moyen de la détruire : des feux de.
flamme amèneroient fans doute la deftru&ion des
infeétes parfaits, mais je ne fâche pas qu on les
ait employés. Je ne puis expliquer pourquoi cet
infeéte parfait eft fi rare , tandis que fa chenille'
eff fi commune j car je r/en trouve que quelques
individus chaque année. (B a s e , )
PYRAMIDE : arbre fruitier garni de branches ;
dès fa bafe, & taillé de manière à repréfenter une
Pyramide , ou mieux un cône , c’eft-à-dire , dont
les branches font d’autant plus courtes qu’elles fe
rapprochent du fomnaet, qui eft termine en pointe
par la pouffe de l’année. . ...
Cette difpofition eft connue depuis le milieu
du dernier fiècle j mais il n’ y a guère qu’une trentaine
d’années qu’elle eft en faveur.
Quelques perfonnes confondent les Pyramides
avec les quenouilles j mais elles offrent des différences
très-faciles à faifir, puifqu’on ne permet
pas à ces dernières de s’élever au-deffus de cinq
à fix pieds , &. que leurs branches latérales font
toutes laiffées de la même longueur. Voye[ Quenouille.
Il n’en eft pas moins vrai cependant que toute
Pyramide a été quenouille pendant fes deux ou
trois premières années, & que toute quenouiile
peut être transformée en Pyramide, en changeant
lé mode de fa taille.'
Sans doute les Pyramides vivent moins & ne
rapportent pas autant que les pleins-vents; mais,
greffées fur cognaflïer, elles commencent le plus
; fouvent à porter du fruit à- leur troifième année,
en donnent plus régulièrement toutes les années ,
& il eft généralement plus gros & plus précoce.
De plus, elles n'occafionnent, foit par leurs racines,
foit par leur ombre, qu’ une fort petite
placées dans les écoles ; aufli celles du Jardin du
Muféum d’hiftoire naturelle & de là pépinière du
Luxembourg font-elles cpmpofées de Pyramides. .
De tous les arbres fruitiers, le poirier eft celui
qui fe prête avec le plus de complaifance à ia forme
pyramidale : par fa difpofition à fe faire une tête
arrondie, le pommier s’y foumet plus difficilement.
perte de terrain, comparée à celle occafionnée
par les Pleins-vents. Poyei-ce mot.
Les avantages des Pyramides fur les quenouilles
font de durer plus, long-temps, j.de fournir une
plus grande quantité de fruits, & d’offrir un coup
d'oeil plus agréable. La facilité qu’on trouve à les
rapprocher faiis inconvéniens & à en cueillir les
fruits à la main, les rendenç très-propres à être
Les pruniers, les cerifiers & les abricotiers,
par fuite de leur taille , alors trop rigoureufe,
pouflent des branches vigoureufes qui failliraient
leurs fruits aux bénignes influences jdu foleil. A
raifon de ce que Us amandiers & les pêqhers portent
leurs fruits fur des branches particulières,
ils s’y refufent obftinément. D'après cela, on peut
préjuger qu’ il n’y a que les poiriers ^ quelques
variétés de pommiers qui doivent être mis en Pyramide.
Je ne connois pas de Pyramide qui ait plus de
trente ans d'âge ; mais celles de cette époque
font reftées allez vigoureufes pour faire croire
qu’elles vivront encore au moins autant : & un
arbre qui a rapporté du fruit pendant cet efpace
de temps, n’a-t-il donc pas affez bien rempli fa
deftination pour qu’ on doive regretter la dépenfe
de fôn remplacement ? Les reproches qu’on leur a
fait de ne pas durer affez long-temps, doivent
donc retomber fur les jardiniers qui les taillent,
car tout arbre mal conduit s’affaiblit néceffaire-
ment.
On place ordinairement les Pyramides autour
des carrés des jardins potagers : alors on doit les
planter à douze pieds' au moins les unés des autres,
pour que leur ombre ne nuife pas aux légumes qui
fe cultivent dans les carrés. L’ intervalle pourra
recevoir un nain, ou un rofier, ou une touffe de
plante vivace. Quelquefois on les difpofe en quinconce'dans
les carrés mêmes, & à la même dif-
tance. Si on n’en formoit qu’une ligne , que le
terrain fût très-bon, & qu’on ne craignît pas leur
ombre pour les cultures voifines, on pourroit fe
contenter de la moitié de cette diftance. L’important
pour elles, comme pour toutes les autres
fortes de difpofitions d’arbres, eft qu’elles aient
fuffifamment d’efpace pour leurs racines, & qu’elles
ne s ’ombragent pas trop les unes les autres.
Comme je l’ai dit plus h au t, les Pyramides de
poiriers greffés fur cognaflïer donnent trè s -fré quemment
du fruit l’année qui fuit celle de leur
plantation. Celles greffées fur franc, & encore plus
celles greffées fur fauvageon , relient quelquefois
cinq à fix ans & même le double fans en porter :
cela dépend & du terrain & de la variété. On emploie,
pour rapprocher leur mife à fruit, tous les
moyens employés pour les autres -difpofitions
d’arbres, Poye^ METTRE A FRUIT.
Pour établir une Pyramide, on chojfit dans la
pépinière une quenouille de trois ou quatre ans
de greffe au plus, qui foit bien régulièrement
garnie de branches; on la met en place & on la
, taille à fix pouces dans le bas, 8c en diminuant