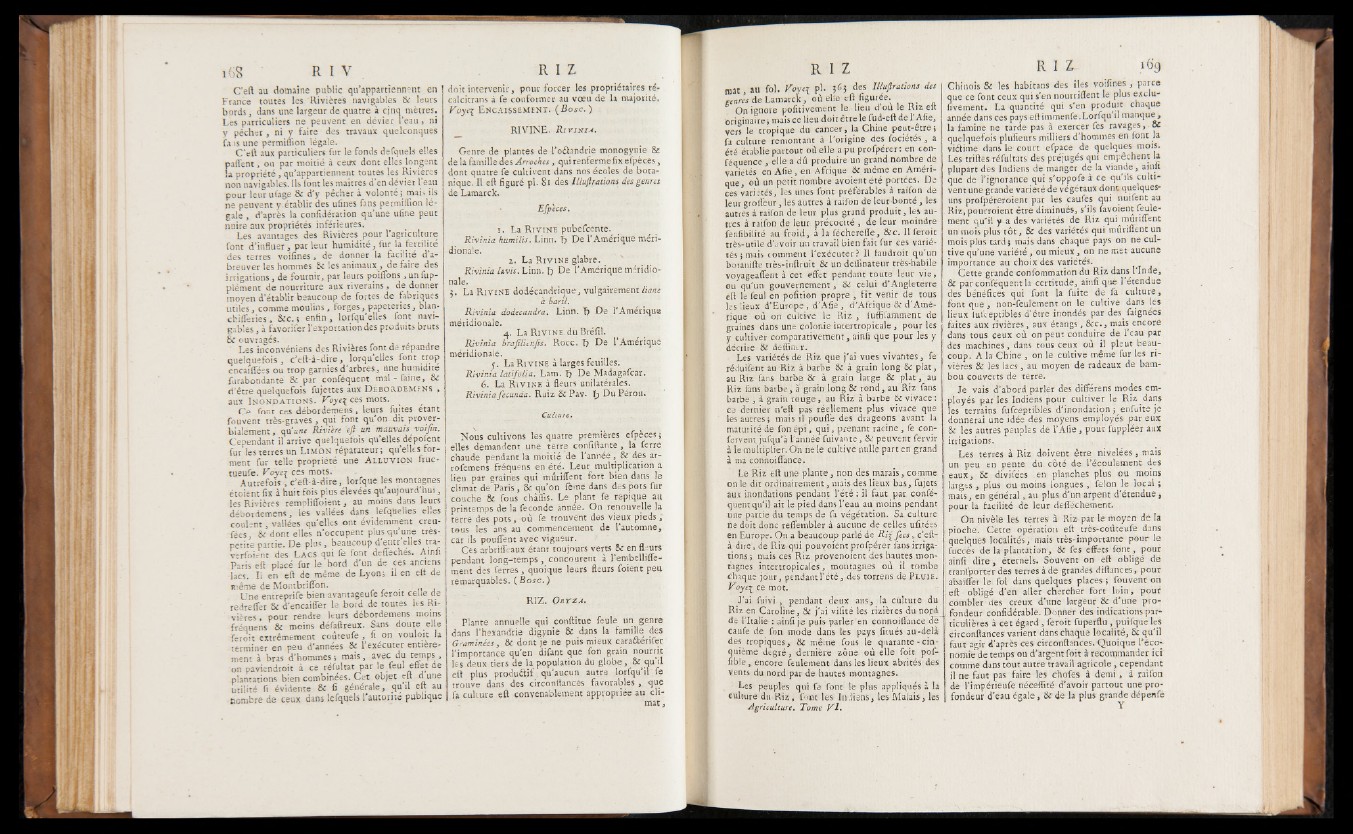
C e ft au domaine public qu’ appartiennent en !
France toutes les Rivières navigables 8c leurs
bords j dans une largeur de quatre à cinq mètres.
Les particuliers ne peuvent en dévier l ’eau, ni
y pêcher , ni y faire des travaux quelconques
fa is une permiflion légale.
C ’ eft aux particuliers fur le fonds defquels elles
paffent, ou par moitié à ceux dont elles longent
la propriété 3 qu’appartiennent toutes les Rivières
non navigables. Ils font les maîtres d’en dévier l’eau
pour leur ufage Sc d’y pêcher à volonté; mais ils
ne peuvent y .établir des ufines fans permiflion légale
, d’après la confédération qu’une ufine peut
nuire aux propriétés inférieures.
Les avantages des Rivières pour l’agriculture
font d’ influer3 parleur humidité, fur la fertilité
des terres voifines, de donner la facilité d a-
breuver les hommes 8c les animaux, de faire des
irrigations, de fournir, par leurs poiffons , un fup-
plément de nourriture aux riverains, de donner
moyen d’établir beaucoup de fortes de fabriques
utiles, comme moulins, forges, papeteries, blan-
cfcifferies, 8cc. ; enfin, lorfqu’elles font navigables,
à favorifer l’exportation des produits bruts
& ouvragés.
Les inconvéniens des Rivières font de répandre
quelquefois , c’eft-i-dire , lorqu elles font trop
encaiffées ou trop garnies d’arbres, Une humidité
furabondanté & par conféquent mal - faine, 8c
d’être quelquefois fujettes aux Débordemens ,
aux Inondations. Voye[ ces mots.
Ce font ces débordemens, leurs fuites étant
fouvent très-graves , qui font qu on dit proverbialement,
qu‘une Rivière eft un mauvais voifin.
Cependant il arrive quelquefois qu’elles dépofent
fur les terres un Limon réparateur; qu’elles forment
fur telle propriété une A llüvion fruc-
cueufe. Voye^ ces mots.
Autrefois , c’ eft-à-dire, lorfque les montagnes
étoient fix à huit fois plus élevées qu aujourd hui,
les Rivières rempliffoient, au moins dans leurs
débordemens, les vallées dans lefqUelles elles
coulent, vallées qu’elles ont évidemment creu-
fées, 8c dont elles n’occupent plus qu’une très-
petite partie. De plus, beaucoup d’entr’elles tra-
verfoient des La c s qui fe font deffechés. Ainfi
Paris eft placé fur le bord d’ un de ces anciens
lacs. Ii en eft de même de Lyon; il en eft de
même de Montbriffon.
Une entreprife bien avantageuse feroit cehe de
redreffer & d’ encaiffer le bord de toutes les Rivières
, pour rendre leurs debordemens moins
fréquens & moins défaftreux. Sans doute elle
feroit extrêmement coûteufe, fi on vouloit la
terminer en peu d’années & l’exécuter entièrement
à bras d’hommes ; mais, avec du temps,
on paviendroit à ce réfultat par le feul effet de
plantations bien combinées. C et objet eft d une
utilité fi évidente & fi générale, qu U eft au
nombre de ceux dans lefquels l’autorité publique
doit intervenir, pour forcer les propriétaires ré-
calcitrans à fe conformer au voeu de la majorité.
Voyei Encaissement. ( B o s c . )
RIVINE. R i v i n i a .
Genre de plantes de l’o&andrie monogynie 8c
de la famille des Arroches, qui renfermé fix efpèces,
dont quatre fe cultivent dans nos écoles de botanique.
Il eft figuré pi. 81 des lllufirations des genres
de Lamarck.
Efpèces.
i . La Riv in e pubefcente.
Rivinia humilis. Linn. T? De l’Amérique méridionale.
2. La Rivine glabre.
Rivinia Uvis. Linn. T? De l’Amérique méridionale.
3. La Rivine dodécandrique, vulgairement liane
à baril.
Rivinia dodecandra. Linn. De l’Amérique
méridionale.
4. La Rivine. du Bréfil.
Rivinia brafilitnfis. Rocc. T? De l’Ameriqiie
méridionale.
j-. La Rivine à larges feuilles'.
Rivinia latifolia. Lam. De Madagafcar.
6. La Rivine à fleurs unilatérales.
Rivinia Jecunda. Ruiz & Pav. T) Du Pérou»
Culture.
| Nous cultivons les quatre premières efpèces ;
elles demandent une terre confiftante, la ferre
chaude pendant la moitié de l’année, & des ar-
rofemens fréquens en été. Leur multiplication a
lieu par graines qui mûriffent fort bien dans le
climat de Paris, 8c qu’on feme dans des pots fur
couche 8c fous châflîs. Le plant fe repique au
printemps de la fécondé année. On renouvelle la
terre des pots, où fe trouvent des vieux pieds ,
tous les ans au commencement de l’automne,
car ils pouffent avec vigueur. '
Ces arbrifleaux étant toujours verts 8c en fleurs
pendant long-temps, concourent à l’embelliffe-
ment des ferres, quoique leurs fleurs foient peu
remarquables. (B o s c .)
RIZ. Or y z a .
Plante annuelle qui conftitue feule un genre
dans l’hexandrie digynie 8c dans la famille des
Graminées, 8c dont je ne puis mieux cara&érifer
l’importance qu’en difant que fon grain nourrit
les deux tiers de la population du globe, 8c qu’ il
eft plus productif qu’aucun autre lorfqu’il fe
trouve dans des circonftancês favorables , qup
fa culture eft convenablement appropriée au climat,
mat, au fol. Voye^ pl. 363 des lllufirations des
genres de Lamarck 3 où elle eft figurée.
On ignore pofitivement le,-lieu d ou le Riz eft
briginaire ; mais ce lieu doit être le fud-eft de l’Afie,
vers le tropique du cancer, la Chine peut-etre ;
fa culture remontant à l'origine des fociétés, a
été établie partout où elle a pu profpérer: en con-
féquence , elle a dû produire un grand nombre de
variétés en A fie , en Afrique 8c même en Amérique,
où un petit nombre avoientété portées. De
ces variétés, les unes font préférables à raifon de
leur groffeur, les autres à raifon de leur bonté, les
autres à raifon de leur plus grand produit, les autres
à raifon de leur précocité , de leur moindre
fenfibilité au froid, à la féchereffe, 8cc. Il feroit
très-utile d’avoir un travail bien fait fur ces variétés
; mais comment l'exécuter ? Il faudroit qu’un
botanifte très-inftruit 8c un deflinateur très-habile
voyageaffent à cet effet pendant toute leur v ie ,
ou qu’un gouvernement, 8c celui d’Angleterre
eft le feul en pofition propre , fît venir de tous
les lieux d’ Europe, d’Afie , d'Afrique 8c d'Amérique
où on cultive le Riz , fuffifamment de
graines dans une colonie intertropicale, pour les
y cultiver comparativement, ainfi que pour les y
décrire 8c deflintr.
Les variétés de Riz que j’ ai vues vivantes, fe
réduifent au Riz à barbe 8c à grain long 8c plat, I
au Riz fans barbe 8c à grain large 8c p l a t a u j
Riz fans barbe, à grain long 8c rond, au Riz fans
barbe , à grain rouge, au Riz à barbe 8c vivace :
ce dernier n'eft pas réellement plus vivace que .
les autres.; mais il pouffe des drageons avant la
matutité de fon é p i, qui, prenant racine, fe con-
fervent jufqu’à l'année fuivante, 8c peuvent fervir
à le multiplier. Oh rie le cultive nulle part en grand
à ma connoiffance.
Le Riz eft une plante, non des marais, comme
on le dit ordinairement, mais des lieux bas, fujets
aux inondations pendant l’été : il faut par conféquent
qu’il ait le pied dans l’eau au moins pendant
une partie du temps de fa végétation. Sa culture
ne doit donc reffembler à aucune de celles ufitées
en Europe. On a beaucoup parlé de Ri£ fecs, c’eft-
à-dire, de Riz qui pouvoient profpérer fans irrigations
; mais ces Riz provenoient des hautes montagnes
intertropicales , montagnes où il tombe
chaque jour, pendant l’é té , des torrens de Pluie.
Voye[ ce mot.
J’ai fuivi , pendant deux ans-, la culture du
Riz en Caroline, 8c j’ai vifité les rizières du nofd
de l’Italie : ainfi je puis parler en connoiffance de
caufe de fon mode dans les pays fitués au-delà1
des tropiques , 8c même fous le quarante - cinquième
degré, dernière zone où elle foit pof-
fible, encore feulement dans les lieux abrités des
vents du nord par de hautes montagnes.
Les peuples qui fe font le plus appliqués à la
culture du R iz , font les Indiens, les Malais, les
Agriculture. Tome f 'X
Chinois 8c les habitans des îles voifines , parce
que ce font ceux qui s’en nourriflent le plus exclu-
fivement. La quantité qui s’en produit chaque
année dans ces pays eft immenfe.Lorfqu il manque,
la famine ne tarde pas à exercer fes ravages, &
quelquefois plufieurs milliers d’hommes en font la
viétime dans le court efpace de quelques mois.
Les triftes réfultats des préjugés qui empêchent la
plupart des Indiens de manger de la viande, ainli
que de l’ ignorance qui s’ oppofe à ce qu ils cultivent
une grande variecé de végétaux dont quelques-
uns profpéreroient par les caufes qui nuifent au
Riz, pourroient être diminués, s’ ils favoient feulement
qu'il y a des variétés de Riz qui^mûriffent
un mois plus tô t , 8c des variétés qui mûriflent un
mois plus tard; mais dans chaque pays on ne cultive
qu’une variété, ou mieux, on ne met aucune
importance au choix des variétés.
Cette grande confommation du Riz dans l'Inde,
8c par conféquent la certitude, ainfi que l’étendue
des bénéfices qui font la fuite de fa culture,
font que , non-feulement on le cultive dans les
lieux lulceptibles d’être inondés par desfaignées
faites aux rivières, aux étangs, 8cc., mais encore
dans tous ceux où on peut conduire de i’ eau par
des machines, dans tous ceux où il pleut beaucoup.
A la Chine , on le cultive même fur les rivières
8c les lacs, au moyen de radeaux de bambou
couverts de terre.
Je vais d’abord parler des différens modes employés
par les Indiens pour cultiver le Riz dans
les terrains fufceptibles d’ inondation ; enfuite je
donnerai une idée des moyens employés par eux
8c les autres peuples de i’A fie , pour fupplëer aux
irrigations.
Les terres à Riz doivent être nivelées, mais
un peu en pente du côté de l’écoulement des
eaux, 8c divifées en planches plus ou moins
larges , plus ou moins longues , félon le local ;
mais, en général, au plus d’ un arpent d’étendue,
pour la facilité dé leur defféehement.
On nivèle les terres à Riz- par le moyen de la
pioché. Cette opération eft très-coûteufe dans
quelques localités, mais très-importante pour le
fuccès d elà plantation, 8c fes effets font, pour
ainfi d ire , éternels. Souvent on eft obligé de
; tranfporter des terres à de grandes diftances, pour
? abaiffer le fol dans quelques places ; fouvent on
! eft obligé d’ en aller chercher fort loin , pour
combler des creux d’une largeur 8c d’ une pro-
lfondeur confidérable. Dopner des indications par-
1 ticulières à cet égard, feroit fuperflu, puifque les
! circonftancês varient dans chaque localité, 8c qu’ il
j faut agir d’après ces circonftancês. Quoique l’ éco»-
I nomie.de temps ou d’argent foit à recopimander ici
I comme dans tout autre travail agricole, cependant
\ il ne faut pas faire les chofes à demi, à raifon
de l’impérieufe néceffité d’ avoir partout une pro-
I fondeur d’eau égale, 8cde la plus grande dépenfe