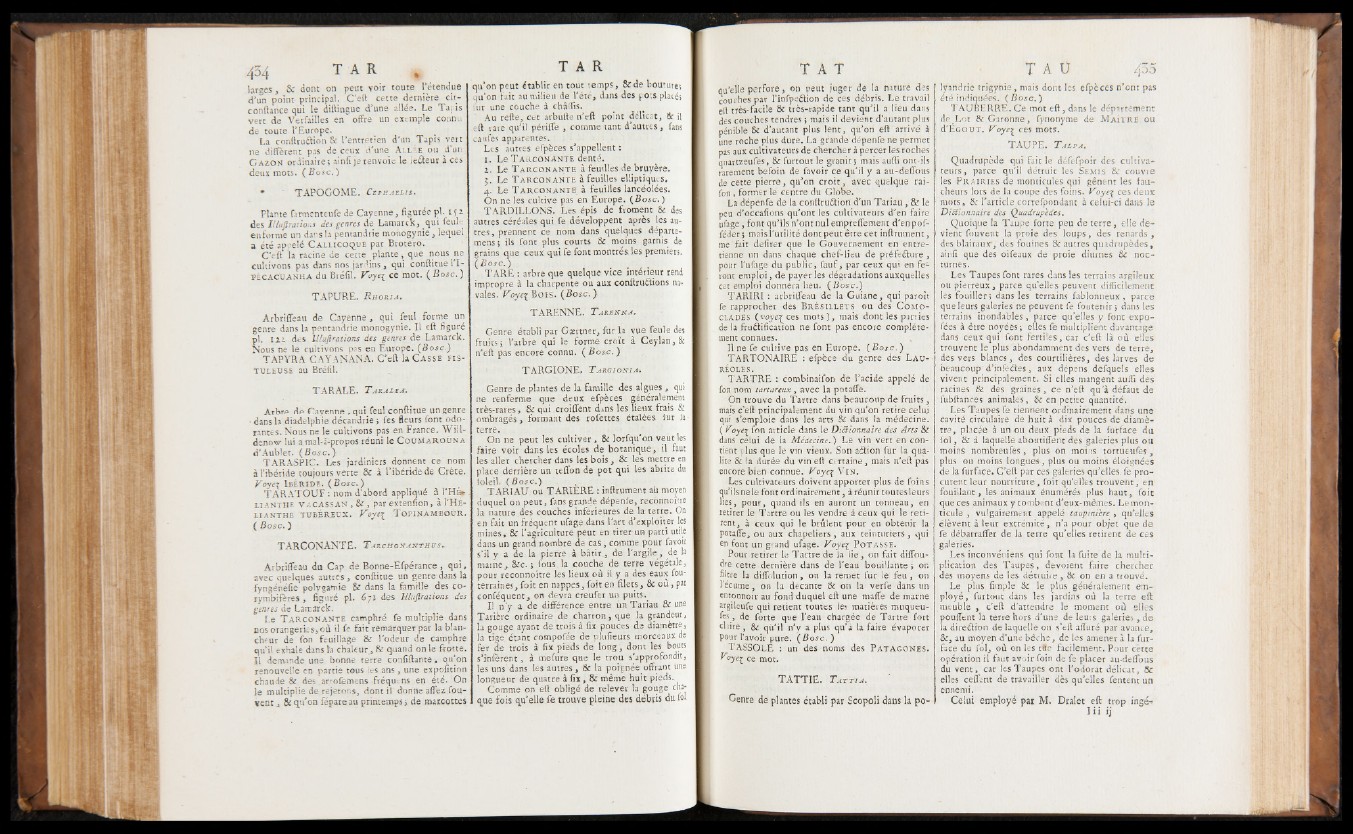
larges , & dont on peut voir toute l’étendue
d’ un point principal. C ’eft cette dernière cir-
conftance qui le diftingue d’une allée. Le Tapis
vert de Verfailles en offre un exemple connu
de toute l’Europe.
La conftruttion & l’entretien d’un Tapis vert
ne diffèrent pas de ceux d’ une Aller ou d’un
G a zon ordinaire; ainfï je renvoie le leéteur à ces
deux mots. ( B o s c . )
• ' TAPOGOME . Cephaelis.
Plante farmenteufe de Cayenne, figurée pl. i J 2
des Illuftrations des genres de Lamarck, qui feule
enforme un dans la pentandrie monogynie , lequel
a été appelé C a llicoque par Brotero.
C ’eft la racine de cette plante, que nous ne
cultivons pas dans nos jardins , qui conftitue 1T-
p é c a cu anh a du Bréfil. Voye^ ce mot. ( Bosc. )
TAPURE. R h o r ia .
Arbriffeau de Cayenne, qui feul forme un
genre dans la pentandrie monogynie. Il eft figuré
pl. 122. des Illuftrations des genres de Lamarck.
Nous ne le cultivons pas en Europe. (Bosc.)
TA P YR A CAYAN AN A . C ’eft la Casse fis-
tuleuse au Bréfil.
TARALE . T aralea.
Arbre de Cayenne , qui feul conftitue un genre
• dans la diadelphie décandrie ; fes fleurs font odorantes.
Nous ne le cultivons pas en France. Will-
denow lui a mal-a-propos réuni le C o um a ro ù n a
d’Aubier. (B o s c .y
TARA SP IC . Les jardiniers donnent ce nom
à l ’ibéride toujours verte & à l’ibéridede Crète.
V o y e \ IbÉRIDE. ( B osc. )
T A R A TO U F : nom d’abord appliqué à l’Hér .
liANTHE vacassan , & , par extenfion, à l’HÉ-
LIANTHE TUBEREUX. Voye^ TOPINAMBOUR.
( Bosc. )
TA R CO N AN TE . T arc ho hahth u s..
Arbriffeau du Cap de Bonne-Efpérance , qui,
avec quelques autres , conftitue un genre dans la
fyngénéfie polygamie & dans la famille des co- rymbifères , figuré pl. des Illuftrations. des
genres de Lamarck. Le T a r c o n a n t e camphré fe multiplie dans
nos orangeries., où il fe fait remarquer par la blancheur
de fon feuillage & l’odeur de camphre
qu’ on peut établir en tout temps, 8cde bouture;
qu’on fait au milieu de l’ été, dans des pots placés
lur une couche à châffis.
Au refte, cet arbulte n’eft point délicat, & il
eft rate qu’ il périffe , comme tant d’autres, fans
caufes apparentes.
Les autres efpèces s’appellent :
qu’il exhale dans ïa chaleur, & quand on le frotte. I
Il demande une bonne terre conftftante, qu’on |
renouvelle en partie tous les ans , une exposition
chaude & des arrofemens fréqu-.. ns en été. On
le multiplie de rejetons, dont il donne affez fou-
vent , & qu’ on fépare au printemps j de marcottes
1. Le T a r co n an te denté.
1. Le T arconante à feuilles de bruyère.
3. Le T arconante à feuilles elliptiques.
4. Le T a r co n a n t e à feuilles lancéolées.
On ne les cultive pas en Europe. (B o s c .)
TARDILLONS. Les épis de froment & des
autres céréales qui fe développent après les autres,
prennent ce nom dans quelques départe-
mens; ils font plus courts & moins garnis de
grains que ceux qui fe font montrés: les premiers.
(.Bosc.)
TA R E : arbre que quelque vice intérieur rend
impropre à la charpente ou aux conftruétions navales.
Voyei B o is . (B osc. )
T A RENNE. T a r e n n a .
Genre établi par Gærtner, fur la vue feule des
fruits; l’arbre qui le forme croît à Ceylan, &
n’eft pas encore connu. ( Bos.c. )
TARGIONE, T a r g io h ia -.
Genre de plantes de la famille des algues, qui
ne renferme que deux efpèces généralement
très-rares, & qui croiffent dms les lieux frais &
ombragés, formant des rofettes étalées fur h
terre. •
On ne peut les cultiver, & lorfqu’on veùt les
faire voir dans les écoles de botanique , il faut
les aller chercher dans les b o is , & les mettre en
place derrière un teffon de pot qui les abrite du
foleil. ( B o sc .) .
TARIAU ou TARIERE : inftrument au moyen
: duquel on peut, fans grande dépenfe, recônnoîcre
: la nature des couches inférieures de la terre. On
en fait un fréquent ufage dans l'art d’ exploiter les
, mines, & l’agriculture peut en tirer un parti utile
dans un grand nombre de cas, comme pour favoir
s’il y a de la pierre à b â tir , de l'argile, de la
marne, & c . ; fous la couche de terre végétale,
pour reconnoître les lieux où il y a des eaux fou*
_ terraines, foit en nappes, foit en filets, & o ù , par
’ conféquent, on devra creufer un puits.
I! n'y a de différence entre un Tariau & une
i Tarière ordinaire de charron, que la grandeur,
; la gouge ayant de trois à fix pouces de diamètre,
j la tige étant compofée de plufieurs morceaux de
fer de trois à fix pieds de long, dont les bouts
s’infèrent, à mefure que le trou s’approfondit,
les uns'dans les autres, Sc la poignée offrant uns
longueur de quatre à fix, & même huit pieds.
Comme on eft obligé de relever la gouge cha-
I qtie fois qu’elle fe trouve pleine des débris du. fol
qu’eîle perfore, on peut juger de la nature des
couches par l’infpeétion de ces débris. Le travail
elt très-facile & très-rapide tant qu’ il a lieu dans
des couches tendres; mais il devient d’autant plus
pénible & d’autant plus lent, au’ on eft arrivé à
une roche plus dure. La grande dépenfe ne permet
pas aux cultivateurs de chercher à percer les roches
quartzeufes, & furtout le granit; mais auftî ont-ils
rarement befoin de favoir ce qu’ il y a au-deffous
de cette pierre, qu’on c ro it, avec quelque rai-
fon, former le centre du Globe.
La dépenfe de la conftru&ion d’un Tariau, & le
peu d’occafions qu’ont les cultivateurs d’en faire
ufage, font qu’ils n’ont nul empreffement d’ en pof-
féder; maisî’utilité dont peut être cet infiniment,
me fait defirer que le Gouvernement en entretienne
un dans chaque chef-lieu de préfecture,
pour l’ufiige du public, fauf, par ceux qui en feront
emploi, de payer les dégradations auxquelles
cet emploi donnera lieu. (B o s c .)
TARIRI : arbriffeau de la Guiane, qui paroît
fe rapprocher des Br és ille ts ou des C om o -
CLADES (voye% ces mots ), mais dont les parties
de la fructification ne font pas encore complètement
connues.
Il ne fe cultive pas en Europe. (B o s c . )
TARTONAIRE : efpèce du genre des L au -
réoles.
TARTRE : combinaifon de l’acide appelé de
fon nom tartareux, avec la potaffe.
On trouve du Tartre dans beaucoup de fruits,
mais c’eft principalement du vin qu’on retire celui
qui s’emploie dans les arts & dans la médecine.
( Voye£ fon article dans le Dictionnaire des Arts &
dans celui de ia Médecine.) Le vin vert en contient
plus que le vin vieux. Son aCtion fur la qualité
& la durée du vin eft certaine, mais n’eft pas
encore bien connue. Voye% V in .
Les cultivateurs doivent apporter plus de foins
qu’ils ne le font ordinairement, à réunir toutes leurs
lies, pour, quand ils en auront un tonneau, en
retirer le Tartre ou les vendre à ceux qui le retirent,
à ceux qui le brûlent pour en obtenir la
potaffe, ou aux chapeliers, aux teinturiers, qui
en font un grand ufage. Voyei Po t a s se ,
Pour retirer le Tartre de la lie , on fait diffou-
dre cette dernière dans de l’eau bouillante; on
filtre la diffolution, on la remet fur ie fe u , on
l’écume, on la décante & on la verfe dans un
entonnoir au fond duquel eft une maffe de marne
argileufe qui retient toutes les matières muqueu-
fes , de forte que l’eau chargée de Tartre fort
cliire, & qu’ il n’ y a plus qu’à la faire évaporer
pour l’avoir pure. (B o s c . )
TASSQLE : un des noms des Pa t a g o n e s .
Voye^ ce mot.
T A T T IE . Tattia.
Genre de plantes établi par Scopoli dans la po-
Jyandrie trigynie, mais dont les efpèces n’ ont pas
été indiquées. (B o s c .)
TAUBERRE. C e mot eft, dans le département
de Lot & Garonne, fynonyme de Ma ît r e ou
d’Ego u t . Voye[ ces mots.
TAUPE. T a l p a .
Quadrupède qui fait le défefpoir des cultivateurs.,
parce qu’il détruit les Semis & couvie
les Pr a ir ie s de monticules qui gênent les faucheurs
lors de la coupe des foins. Voye\ ces deux
mots, & l’article correfpondant à celui-ci dans le
Dictionnaire des Quadrupèdes.
Quoique la Taupe forte peu de terre, elle devient
fouvent la proie des loups, des renards,
des blairaux*, des fouines Si autres quadrupèdes,
ainfi que des oifeaux de proie diurnes & nocturnes.
Les Taupes font rares dans les terrains argileux
ou pierreux, parce qu’elles peuvent difficilement
les fouiller; dans les terrains fablonneùx, parce
que leurs galeries ne peuvent fe foutenir ; dans les
terrains inondables, parce qu’elles y font expo-
fées à être noyées; elles fe multiplient davantage
dans ceux qui font fertiles, car c’eft là où elles
trouvent le plus abondamment des vers de terre,
des vers blancs, des courtilières, des larves de
beaucoup d’infeétes, aux dépens, defquels elles
vivent principalement. Si elles mangent auffi des
racines & des graines, ce n’eft qu’à défaut de
fubftances animales, & en petite quantité.
Les Taupes fe tiennent ordinairement dans une
cavité circulaire de huit à dix pouces de diamètre,
placée à un ou deux pieds de la fur fa ce du
fo l, & à laquelle aboutiffent des galeries plus ou
moins nombreufes, plus on moins tortueufes,
plus ou moins longues-, plus ou moins éloignées
de la furface. C ’eft par ces galeries qu’elles, fe procurent
leur nourriture, foit qu’elles trouvent, en
fouillant, les animaux énumérés plus haut, foit
que ces animaux y tombent d’eux-mêmes. Le monticule
, vulgairement appelé taupinière , qu’elles
élèvent à leur extrémité, n’a pour objet que de
fe débarraffer de la terre qu’elles retirent de ces
galeries.
Les inconvéniens qui font la fuite de la multiplication
des Taupes, dévoient faire chercher
des moyens de les détruire, & on en a trouvé.
Le plus fimple & le plus généralement employé,
furtout dans les jardins où la terre eft
meuble , c’eft d’attendre le moment où elles
pouffent la terre hors d’une de leu: s galeries, de
ia direction de laquelle otï s’eft alluré par avance,
& , au moyen d’une bêche, de les.amener à la fur-
face du fol, où on les tue facilement. Pour cette
opération il faut avoir foin de fe placer au-deffous
du vent, car les Taupes ont l’odorat délicat, &
elles ceffc-nt de travailler dès qu’elles fentent un
ennemi.
Celui employé par M. Dralet eft trop ingé.-
I i i ij