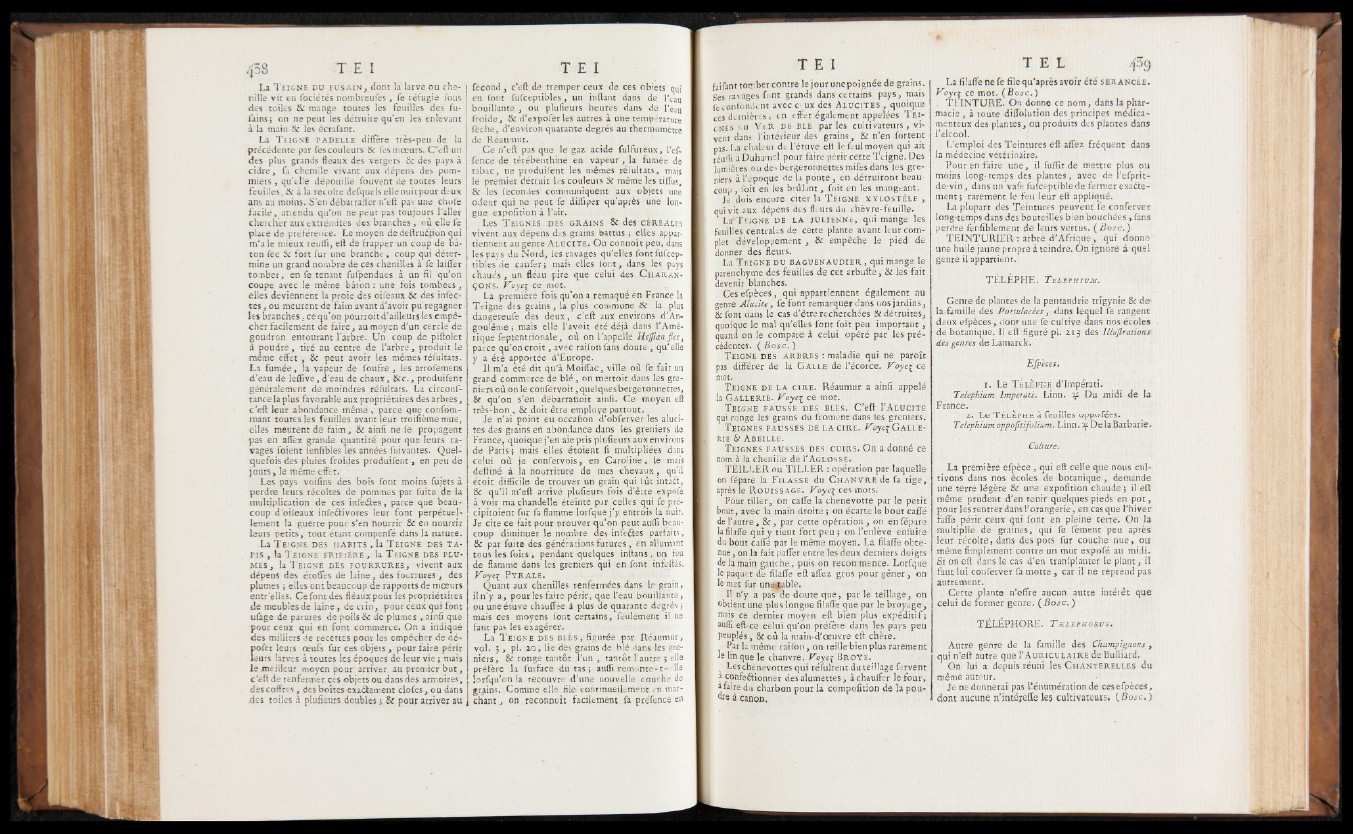
La T eigne du f u s a in , dont la larve ou chenille
vit en fociétés nombreufes , le réfugie fous
des toiles & mange toutes les feuilles des fu-
fains j on ne peut les détruire qu’en les enlevant
à la main & les écrafant.
La T eigne padelle diffère très-peu de la
précédente par fes couleurs & fes moeurs. C ’eft un
des plus grands fléaux des vergers & des pays à
cidre , fa cheniile vivant aux dépens des pommiers
, qu’elle dépouille Couvent de toutes leurs
feuilles, & à la récolte defquelsellenuitpour deux
ans au moins. S'en débarralfer n’eft pas une chofe
facile, attendu qu’on ne peut pas toujours l'aller
chercher aux extrémités des branches, où elle fe
place de préférence. Le moyen dedeftruCtion qui
m’ a le mieux réulfi, eft de frapper un coup de bâton
fec 3c fort fur une branche , coup qui détermine
un grand nombre de ces chenilles à fe lai fier
tomber, en fe tenant fufpendues à un fil qu’on
coupe avec le même bâton : une fois tombées,
elles deviennent la proie des oifeaux & des infectes
, ou meurent de faim avant d’avoir pu regagner -
les branches. ce qu’on pourroit d’ ailleurs les empêcher
facilement de faire, au moyen d’un cercle de
goudron entourant l ’arbre. Un coup de piftolet
à poudre, tiré au centre de l’arbre, produit le
même e ffe t, & peut avoir les mêmes réfultats.
La fumée, la vapeur de foufre, les arrofemens
d’eau de leflive, d'eau de chaux, & c . , produifent
généralement de moindres réfultats. La circonf-
tancelaplus favorable aux propriétaires des arbres,
c ’eft leur .abondance même, parce que confôm-
mant toutes les feuilles avant leur troifième mue,
elles meurent de faim, & a in fi ne fe propagent
pas en allez grande quantité pour que leurs ravages
foient fenfibles les années fui vantes. Quelquefois
des pluies froides produifent, en peu de
jours, le même effet.
Les pays voifins des bois font moins fujets à
perdre leurs récoltes de pommes par fuite de la
multiplication de ces in fe êtes, parce que beaucoup
d'oileaux infeCtivores leur font perpétuellement
la guerre pour s’en nourrir .& en nourrir
leurs petits, tout étant compenfé dans la nature.
La T eigne des habits , la T eigne des ta pis
, la T eigne fripière , la T eigne des plumes,
la T eigne des fourrures, vivent aux
dépens des étoffes de laine, des fourrures, des
plumes i elles ont beaucoup de rapports de moeurs
entr'elles. Ce font des fléaux pour les propriétaires
de meubles de laine , de crin, pour ceux qui font
ufage de parures de poils & de plumes , ainfi que
pour ceux qui en font commerce. On a indiqué
des milliers de recettes pour les empêcher de dé-
pofer leurs oeufs fur ces objets , pour faire périr
leurs larves à toutes les époques de leur vie j mais
le meilleur moyen pour arriver au premier b ut,
c ’eft de renfermer ces objets ou dans des armoires,
des coffres, des boîtes exactement clofes, ou dans
des toiles à plufieurs doubles 5 & pour arriver au
fécond, c’eft de tremper ceux de ces objets qui
en font fufceptibles, un inftant dans de l’eau
bouillante , ou plufieurs heures dans de l’eau
froide, & d’expofer les autres à une température
fèche, d’environ quarante degrés au thermomètre
de Réaumur.
C e n’eft pas que le gaz acide fulfureux, l’ef-
fence de térébenthine en vapeur, la fumée de
tabac, ne produifent les mêmes réfultats, mais
le premier détruit les couleurs & même les tiflus,
& les fécondés' communiquent aux objets une
odeur qui ne peut fe diflîper qu’après une longue
expofition à l’air.
Les T eignes des grains & des céréales
vivent aux dépens des grains battus > elles appartiennent
au genre A lucite. On connoît peu, dans
les pays du Nord, les ravages qu’ elles font fufceptibles
de caufer ; mais elles font, dans les pays
chauds, un fléau pire que celui des C harançons.
Voyez ce mot.
La première fois qu’on a remaqué en France la
Teigne des grains, la plus commune & la plus
dangereufe des deux, c ’eft aux environs d’An-
goulême 5 mais elle l ’avoit été déjà dans l’Amérique
feptentrionale, où on l’appelle HeJJtan flce,
parce qu’on c ro it , avec raifon fans doute, qu’ elle
y a été apportée d’ Europe.
Il m’a été dit qu’à Moiffac, ville où fe fait un
grand commerce de b lé , on mettoit dans les greniers
où on le confervoit, quelques bergeronnettes,
& qu’on s’en débarralioit ainfi. C e moyen eft
très-bon, & doit être employé partout.
Je n’ ai point eu occafion d’obferver les aluci-
tes des grains eh abondance dans les greniers de
France, quoique j’en aie pris plufieurs aux environs
de Paris} mais elles étoient fi multipliées dans
celui où je confervois, en Caroline, le maïs
deftiné à la nourriture de mes chevaux, qu’ il
étoit difficile de trouver un grain qui fût intaCl,
& qu’ il m’eft arrivé plufieurs fois d’être expofé
à voir ma chandelle éteinte par celles qui fepré-
cipitoient fur fa flamme lorfque j’y entrois la nuit.
Je cite ce fait pour prouver qu’on peut auffi beaucoup
diminuer le nombre des infeétes parfaits,
& par fuite des générations futures, en allumant
tous les foirs, pendant quelques inftans , un feu
de flamme dans les greniers qui en font infeltés.
Voyez PYRALE.
. Quant aux chenilles renfermées dans le grain,
il n’y a, pour les faire périr, que l’eau bouillante,
ou une étuve chauffée à plus de quarante degrés>
mais ces moyens font certains, feulement il ne
faut pas les exagérer.
La T eigne des blés, figurée par Réaumur,
vol. 3 , pl. 20, lie dès grains de blé dans les greniers,
& ronge tantôt l’un , tantôt l’autre 5 elle
préfère la furface du tas } auffi remonte- t - - lie
lorfqu’on la recouvre d’une nouvelle couche de
grains. Comme elle file continuellement en marchant
, on reconnuît facilement fa préfence en
fai fan r tomber contre le jour une poignée de grains.
Ses ravages font grands dans certains pays, mais
fe confondent avec c ux des Alucites , quoique
ces dernières, en effet également appelées T eignes
ou V lR de blé parles cultivateurs, vivent
dans l’intérieur des grains, & n’en fortent
pas. La chaleui de l ’étuve eft le feul moyen qui ait
réuifi a Duhamel pour faire périr cette Teigne. Des
lumières ou des bergeronnettes mifes dans les greniers
à l’époque de la ponte, en détruiront beaucoup
, foit en les brûlant, foit en les mangeant.
Je dois encore citer la T eigne xylostêle ,
qui vit aux dépens des ffeurs du chèvre-feuille.
n Li'T eigne de la julienne, qui mange les
feuilles centrales de cette plante avant leur complet
développement, & empêche le pied de
donner des fleurs.
La T eigne du baguenaudier , qui mange le
parenchyme des feuilles de cet arbufte , & les fait
devenir blanches.
Ces efpèces, qui appartiennent également au
genre Alucite, fe font remarquer clans nos jardins,
& font dans le cas d’être recherchées & détruites,
quoique le mal qu’elles font foit peu important,
quand on le compare à celui opéré par les précédentes.
( B o s e .)
T eigne des arbres : maladie qui ne paroît
pas différer de la Galle de l’écorce. Voyez ce
mot.
T eigne de la cire. Réaumur a ainfi appelé
la Gallerie. Voyez ce mot.
T eigne fausse des blés. C ’eft I’Alucite
qui ronge les grains du froment dans les greniers.
Teignes fausses de la cire. VoyezGA.LLE-
rie & Abeille.
T eignes fausses des cuirs. On a donné ce
nom à la chenille de I’Aglosse.
TE1LLER ou TILLER : opération par laquelle
on fépare la Filasse du C hanvre de fa tige,
après le Routssage. Voyez ce s mots.
Pour tiller, on eafle la chenevotte par le petit
bout, avec la main droite} on écarte le bout eafle
de l’autre, & , par cette opération , on en fépare
la filafle qui y tient fort peu ; on l’enlève enfuite
du bout eafle par le même moyen. La filafle obtenue,
on la fait paffer entre les deux derniers doigts
de la main gauche, puis on recommence. Lorfque
le paquet de filalïe eft allez gros pour gêner , on
le met fur une^able.
Il n’y a pas^îe doute que, par le teillage, on
obtient une plus longue filalïe que par le broyage,
mais ce dernier moyen eft bien plus expéditif}
aüfli eft-ce celui qu’on préfère dans les pays peu
peuplés, & où la main-d’oeuvre eft chère.
Par la même raifon, on t eille bien plus rarement
le lin que le chanvre. Voyez Broyé.
Les chenevottes qui réfultent du teillage fervent 3 confectionner des alumettes, à chauffer le four,
J faire du charbon pour la compofition de la poudre
à canon»
La filafle ne fe file qu’après avoir été serancée.
Voyez ce mot. ( B osc.)
. TE INTUR E. On donne ce nom, dans la pharmacie
, à toute diflolution des principes médicamenteux
des plantes, ou produits des plantes dans
l’alcool.
L’emploi des Teintures eft allez fréquent dans
la médecine vétérinaire.
Pour en faire une, il fuffit de mettre plus ou
moins long-temps des plantes, avec de l’efprit-
de-vin, dans un vafe fufceptiblede fermer exactement}
rarement le feu leur eft appliqué.
La plupart des Teintures peuvent fe conferver
long-temps dans des bouteilles bien bouchées, fans
perdre fenfiblement de leurs vertus. (B o s c .)
TEINTURIER.^ arbre d’Afrique, qui donne
une huile jaune propre à teindre. On ignore à quel
genre il appartient.
TÉLÈPHE. Telephium.
Genre de plantes de la pentandrie trigynie & d e
la-famille des Portulacées, dans leouel fe rangent
deux efpèces y dont une fe cultive dans nos écoles
de botanique. Il eft figuré pl. 213 des lllu f rations:
des genres de Lamarck.
Efpeces,
1. Le T élèpbe d’Impérati.
Telephium Imperati. Linn. Du midi de lz
France.
2. Le T élÉphe à feuilles oppofées.
Telephium oppoftifolium. Linn. De la Barbarie,
Culture.
La première efpèce, qui eft celle que nous cultivons
dans nos écoles de botanique, demande
une terre légère & une expofition chaude 3 il eft
même prudent d’en tenir quelques pieds en pot,
pour les rentrer dans l’orangerie, en casque l’hiver
faffe périr ceux qui font en pleine terre. On la
multiplie de graines, qui fe fèment peu après
leur récolte, dans des pots fur couche nue, ou
même fimplement contre un mur expofé au midi.
Si on eft dans le cas d’en tranfplanter le plant, il
faut lui conferver fa motte , car il ne reprend pas
autrement.
Cette plante n’offre aucun autre intérêt que
celui de former genre. ( Bosc. )
TÉLÉPHORE. Tælephorus.
Autre genre de la famille des Champignons,
qui n’eft autre que 1’Auriculaire deBuiliard.
On lui a depuis réuni les C hanterelles du
même auteur.
Je ne donnerai pas Uénumération de cesefpèces,
dont aucune n intéreffe les cultivateurs. (B o s c .)