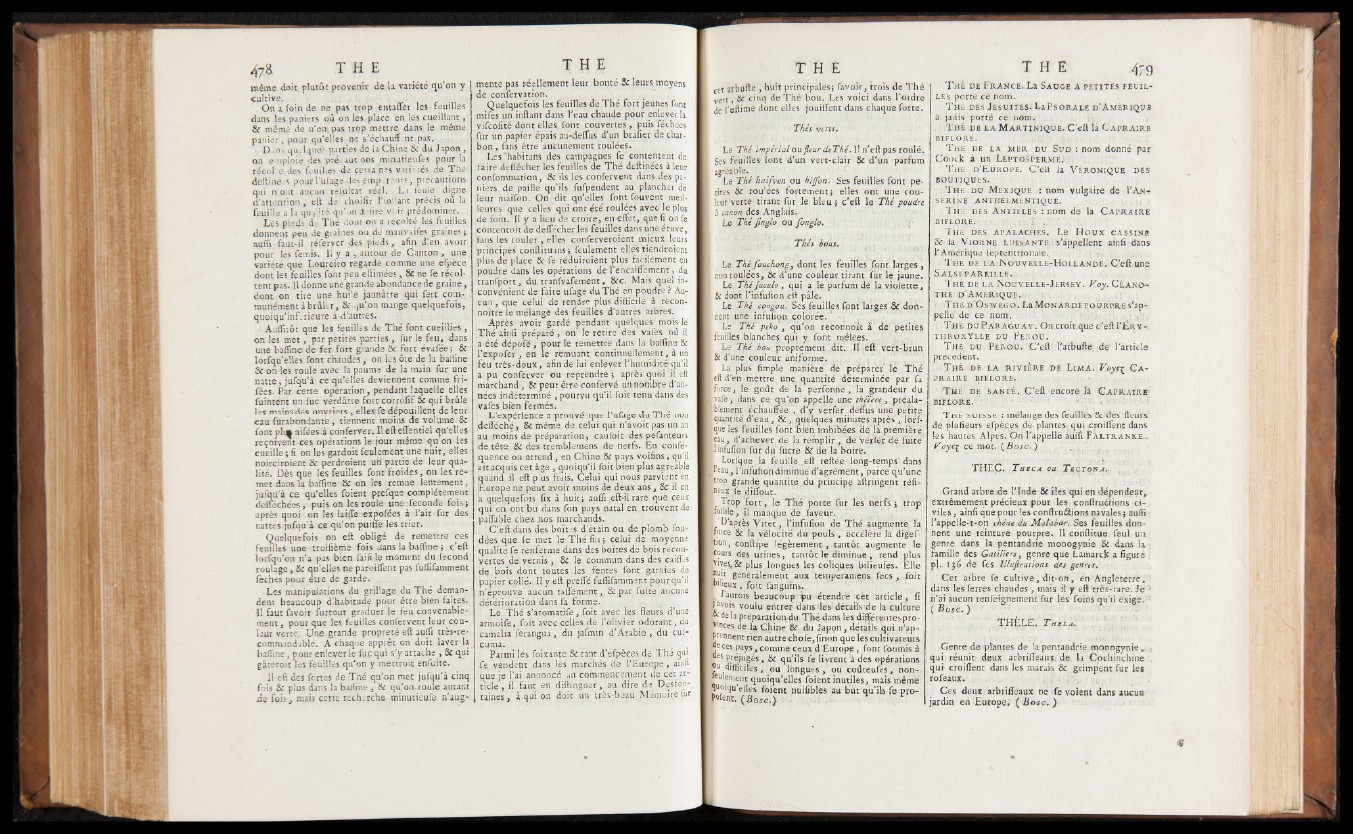
même doit plutôt provenir de la variété qu’on y |
cultive.
On a foin de ne pas trop entauer les feuilles
dans les paniers où on les place en les cueillant,
& même de n’en pas trop mettre, dans le même
p an ie rp ou r qu’elles ne s’échauffant pas.
D.i.ns quelque> parties de la Chine & du Japon ,
on e nploie des prévaut ons min.utieufes pour la
récol e.des feuilles de certaines variétés de Thé
deftiné.s pour l'ufage -lus einp,i?iirî j précautions
qui n'ont aucun téfultat réel. L i feule digne
d'attention, eft de choifir l’ inflant précis où la
feuille a la qualité qu'on d-lire.voir-prédominer.
Les pieds de Thé dont on a récolté les feuilles
donnent peu de graines ou de mauvaifes graines ;
suffi faut-il réferver des pieds, afin d'en avoir
pour les femis. 1! y. a , autour de Canton , une
variété que Louteito regarde comme uns efpèce
dont les feuilles font peu eftimées, & ne fe récoltent
pas. Il donne une grande abondance de graine,
dont on tire une hui'e jaunâtre qui fert communément
à brûler, & qu'on mange quelquefois,
quoiqu'infériéure à d’autres.
Aaffitôt que les feuilles de Thé font cueillies,
on les met, par petites parties, fur le feu, dans
une baffine de fer fort grande & fort évafée; &
lorfqu elles font chaudes, on les ôte de la baffine
& on les roule avec la paume de la main fur une
natte, jufqu'à ce qu'elles deviennent comme fri-
fées. Par cette opération, pendant laquelle elles
fuintent un fuc verdâtre fort corrofîf & qui brûle;
les mains des ouvriers, elles-fe dépouillent de leur.
eau furabondante, tiennent moins de volume &
font pli^ aifées à conferver. Il efteifentiel qu’elles
reçoivent ces opérations le jour même qu’on les
cueille ; fi on les gardoit feulement une nuit, elles
noirciroient & perdroîent un partie de leur qualité.
Dès que les feuilles font froides, on les remet
dans la baffine & on les remue lentement,
jufqu'à ce qu’elles foient prefque complètement
defféchées, puis on les roule une rfecondé fois
après quoi on les laHTe -erpofées à l'ait fur des
nattes jufqu'à ce qu’on puiffe les trier.
Quelquefois on eft obligé de remettre ces
feuilles une troifième fois dans la baffine ; c’ eft
lorfqu’on n’ a pas bien faifi le moment du fécond
roulage , & qu’elles ne parodient pas fuffifamment
fèches pour être de garde.
Les manipulations du grillage du Thé deman- '
dent beaucoup d’habitude pour être bien faites.
II faut favoir fur.ro ut graduer le feu convenablement,
pour que les feuilles confervent leur couleur
verte, Une grande propreté eft auffi très-recommandable.
A chaque apprêt on doit laver-la
baffine, pour enlever le fuc qui s’y attache , & qui
gâterait les feuilles qu’on y mettrait enfuite.
Il eft des fortes de Thé qu’on met jufqu’ à cinq
fois & plus dans la baffine, & qu’on-rouîe autant
de fois, mais cette recherche minutieufe n’ aug- j
mente pas réellement leur bonté & leurs moyens
de confervation.
Quelquefois les feuilles de Thé fort jeunes font
mifes un inftant dans l’eau chaude pour enlever la
vifeofité dont elles font couvertes , puis féchées
fur un papier épais au-deflus d’ un brafier de charbon
1 fans, être aucunement roulées.
Les ‘habicans des campagnes fe contentent de
faire de flécher les feuilles de Thé deftinées à leur
confommation, & ils les confervent dans des paniers
de paille qu’ ils fufpendent au plancher de
leur ntaifon. On dit qu’elles font fouvent meilleures
que celles qui ont été roulées avec le plus
de foin. Il y a lieu de croire, en effet, que fi on fe
contentoit de deflecher les feuilles dans une étuve,
Ifans .les rouler, elles çonferveroient mieux leurs
principes conftituans ; feulement elles tiendroient
plus de place & fe réduiroient plus facilement en
poudre dans les opérations de l’encaiffemeqt, du
tranfport, du tranfvafement, &rc. Mais quel inconvénient
de faire ufage du Thé en poudre? Aucun
, que celui de rendre plus difficile à récon-
noïtre le mélange des feuilles d’autres arbres.
Après avoir gardé pendant quelques mois le
Thé ainfi prépare > on le retire des vafes où il
a été dépofé, pour le remettre dans la baffine &
l’expofer, en le remuant continuellement, à un
feu très-doux, afin de lui enlever l'humidité qu’il
a pu conferyer ou reprendre ; après quoi il eft
marchand, & peut être confervé un nombre d’années
indéterminé , pourvu qu’ il foit tenu dans des
vafes bien fermés.
L’expérience a prouvé que l’ufage du Thé non
defféché, & même de celui qui n’avoit pas un an
au moins de préparation > caufoit des pefanteurs
de tête & des tremblemens de nerfs. En confé-
quence on attend, en Chine & pays voifins, qu’il>
ait acquis cet âge , quoiqu’il foit bien plus agréable
quand il eft plus frais. Celui qui nous parvient en
Europe ne peut avoir moins de deux ans ^ & il en
à quelquefois fix à huit > aufli ;eft-il rare que ceux
qui en ont bu dans fon pays natal en trouvent de
paffablé chez nos marchands.
C ’eft dans des boîtes d’étain ou de plomb fou-
dées que fe met le Thé fin ; celui de moyenne
qualité fe renferme dans des boîtes de bois recouvertes
de vernis , & le commun dans des caiffes
de bois dont toutes les fentes font garnies de
papier collé- Il y eft preffé fuffifamment pour qu’il .
n’éprouve aucun talfement, & par fuite aucune
détérioration dans fa forme.
Le Thé s’aromatife, foit avec les fleurs d’une
armoife, foit avec celles de l’olivier odorant, du
camélia ferangua, du jafmin d’Arabie , du cui-
cuma. >
Parmi les foixante & tant d’efpèces de Thé qui
fe vendent dans les marchés de l’Europe, ainfi
que je l’ai annoncé au commencement de cet artic
le , il faut en diftinguer, au dire de Desfontaines,
à qui on doit un très-beau Mémoire fur
cet arbufte, huit principales; favoir, trois de Th é
vert, & cinq de Thé bou. Les voici dans l’ordre
de l’eftime dont elles jouiflfent dans chaque forte.
Thés verts.
Le Thé impérial ou fleur deThé. I! n’eft pas roulé.
Ses feuilles font d’un vert-clair & d’ un parfum
agréable.
Le Thé haifven ou hiffon. Ses feuilles font petites
& roulées fortement; elles ont une couleur
verte tirant fur le bleu ; c’eft le Thé poudre
à canari des Anglais.
Le Thé ßnglo ou fonglo.
Thés bous.
Le Thé fouchong, dont les feuilles font larges i
non roulées, & d’une couleur tirant fur le jaune.
Le Thé fuculo, qui a le parfum de la violette *
& dont l’înfufion eft pâle.
Le Thé congpu. Ses,feuilles font larges & donnent
une infufion colorée..
Le Thé peko , qu'on reconnoît à de petites
feuilles blanches qui y font mêlées.
I Le Tjié bou, proprement dit. I l eft vert-brun
\ & d’une couleur uniforme.
I La plus fimple manière de préparer le The
[eft d’en mettre une,.quantité déterminée par fa
[force, le goût de la perfonne, la grandeur du
jvafe, dans ce qu’pp appelle une théière > préala-
jblement échauffée , d’ y verfer deffiis une petite
[quantité d’eau, & , quelques minutes après , lorf-
[que les feuilles font bien ijnbibées clq la première
[eau, d’achever.de la remplir, de vérfer de fuite
[l infufion fur du fuere de la boire.
I Lorfque la feuille .eft reftée long-temps dans
ll’eau, l ’infufiondiminué d’agrément, parce qu’une
|troP grande quantité du principe aftringent réfi-
jneux fe diflfout.
I Trop fo r t, le Thé porte fur les nerfs ; trop
Ifoible, il manque de faveur.
L ^après V i te t , l’infufion de Thé augmente, la
■ force & la vélocité du pouls » accélère la drgef-
Ition, conftipe légèrement, tantôt augmente le
■ cours des urines, tantôt le diminue, rend plus
|viye^& plus longues les coliques bilieufes. Elle
généralement aux temperamens fe c s , foit
|bi!ieux, foit fanguin’s.
I Jaurois beaucoup pu étendrfe cet "article, fi
l^vois voulu ehtreÿ dans des-détails \de la.culture
Pf delà préparation,du Thé'daus les différentes.pro-
Fonces de la Chine & du Japon , détails qui n’ap-
grennent rien autre chofe,finon que les cultivateurs
®eces pays, comme ceux d'Europe, font fournis à
des Préjugés, & qu’ ils fe livrent à des opérations
difficiles, ou longues, ou coûteùfes, non-.
Element quoiqu’elles foient inutiles, mais même
Buoiqu'elles foient nuifibles au but qu’ils fe provient.
(B o s e .) •
T hé de France,.La Sauge a petites feuilles
porte ce nom.
T he des Jésuites. LaPsoRALE d’Amérique
a jadis porté ce nom.
T hé de la Martinique. C ’eft la C apraire
: biflore.
T hé de la mer du Sud : nom donné par
Coock à un Leptoéperme;
T he d’E urope. C ’ e lt la V éronique des
boutiques.’
T he .du Mexique : nom vulgaire de I’Ant
serine anthelmentique.
T he des A ntilles : nom de la C apraire
BIFLORE."1 v - j tf ; v,T , .3 I ’
T he des a pAlaches. Le H o u x cassine
& ia V iorne luisante s’appellent ainfi dans
l’Amérique feptentrionale..
T he de la Nouvellet-Hollande.. C ’eft une
Salsepareille. -
1 hé de la Nouvelle-Jersey. Voy. C éano-
THE D’AMERIQUE..
i T he d’O swego. La Mo n arde^ourpr-e s’appelle
de' ce nom.
\ T he. duTa b a g u a y . On croit que c’eft I’Ér y -
throxylle du Pérou.
T hé du Pérou. C ’eft l’ atbufte de’ l ’article
; précédent.
I T hé de la rivière de Lim a . Voyeç C a rra
ire biflore.
' T hé de santé. C’efl encore là C apraire
; BIFLORE. ■
T hé suisse : mélange des feuilles & dès fleurs
de plufieurs efpè.çfs dé plantes, qui .croiffent dans
les hautes Alpes. On Vappellè âùflTi Fàltranke-
yoye% ce mot. \ Bosc. }
T H E Ç . T h e c a o u T e c t o n a ». *
Grand arbre.de l’ Indé & îles qui eu dépendeot,
extrêmement précieux 4?our le§ çonftruéiions civiles
, ainfi que pour les conftruébjons navales j aufli
l’appel le-t-on phênedu Matabdr. Ses fe uilles donnent
une teinture pourpre. Il conftitue feul uu
genre dans la pentandrie monogynie. & dans la
famille des Gatiliers, genre que Lamarcjc a figuré
pi- 13.6 de fes Illuftrations des genres.
C et arbre fè cultiv e, dit-on, en- Angleterre^
dans les ferres chaudes, mais il y eft Très-rare. Je0
n’ ai aucun renfeignement fur les foins .qu’il exige. ’
C B os e. )
T H È L E . T h e l a : 7
Genre de plantes de la pe.ntandrie monogynie,. :
qui réunit deux arbrijffeaux, de la Çochinchine
qui croifîent dans les marais & grimpent fur les
rofeâux. - i l
Ces deux arbriffeaux ne fe voient dans aucun
jardin en Europe; ( Bosc+)