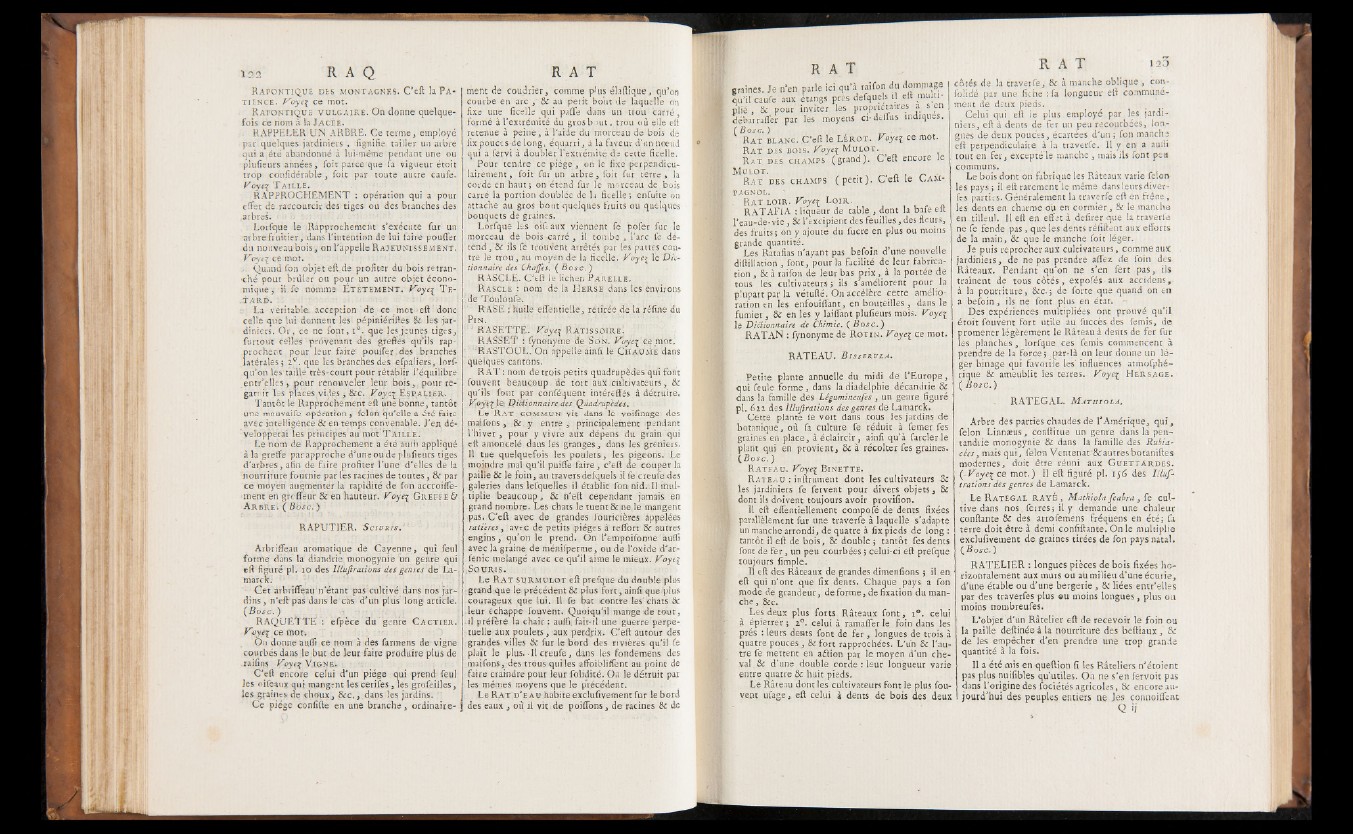
Ra po n t iq u e des montagnes. C ’ eft la Pa tience.
P'oyè^ ce mot.
Rapontique vulgaire. On donne quelquefois
ce nom à la Jacée.
RAPPELER UN ARBRE. Ce terme, employé
par quelques jardiniers , lignifie, tailler un arbre
qui a été abandonné à lui-même pendant une ou
piulieurs années, foit parce que fa vigueur étoit
trop conlîdérable, foit par toute autre caufe.
Vàye% T aille.
RAPPROCHEMENT : opération qui a pour
effet de raccourcir des tiges ou des branches des
arbreé. 1 J
Lorfque le Rapprochement s’exécute fur un
arbre fruitier, dans l’ intention de lui taire pouffer
du nouveau bois, on l’appelle Rajeunissement,
J-^oye? ce mot.
• Quand fon objeteft.de profiter du bois retran-
«ché pour brûler ou pour un autre objet économique
, i l fe nomme Étètement. Voye[ T e-
.t a r d . : :
La véritable, acception de ce m o t; eft donc;
celle que lui donnent les pépiniériftes &. les jardiniers.
O r , ce ne font, i° . que les jeunes, tiges,;
furtout celles prévenant des greffes qu’ils rap-;
piochent pour leur faire pouffer,des branches
latérales} z°. que les branches des efpaliers, lorsqu'on
les'taille très-court pour rétablir l’ équilibre
.entr’eîles > pour renouveler leur bois, , pour regarnir
les places,vidés | &c. Voyc^ Escalier.
Tantôt le Rapprochement eft une bonne, tantôt
une mauvaife opération , félon qu’elle a été faite
avec intelligence & en temps convenable. J’en, développerai
les principes au mot T aille.
Le nom de Rapprochement a été aïriii appliqué
à la greffe par approche d’une ou de piulieurs tiges
d’ar.bres, afin de faire profiter l ’une d’elles de la
nourriture fournie par les racines de toutes, & par
ce moyen augmenter la rapidité de fon accroiffe-
ment en grc fleur & en hauteur. Voye£ Greffe &
A r b r e . ( R o i e .)
R A PU T 1ER. S ciurts»
Arbriffe.au aromatique de Cayenne, qui feul!
forme dans la diandrie monogynie un genre qui;
eft figuré pl. 10 des lllufiradons des genres de La-,
marck.
C e t arbriffeaii n’étant pas cultivé dans nos jardins,
n’eft paÉdans le cas d’ un plu$! long article. ( B o s ç . y
RAQUETTE; : efpèce du ‘genre Cactier.1
Voye^ce mot.
On donne auffi ce nom à des farmens de vigne
courbés dans le but de leur faire produire plus de
.raifins Voye^ V.Igne. i
C ’eft encore celui d’ un piège qui prend feul
les oifeaux qui mangent les cerifes, les grofeilles,
les gpaints de choux, & c . , dans les jardins. ;
C e piège confifte en une branche, ordinairement
de coudrier, comme plus élaftique, qu’on
courbe en arc , & au petit bout de laquelle on
fixe une ficelle qui paffe dans un trou carré,
formé à l’extrémité du gros b out, trou où elle eft
retenue à peine, à l’aide du morceau de bois de
fix poucts-de long, équarri, à la faveur d’un noeud
qui a fervi à doubler l’extrémité de cette ficelle.
Pour tendre ce p iège, on le fixé perpendiculairement,
foit fur un arbre, foit fur terre , la
corde en haut} on étend fur le morceau de bois
carré la portion doublée de la ficelle} enfuite on
attache au gros bout quelques fruits ou quelques
bouquets de graines.
Lorfque les biftaux viennent fe pofer fur le
morceau de bois carré, il tombe , l’arc fe dé-
’ tènd, & ils fe trouvent, arrêtés par les pattes contre
le trou, au moyen de la ficelle, yoyè^ lé Dictionnaire
des Ckajfes. ( B ose. )
RASCLE. C’eft le lichen Parelle.
Ra.scle : nom de la Herse dans les environs
de Touloufe.
RASE : huile effentielle, retirée de la réfine du
Pin.
J R A SE TTÈ . PTpyei Ratissdire;
R.ASSET : fynonyme de Son, Voye^ ce mot.
• JRA'STOÜL. On appelle ainfi ië Chaume dans
quelques cantons.
R A T : nom de trois petits quadrupèdes qui font
fouvent beaucoup de .tort aux,cultivateurs, &
qu’ ils font par conféquent intéreffés à détruire.
Dictionnaire des Quadrupèdes.
Le Rat : commun vit dans lé voifînage des
maifons, & . y en tre , principalement pendant
l’hiver , pour y vivre aux dépens du grain qui
elt amoncelé dans les granges, dans les greniers.
Il tue quelquefois les poulets, les pigeons. Le
moindre mal qu’il puiffe faire, c’eft de couper la
paille & le foin, au traversdefquels il fe creufe des
galeries dans lefquelles il établit fon nid. Il ihul-
tiplie beaucoup, & n’ett cependant jamais: en
grand nombre. Les chats le tuent & ne.le mangent
pas. C ’eft avec de grandes fouricières appelées
ratières, avec de petits pièges à reffort & autres
engins, qu’on le prend. On l’ empoifonne âufli
avec la graine de ménifpemie, ou de l’oxide d’ar-
fenic mélangé avec ce qu’il aime le mieux. Voyt\
•Souris.,
Le Ra t surmulot èft prefque du double plus
grand que le précédent & plus fort, ainfi que/plus
courageux que lui. Il fe bat contre les' chats :8c
.leur échappe fouvent. Quoiqu’il mange de toiut,
.il préfère la chair : auffi; fait-il une guerre perpétuelle
âux poulets, aux perdrix. C ’eft autour des
grandes villes & fur le bord des rivières qu’il fe
plaît le plus.-Il creufe, dans les fondemens des
maifons, dès trous quiles affoibliffent au point de
faire craindre pour leur folidité. On le détruit par
les mêmes moyens que le précédent.
LeRAT d’eau habite exclufivement fur le bord
des eaux, ou il vit de poiffons, de racines & die
graines. Je n’en parle ici qu’ à raifon du dommage
qu'il caufe aux étangs près defquels il eft mulu-
plié , & pour inviter les propriétaires a s en
débarraffer par les moyens ci-deffus indiques.
( B o s ç .) .
Ra t blang. .C’eft le Lero t. Voye[ ce mot.
Ra t des bois. Voye[ Mulot.
Rat des champs (grand). C eft encore le
Mulot. _ .
Rat des champs (p e tit). C elt le C ampagnol.
1
Rat loir. Voyei Lo ir .
R A TA F iA : liqueur de table , dont la bafe eft
l ’eau-de-vie, & l’excipient des feuilles, des fleurs,
des fruits} on y ajoute du fucre en plus ou moins
grande quantité. . ,
Les Ratafias n’ayant pas befoin d’une nouvelle
diftillation , font, pour la facilité de leur fabrication
, & à raifon de leur bas prix, à la portée de
tous les cultivateurs} ils s’ améliorent pour la
plupart par la vétufté. On accélère cette amélioration
en les enfouiffant, en bouteilles, dans le
fumier, & en les y laiffant plufieurs mois. Voyeç
le Dictionnaire de Chimie. ( B o s e .)
R A TAN : fynonyme de Rotin. Voyei ce mot.
RATEAU. B tsserï/z a .
Petite plante annuelle du midi de l’Europe,
qui feule forme, dans ladiadelphie décandrie &
dans la famille des Légumineufes , un genre figuré
pl. 622 des lllufiradons des genres de Lamarck.
. Cette plante fe voit dans tous les jardins de
botanique, où fa culture fe réduit à femer fes
graines en place, à éclaircir, ainfi qu’à farder le
plant qui en provient, & à récolter fes graines.
( B osç. y
Rateau. Voyei Binette.
Rateau : inftrument dont les cultivateurs &
les jardiniers fe fervent pour divers objets, &
dont ils doivent toujours avoir provifion.
Il eft effentiellement compofé de dents fixées
parallèlement fur une traverfe à laquelle s’ adapte
un manche arrondi, de quatre à fix pieds de long :
tantôt il eft de bois, & double} tantôt fes dents
font de fe r , un peu courbées 5 celui-ci eft prefque
toujours fimple.
Il eft des Râteaux de grandes dimenfions } il en
eft qui n’ont que fix dents. Chaque pays a fon
mode de grandeur, déformé, de fixation du manche,
&c.
Les deux plus forts Râteaux fon t, 1®. celui
à épierrer} 20. celui à ramafferle. foin dans les
prés : leurs dents font de fer , longues de trois à
quatre pouces, & fort rapprochées. L'un & l’autre
fe mettent en aétion par le moyen d’un cheval
& d’une double corde : leur longueur varie
entre quatre & huit pieds.
Le Râteau dont les cultivateurs font le plus fouvent
ufage, eft celui à dents de bois des deux
côtés de la traverfe, & à manche oblique , con-
folidé par une fiche : fa longueur eft communément
de deux pieds.
Celui qui eft le plus employé par les jardiniers,
eft à dents de fer un peu recourbées, longues
de deux pouces, écartées d'un-} fon manche
eft perpendiculaire à la traverfe. Il y en a auffi
tout en fe r , excepté le manche, mais ils font peu
communs.
Le bois dont on fabrique les Râteaux varie félon
les pays ; il eft rarement le même dans leurs diver-
fes parties. Généralement la traverfe eft en frêne,
les dents en charme ou en cormier, & le manche
en tilleul. Il eft en effet à defirer que la traverfe
ne fe fende pas, que les dents réfiftent aux efforts
de la main, & qiie le manche foit léger.
Je puis reprocher aux cultivateurs, comme aux
jardiniers, de ne pas prendre affez de fo-in des
Râteaux. Pendant qu’on ne s’en fert pas, ils
traînent de tous côté s , expofés aux accidens,
à la pourriture, &C.5 de forte que quand on en
a befoin, ils ne font plus en état. -
Des expériences multipliées ont prouvé qu’il
étoit fouvent fort utile au fuccès des femis, de
promener légèrement le Râteau à dents de fer fur
les planches, lorfque.ces femis commencent à
prendre de la force} par-là on leur donne un léger
binage qui favorife les' influences atmofphé-
rique & ameublit les terres. Voye[ Hersage.
( B o s c .)
R A TEG AL . M a th io l a .
Arbre des parties chaudes de l’Amérique, q u i,
félon Linnæus, conftitue un genre dans là pen-
tandrie monogynie & dans la familie des Rubia-
cécs, mais qui, félon Ventenat'&autresbotaniftes
modernes, doit être réuni aux G uettârdes.
(-Voye^ ce mot.) Il eft figuré pl. 156 des IUuf*
J tratïons des genres de Lamarck.
Le Rategal r a y é , Mathiola feabra, fe cultive
dans nos. ferres} il y demande une chaleur
confiante & des arrofemens fréquens en été} fa
terre doit être à demi confiftante. On le multiplie
exclufivement de graines tirées de fon pays natal.
(B o s c . )
RATELIER : longues pièces de bois fixées horizontalement
aux murs ou au milieu d’une écurie,
d’une étable ou d’ une bergerie, & liées entr’elles
par des traverfes plus eu moins longues, plus ou
moins nombreufes.
L ’objet d’ un Râtelier eft de recevoir le foin ou
la paille deftinée à la nourriture des beftiaux, &
de les empêcher d’en prendre une trop grande
quantité à la fois.
Il a été mis en queftion fi les Râteliers n’étoient
pas plus nuifibles qu’utiles. On ne s’en fervoit pas
dans l’origine des fociétés agricoles, & encore aujourd'hui
des peuples entiers ne Jes connoiffent
Q 1