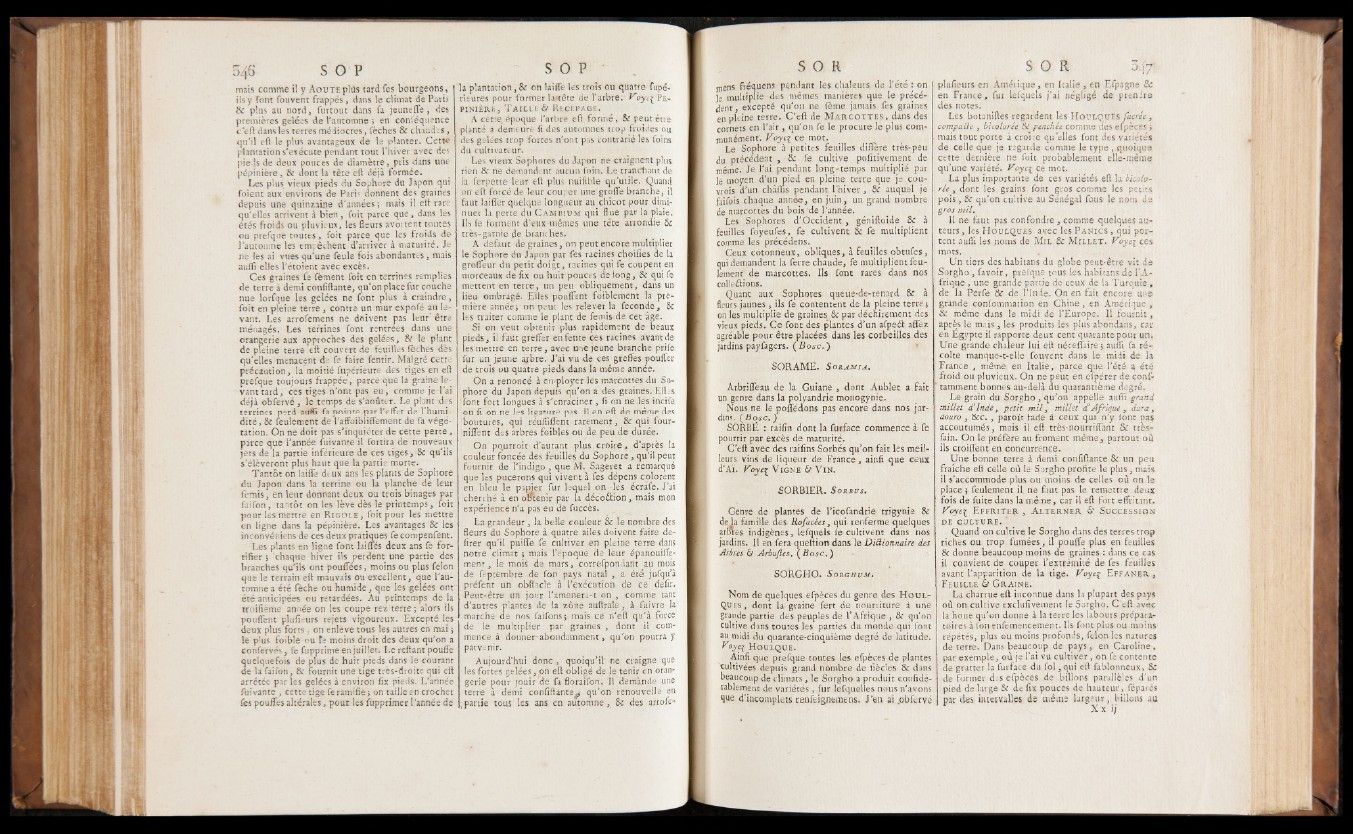
mais comme il y à o u t e plus tard Tes bourgeons,
ils y Font fouvent frappés, dans le climat de Paris
& plus au nord, fur tout dans fa je une ffe , des
premières gelées de l'automne ; en conséquence
c'eft dans les terres médiocres, fèches & chaudes ,
qu'il eft-le plus, avantageux de le planter. Cette
plantation s'exécute pendant tout l’hiver avec des
pieds de deux pouces de diamètre,.pris dans une
pépinière, & dont la tête eft déjà formée.
Les plus vieux pieds du Sophore du Japon qui
foient aux environs de Paris donnent des graines
depuis une quinzaine d'années ; mais il eft rare
qu'elles arrivent à bien, foit parce que, dans les
étés froids ou pluvieuxa les fleurs avortent toutes
ou prefque toutes, foit parce que les froids de
l ’automne les empêchent d’arriver à maturité. Je
ne les ai vues qu'une feule fois abondantes, mais
auffi elles l ’étoient avec excès.
Ces graines fe fèment foit en terrines remplies
de terre à demi cônfiftante, qu'on place fur couche
nue lorfque les gelées ne font plus à craindre,
foit en pleine terre, contre un mur expofé au levant.
Les arrofemens ne doivent pas leur être
ménagés. Les terrines font rentrées dans une
orangerie aux approches des gelées * & le plant
de pleine terre eft couvert de feuilles fèches dès
qu'elles menacent de fe faire fentir. Malgré cette
précaution, la moitié fupérieure des tiges en eft
prefque toujours frappée, parce que la graine levant
tard, ces tiges n’ont pas eu , comme je l ’ai
déjà obfervé, le temps de s'aoûter. Le plant des
terrines perd auffi fa pointe par l'effet de l'humid
ité , & feulement de l’affbibliffement de fa végétation.
On ne doit pas s'inquiéter de cette perte,
parce que l'année fuivante il fortira de nouveaux
jets de la partie inférieure de ces tiges, & qu'ils
s’élèveront plus haut que la partie morte.
Tantôt on laiflfe deux ans les plants de Sophore
du Japon dans la terrine ou la planche de leur
femis, en leur donnant deux ou trois binages par
faifon,. tantôt on les lève dès le printemps, foit
pour les mettre en Rig o l e , foit pour les mettre
en ligne dans la pépinière. Les avantages & les
inconvéniens de ces deux pratiques fe compenfent.
Les plants en ligne font Liftes deux ans fe fortifier
; chaque hiver ils perdent une partie des
branches qu'ils ont pouffées, moins ou plus félon
que le terrain eft mauvais ou excellent, que l'automne
a été fèche ou humide, que les gelées ont
été anticipées ou retardées. Au printemps de là
troifième année on les coupe rez terre; alors ils
pouffent plufleurs rejets vigoureux. Excepté les
deux plus forts . on enlève tous les autres en mai ;
le plus foible ou Te moins droit des deux qu'on a
confervés, fe fupprime en juillet. Le reliant pouffe
quelquefois de plus de huit pieds dans le courant
de la faifon, & fournit une tige très-droite qui eft
arrêtée par les gelées à environ fix pieds. L’année
fuivante , cette tige fe ramifié; on tailleen crochet
fies pouffes altérales, pour les fupprimer l'année de
la plantation, & on laiffe les trois ou quatre fupé-
r’ieures pour former la»tête de l’arbre. Voye^ Pép
in iè r e , T a ill e & Recepage.
A cette, époque l'arbre eft formé, & peut être
planté à demeure fi des automnes trop froides ou
des gelées trop fortes n'ont pas contrarié les foins
du cultivateur.
Les vieux Sophores du Japon ne craignent plus,
rien & ne demandent aucun foin. Le tranchant de
la ferpette leur eft plus nuifible qu’utile. Quand
on eft forcé de leur couper une groffe branche, il
faut laiffer quelque longueur au chicot pour diminuer
la perte du C am bium qui flue par la plaie.
Ils fe forment d'eux-mêmes une tête arrondie &
très-garnie de branches.
A defaut de graines, on peut encore multiplier
le Sophore du Japon par fes racines choifies de la
groffeur du petit doigt, racines qui fe coupent en
morceaux de fix ou huit pouces de long, & qui fe
mettent en terre, un peu obliquement, dans un
lieu- ombragé. Elles pouffent faiblement la première
année; on peut les relever la fécondé, &
les traiter comme le plant de femis de cet âge.
Si on veut obtenir plus rapidement de beaux
pieds, il faut greffer en fente ces racines avant do
les mettre en terre, avec une jeune branche prife
fur un jeune ajbre. J'ai vu de ces greffes pouffer
de trois ou quatre pieds dans la même année.
On a renoncé à employer les marcottes du Sophore
du Japon depuis qu’on a des graines. Elles
font fort longues à s 'en ra c in e r fi on ne les incife
ou fi on ne les ligature pas. il en eft de même des
boutures, qui réufliffent rarement, & qui four-
niffent des arbres foibles ou de peu de durée.
On po.urroit d’autant plus croire, d'après la
couleur foncée des feuilles du Sophore, qu’il peut
fournir de l'indigo, que M. Sageret a remarqué
que les pucerons qui vivent à fes dépens colorent
en bleu le papier fur lequel on-les écrafe. J’ai
cherché à en ootenir par la décoélion, mais mon
expérience n'a pas eu de fuccès.
La grandeur, la belle couleur & le nombre des
fleurs du Sophore à quatre ailes doivent faire de-
firer qu’ il puiffe fe cultiver en pleine terre dans
notre climat ; mais l’époque de leur épanouiffe-
ment, le moià de mars, correfpondant au mois
de feptembre de fo.n pays natal , a été jivfqu’à
préfent un obftacle à l’exécution de ce defir.
Peut-être un jour l'amenera-t on , comme tant
d’autres plantes de la zone âuftrale, à fuivre la
marche de nos faifons; mais ce n'eft qu’ à force
de le multiplier par graines dont il commence
à donner-abondamment, qu’on pourra y
parvenir.
Aujourd’hui donc., quoiqu’ il' ne craigne que
les fortes gelées, on eft obligé de le tenir en orangerie
pour jouir de fa floraifon. Il demande une
terre à demi cônfiftante^ qu'on renouvelle en
; partie tous les ans en. automne, & des w o k *
mens fréquens pendant les chaleurs de l ’été : on
Je multiplie des mêmes manières que le précédent,
excepté qu'on ne fème jamais fes graines
en pleine terre. C ’ eft de M a r c o t t e s ., dans des
cornets en l'a ir , qu'on fe le procure le plus communément'.
V o y e i ce mot.
Le Sophore à petites feuilles diffère très-peu
du précédent , & fe cultive pofitivement de
même. Je l'ai pendant long-temps multiplié par
le moyen d’un pied en pleine terre que je cou-
vrois d'un châflis pendant l'h iv e r , & auquel je
faifois chaque année, en juin, un grand nombre
de marcottes du boiVde l'année.
Les Sophores d’Occident, géniftoide & à
feuilles foyeufes, fe cultivent & fe multiplient
comme les précédens.
Ceux cotonneux, obliques, à feuilles obtufes,
qui demandent la ferre chaude, fe multiplient feulement
de marcottes. Us fout rares dans nos
colle&ions.
Quant aux Sophores queue-de-renard & à
fleurs jaunes , ils fe contentent de la pleine terre ;
on les multiplie de graines.& par déchirement des
vieux pieds. C e font des plantes d’ un afpeét affez
agréable pour être placées dans les corbeilles des
jardins payfagers. ( B o s c .)
SORAME. S o r am i a ,
Arbriffeau de la Guiane , dont Aublet a fait
un genre dans la polyandrie monogynie.
Nous ne le poffédons pas encore dans nos jardins.
(Bo&c. )
SORBÉ : raifîn dont la fufface commence à fe
pourrir par excès de maturité.
C ’eft avec des raifins Sorbés qu’on fait les meilleurs
vins de liqueur de France, ainfi que ceux
d’Aï. Voye% V igne & V in.
SORBIER. S orbus1
Genre de plantes de i’ icofandrie trigynie &
de la famifte des Rofacées, qui renferme quelques
arores indigènes, lefquels fe cultivent dans nos
jardins. Il en fera queftion dans le Dictionnaire des
Arbres & Arbufies. ( B o s c . )
SORGHO. S orghum,
Nom de quelques efpèces du genre des Ho u l -
Qü es, dont la graine fert de nourriture à une
grande partie des peuples de l’Afrique , &r qu’on
cultive dans toutes les parties du monde qui font
au midi du quarante-cinquième degré de latitude.
F oyçi Houlque.
Ainfi que prefque toutes les efpèces de plantes
cultivées depuis grand nombre de fiècles & dans
beaucoup de climats, le Sorgho a produit confidé-
rablement de variétés, fur lefquelles nous n’avons
que d’incomplets renfeignetnens. J'en ai .obfervé
plufieurs en Amérique, en Italie , en Efpagne 8c
en France, fur lefquels j’ai négligé de prendre
des notes.
Les botaniftes regardent les Houlques fucrée ,
compacte , bicolorée & penchée comme des efpèces ;
mais tout porte à croire qu'elles font des variétés
de celle que je regarde comme le typ e , quoique
cette dernière ne foit probablement elle-même
qu’une variété. Voye1 ce mot.
La plus importante de ces variétés eft la bicotorée
, dont les grains font gros comme les petits
pois , & qu’on cultive au Sénégal fous le nom de
gros mil.
II ne faut pas confondre , comme quelques auteurs
, les H oulques avec les Pan ic s , qui portent
auffi les .noms de Mil 8c Mil l e t . Voyei ces
mots.
Un tiers des habitans du globe peut-être vit de
Sorgho, favoir, prefque tous les habitans de l’A frique
, une grande partie de ceux de la Turquie,
de la Perfe & de l’ Inde. On en fait encore une
grande confommation en C hine, en Amérique,.
& même dans le midi de l'Europe. Il fournit,
après le maïs , les produits les plus abondans, car
en Egypte il rapporte deux cent quarante pour un.
Une grande chaleur lui eft néceffaire ; auffi fa récolte
manque-t-elie fouvent dans le midi de la
France , même en Italie, parce que l'été a été
froid ou pluvieux. On ne peut en efpérer de conf-
‘ tamment bonnes au-delà du quarantième degré.
Le grain du Sorgho, qu’on appelle auffi grand
millet d'Inde, petit m i l , millet d’Afrique , dura,
douro , & c . , paroît fade à ceux qui n’y font pas
accoutumés, mais il eft très-nourriffant & très-
fain. On le préfère au froment même, partout où
ils croiffent en concurrence.
Une bonne terre à demi cônfiftante & un peu
fraîche eft celle où le Sorgho profite le plus, mais
il s’accommode plus ou moins de celles où on le
place ; feulement il ne faut pas le remettre deux
fois de fuite dans la même, car il eft fort effritant.
Voye[ E ffriter. , A l t e r n e r & Success ion
de cu l tu r e . '
Quand on cultive le Sorgho dans des terres trop
riches ou trop fumées, il pouffe plus en feuilles
& donne beaucoup moins de graines : dans ce cas
il convient de couper l'extrémicé de fes feuilles
avant l’apparition de la tige. Voye% Ef faner ,
F euille & G r a in e .
La charrue eft inconnue dans la plupart des pays
où on cultive exclufivement le Sorgho. C ’eft avec
la houe qu'on donne à la terre les labours préparatoires
à fon enfemencement. Us font plus ou moins
répétés, plus ©u moins profonds, félon les natures
de terre. Dans beaucoup de pays, en Caroline,
par exemple., où je l’ai vu cultiver, on fe contente
de gratter la furface du fo l,q u i eft fablonneux, &
de former d~s efpèces de billons parallèles d’un
pied de large & de fix pouces de hauteur, réparés
par des, intervalles de même largeur, billons au
1