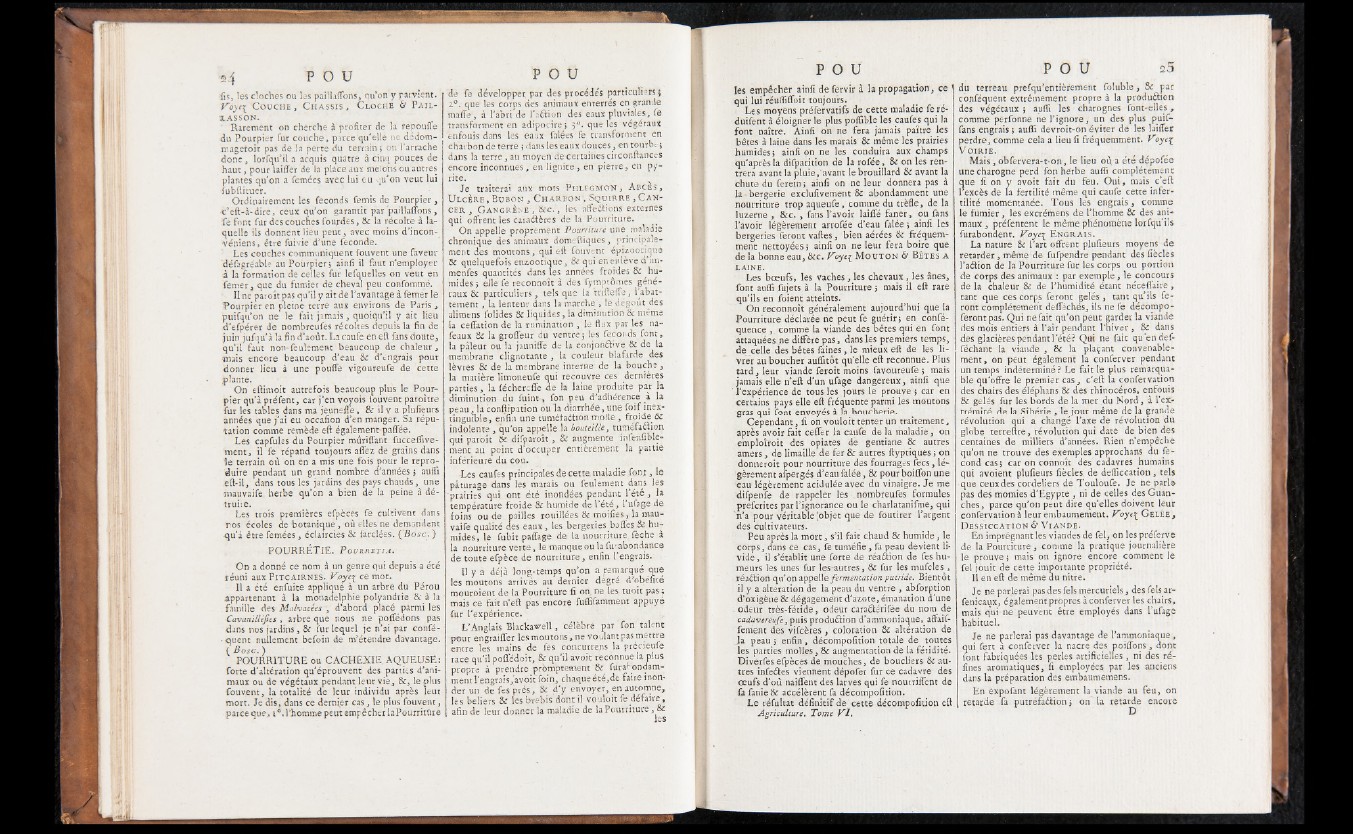
'lis, les cloches ou les paillaffons, qu’on y parvient.
Voyei C ouche, C h a s sis , C loche & Pailla
s so n .
' Rarement on cherche à profiter de la repouffe
du Pourpier fur couche, parce qu’elle ne dédom-
magetoir pas de la perte du terrain} on l’arrache
d onc, lorfqu’ il a acquis quatre à cinq pouces de
haut, pour laiffer de la place aux melons ou autres
plantes qu’on a femées avec lui ou qu’on veut lui
fubftituer.
Ordinairement les féconds femis de Pourpier ,
c ’eft-à-dire, ceux qu’on garantit par paillaffons,
fe font fur des couches lourdes, & la récolte à laquelle
ils donnent lieu peut, avec moins d’incon-
•véniens, être fuivie d’une fécondé.
Les couches communiquent fouvent une faveur
défagréable au Pourpier} ainfi il faut n’employer
à la formation de celles fur lefquelles on veut en
femer, que du fumier de cheval peu confommé.
Il ne paroît pas qu’ il y ait de l’avantage à femer le
Pourpier en pleine terre aux environs de Paris ,
puifqu’on ne le fait jamais, quoiqu’ il y ait lieu
d’efpérer de nombreufes récoltes depuis la fin de ;
juin jufqu’à la fin d’août. La caufe en eft fans doute,
qu’ il faut non-feulement beaucoup de chaleur,
mais encore beaucoup d’ eau & d’ engrais pour
donner Heu à une pouffe vigoureufe de cette
plante.
On eftimoit autrefois beaucoup plus le Pourpier
qu’ à préfent, car j’ en voyois fouvent paroître
fur les tables dans ma jeuneffe, & il y a plufieurs
années que j’ai eu occafion d’en manger. Sa réputation
comme remède eft égalemenrpaffée.
Les capfulss du Pourpier mûriffant fucceffive-
ment, il fe répand toujours affez de grains dans
le terrain où on en a mis une fois pour le reproduire
pendant un grand nombre d’années} auffi.,
eft-il, dans tous les jardins des pays chauds, une
mauvaife herbe qu’on a bien de la peine à détruite.
Les trois premières efpèces fe cultivent dans
nos écoles de botanique, où elles ne demandent
•qu’à être femées, éclaircies & fardées. (B o s e . )
POURRÉTIE. P ovrre tia.
On a donné ce nom à.un genre qui depuis a été
•réuni aux Pit c a ir n es. Voyeç ce mot.
Il a été enfuite appliqué à un arbre du Pérou
appartenant à la monadelphie polyandrie & à la
famille des Malvacées , d’abord placé parmi les
Cavanillépes, arbre que nous ne poffédons pas
dans nos jardins, &r fur lequel je n’ ai par confé-
-quent nullement befoin de m’étendre davantage.
( B o sc . )
POURRITURE ou CACHEXIE AQUEUSE:
forte d’altération qu’éprouvent des parties d’animaux
ou de végétaux pendant leur v ie , & , le .plus
fouvent, la totalité de leur individu après leur
mort. Je dis, dans ce dernier cas, le plus fouvent,
parce que, i° . l’homme peut empêcher laPourritûre
de fe développer par des procédés particuliers $
i ° . que les corps des animaux enterrés en grande
ma (Te, à l’abri dé l’aCtion des eaux pluviales, fe
transforment en adipocire; 30. que les végérauX
enfouis dans les eaux falées- fe transforment en
charbon de terre } dans les eaux douces, en tourbe-}
dans la terre, au moyen de certaines circonftances
encore inconnues, en lignite, en pierre, en pyrite.
Je traiterai aux mots Phlegmon, A bcès,
Ulcère , Bubon , C h a r b o n Squirre , C an^-
cer , Gangrène, & c . , les affections externes
qui offrent les caractères de la Pourriture.
On appelle proprement Pourriture une maladie
chronique des animaux domeftiques, principalement
des moutons, qui eft fouvent épizootique
& quelquefois enzootique, & qui en enlève d’im-
menfes quantités dans les années froides & humides
} elle fe reconnoît à des fymptornes généraux
& particuliers , tels que la trifteffe, Rabattement
, la lenteur dans la marche , le dégoût des
alimens folides & liquides, la diminution & même
la ceffation de la rumination , le flux par les na-
feaux & la groffeur du ventre5 les féconds font,
la pâleur ou la jauniffe de la conjonctive & de la
membrane clignotante , la couleur blafarde des
lèvres & de la membrane interne de la bouche ,
la matière limoneufe qui recouvre ces dernières
parties, la féchereffe de la laine produite par la
diminution du fuint, fon peu d’adhérence à la
peau, la conftipation ou la diarrhée, une foif inextinguible,
enfin une tuméfaction molle, froide &
indolente , qu’on appelle la bouteilletuméfaction
qui paroît & difparoît, & augmente infenfioie-
ment au point d’occuper entièrement la partie
inférieure du cou.
Les caufes principales de cette, maladie fon t, le
pâturage dans les marais ou feulement dans les
prairies qui ont été inondées pendant l’é t é , la
température froide & humide de l’é té , l’ ufage de
foins ou de pailles rouillées & môifies, la mauvaife
qualité des eaux, les bergeries baffes & humides,
le fubit paffage de la nourriture, lèche à
la nourriture verte, le manque ou la furabondance
de toute efpèce de nourriture, enfin l’engrais.
Il y a déjà long-temps qu’on a pmarqué que
les moutons arrivés au dernier degré d’obémé
mouroient de la Pourriture fi on, ne les tuoit pas ;
mais ce fait n’eft pas encore fuffifamment appuyé
fur l’expérience*
L’Anglais Blackavell, célébré par fon talent
pour engraiffer lesmoutons,ne voulantpas mettre
entre les mains de fes concurrens la précieufe
race qu’il poffédoit, & qu’il avoit reconnue la plus
propre à prendre promptement & furahondam-
ment l’engrais,avoit foin, chaque épe,de faire inonder
un de fes prés, & d’y envoyer, en automne,
lés beliers & les brebis dont il vouloir fe défaire ,
afin de leur donner la maladie de la Pourriture, &
les empêcher ainfi de fervir à la propagation, ce
qui lui réuflîffoit toujours.
Les moyens préfervatifs de cette maladie fejré-
duifent à éloigner le plus poflible les caufes qui la
font naître. Ainfi on ne fera jamais paître les
bêtes à laine dans les marais & même les prairies
humides} ainfi on ne les conduira aux champs
qu’après la difparition de la rofée, & on les rentrera
avant la pluie, avant le brouillard & avant la
chute du ferein ; ainfi on ne leur donnera pas à
la • bergerie exclufivement & abondamment une
nourriture trop aqueufe, comme du trèfle, de la
luzerne , & c . , fans l’avoir laiffé faner, ou fans
l’avoir légèrement arrofée d’eau falée} ainfi les
bergeries feront vaftes, bien aérées & fréquemment
nettoyées} ainfi on ne leur fera boire que
de la bonne eau, & c . Voyez Mouton & Bêtes a
laine.
Les boeufs, les vaches, les chevaux, les ânes,
font auffi fujets à la^ Pourriture 5 mais il eft rare
qu’ ils en foient atteints.
On reconnoît généralement aujourd’hui que la
Pourriture déclarée ne peut fe guérir} en confé-
quence , comme la viande des bêtes qui en font
attaquées j ie diffère pas, dans les premiers temps,
de celle des bêtes faines, le mieux eft de les livrer
au boucher auflîtôt qu’elle eft reconnue. Plus
tard, leur viande feroit moins favoureufe } mais
jamais elle n’eft d’un ufage dangereux, ainfi que
l’expérience de tous les jours le prouve ^ car en
certains pays elle eft fréquente parmi les moutons
gras qui font envoyés à la boucherie.
Cependant, fi on vouloit tester un traitement,
après avoir fait ceffer la caufe de la maladie, on
emploîroit des opiates de gentiane & autres
amers , de limaille de fer & autres ftyptiques} on
donneroit pour nourriture des fourrages fecs, légèrement
afpergés d’eau falée, & pour boiffon une
eau légèrement acidulée avec du vinaigre. Je me
difpenfe de rappeler les .nombreufes formules
preferites parl’ignoranceou le charlatanifme, qui
n’a pour véritable Jobjet que de foutirer l’argent
des cultivateurs.
Peu après la mort, s’il fait chaud & humide, le
corps, dans ce cas, fe tuméfie, fa peau devient liv
id e, il s’établit une forte de réaction de fes humeurs
les unes fur lesautres, & fur les mufcles ,
réaction qu’ on appelle fermentation putride. Bientôt
il y a alteration de la peau du ventre , abforption
d’oxigène & dégagement d’azote, émanation d'une
odeur très-fétide, odeur caraCtérifée du nom de
cadavereufe, puis production d’ammoniaque, affaif-
fement des vifeères, coloration & altération de
Ja peau} enfin, décompofition totale de toutes
les parties molles, & augmentation de la fétidité.
Diverfes efpèces de mouches, de boucliers & autres
infeCtes viennent dépofer fur ce cadavre des
oeufs d’où naiffent des larves qui fe nourriffent de
fa fanie& accélèrent fa décompofition.
Le réfultat définitif de cette décompofition eft
Agriculture. Tome V I .
du terreau prefqu’entièrement foluble, & par
cbnféquent extrêmement propre à la production
des végétaux } auffi les charognes font-elles,
comme perfonne ne l’ ignore, un des plus puif-
fans engrais} auffi devroit-on éviter de les laiffer
perdre, comme cela a lieu fi fréquemment. Voyez
V oirie.
Mais, obfervera-t-on, le lieu où a été dépofée
une charogne perd fon hérbe auffi complètement
que fi on y avoit fait du feu. O u i, mais c’eft
l’excès de la fertilité même qui caufe cette infertilité
momentanée. Tous les engrais, comme
le fumier, les excrémens de l’homme & des animaux
, préfentent le même phénomène lorfqu’ils
furabondenr. Voye% Engrais.
La nature & l'art offrent plufieurs moyens de
retarder, même de fufpendre pendant des fiècles
l'aCtion de la Pourriture fur les corps ou portion
de corps des animaux : par exemple, le concours
de la chaleur & de l’humidité étant néceffaire,
tant que ces corps feront gelés , tant qu’ ils feront
complètement defféchés, ils ne fe décompo-
feront pas. Qui ne fait qu’on peut garder la viande
des mois entiers à l’air pendant l ’h iv e r , & dans
des glacières pendant l'été? Qui ne fait qu’en def-
féchant la viande , & la plaçant convenablement,
on peut également la conferver pendant
un temps indéterminé? Le fait le plus remarquable
qu'offre le premier cas, c’eft la confervation
des chairs des éléphans & des rhinocéros, enfouis
& gelés fur les bords de la mer du Nord, à l’ex>
trémité de la Sibérie , le jour même de la grande
révolution qui a changé l’axe de révolution du
globe terreftre, révolution qui date de bien des
centaines de milliers d’ années. Rien n’empêche
qu’on ne trouve des exemples approchans du fécond
cas} car on connoît des cadavres humains
qui avoient plufieurs fiècles. de deflïccation, tels
que ceux des Cordeliers de Touloufe. Je ne pari©
pas des momies d’Egypte , ni de celles des Guan-
ches, parce qu’on peut dire qu’elles doivent leur
confervation à leur embaumement. Voye[ Gelée,
Dessiccation & V iande.
En imprégnant les viandes de fel, on les préferve
de la Pourriture, comme la pratique journalière
le prouve} mais on ignore encore comment le
fel jouit de cette importante propriété.
|i II en eft de même au nitre.
Je ne parlerai pas des Tels mercuriels , des Tels ar-
fenicaux, également propres à conferver les chairs,
mais q'ui ne peuvent être employés dans l ’ufage
habituel.
Je në parlerai pas davantage de l’amtponiaque,
qui fert à conferver la nacre des poiffons, dont
font fabriquées les perles artificielles, ni des réfines
aromatiques, fi employées par les anciens
dans la préparation des embaumemens.
En éxpofant légèrement la viande au feu, on
retarde fa putréfaction 3 on la retarde encore
D