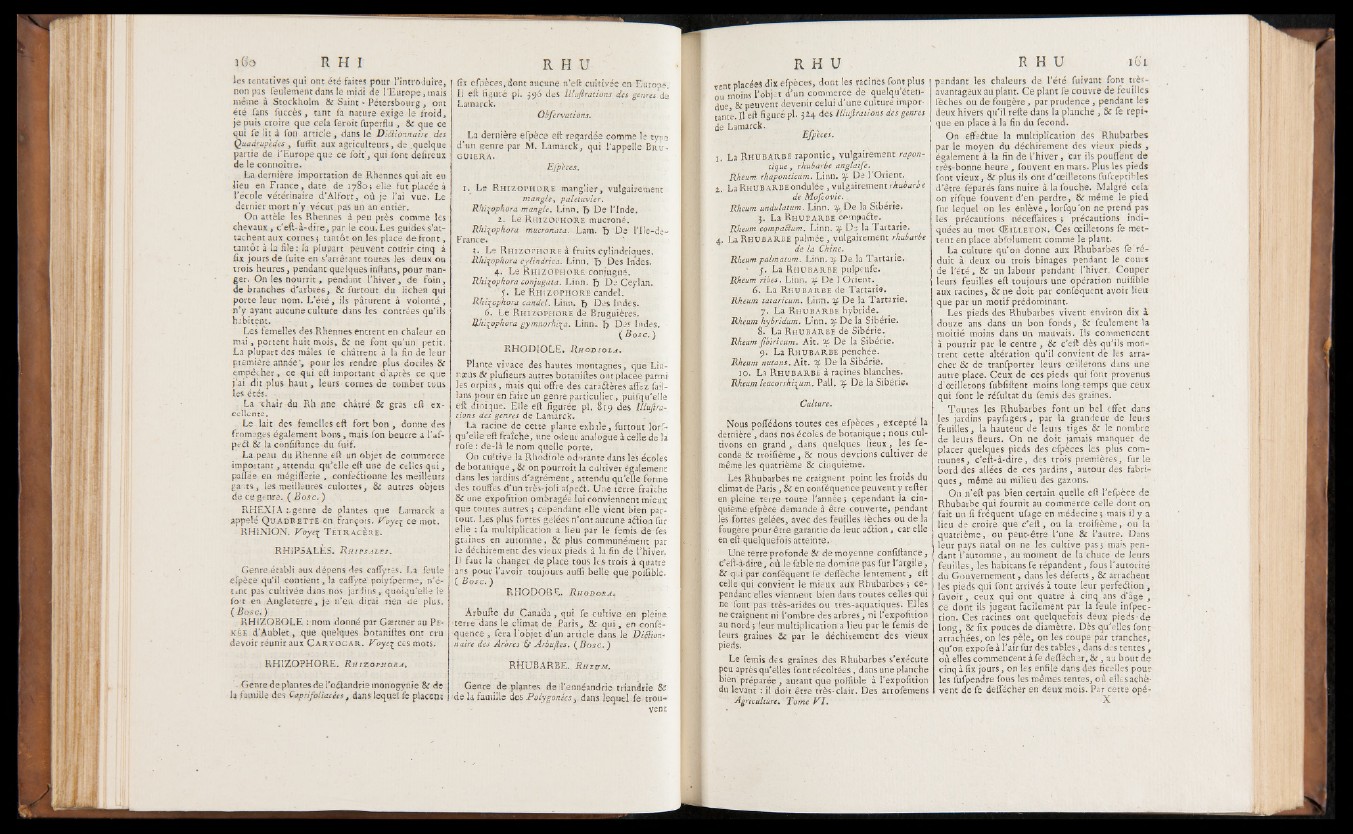
i6a R H I
les tentatives qui ont été faites pour rintroduire,
non pas feulement dans le midi de l'Europe, mais
même à Stockholm & Saint - Pétersbourg, ont
été fans fuccès , tant fa nature exige le froid,
je puis croire que cela feroit fuperflu , & que ce
qui fe lit à fon article, dans le Dictionnaire des
Quadrupèdes , fuffit aux agriculteurs, de ,quelque
partie de l'Europe que ce fo it, qui font defireux
de le connoitre.
La dernière importation de Rhennes qui ait eu
lieu en France, date de 1780? elle fut placée à
l’école vétérinaire d’Alfor t, ou je l’ai vue. Le
dernier mort n’y vécut pas un an entier.
On attèle les Rhennes à peu près comme les
chevaux, c’eft-à-dire, par le cou. Les guides s’attachent
aux cornesj tantôt on les place de front,
tantôt à la file :.fa plupart peuvent courir cinq à
fix jours de fuite en s’arrêtant toutes les deux ou
trois heures, pendant quelques inftans, pour manger.
On les nourrit, pendant l’hiv e r , de foin,
de branches d’arbres, & furtout du lichen qui
porte leur nom. L ’é té , ils pâturent à volon té ,
n’y ayant aucune culture dans les contrées qu’ils
habitent.
Les femelles des Rhennes entrent en chaleur en
mai, portent huit mois, & ne font qu’un, petit,
La plupart des mâles fe châtrent à la fin de leur
première année-, pour les rendre plus dociles &
empêcher, ce qui eft important d'après ce que
j’ai dit plus hau t, leurs cornes de tomber tous
les étés.
La 'chair du Rh nne châçré & gras eft excellente.
Le lait des femelles eft fort b o n , donne des
fromages également bons, mais fon beurre a l'af-
peCt & la confiftance du fuif.
La peau du Rhenne eft un objet de commerce
important, attendu qu’ elle eft une de celles q u i,
panée en mégifferie , confectionne les meilleurs
gants, les meilleures culottes, & autres objets
de ce genre. ( Bose;)
RHEXIA .'.genre de plantes que Lamarck a
appelé QüAdrette en François. Voye-^ ce mot.
RH1NION, Voyei T étracùre.
RHiPSALES. R hi p s a l e s .
Genre.établi aux dépens des caffytes. La feule
ofpèce qu’il contient, la çafTyte polyfperme, n’ é-
■ unc pas cultivée dans nos jardins, quoiqu’elle le
foit en Angleterre, je n’ en. dirai rien de plus.
( B o se . )
RH1ZOBOLE : nom donné par Gærtner au Pe-
kêe d’Aublet., que quelques botaniftes ont cru
devoir réunir aux C ar yq c a r . Voyeç ces mots,
RHIZOPHORE. R h iv o ph o r a *
Genre de plantes de l’oCtandrie monogynie & de
la famille des Caprifoliacées , dans lequel fe placent
R H U
fix efpèces, dont aucune n’eft cultivée en Europe,
Il eft figuré pl. 396 des Illufirations des genres de
Lamarck.
Observations.
La dernière efpèce eft regardée comme le type
d’ un genre par M. Lamarck, qui l’appelle Br u -
guiera.
Ejpeces.
1. Le Rhizophore manglier, vulgairement
mangte, palétuvier.
Rkiiophora mangle. Linn. T> De l’ Inde.
2. Le Rhizophore mucroné.
Rhi^opkora mucronata. Lam. Ij De l’ Ile-de-
France.
Le Rhizophore à fruits cylindriques.
Rkiçophora cylindrica. Linn. Des Indes.
4. Le Rhizophore conjugué.
Rhi[opkora conjugata. Linn. De Ceylan.
y. Le Rhizophore candel.
Rhi^ophora candel. Linn. Des Indes.
6. Le Rhizophore de Bruguières.
Rhi^opkora gymnorhi^a. Linn. Des Indes.
( Bosc» )
RHODIOLE. Rhod iol a .
Plante vivace des hautes montagnes, que Lin-
ræûs & plufieurs autres botaniftes ont placée parmi
les orpins, mais qui offre des caractères affez fail-
lans pour en faire un genre particulier, puifqu’elle
eft dioïque. Elle eft figurée pl. 819 des Illufira-
tions des genres de Lamarck.
La racine de cette plante exhale, furtout lorf-
qu’elle eft fraîche, une odeur analogue à celle de la
rofe : de-là le nom quelle porte.
On cultive la Rhodiôle odorante dans les écoles
de botanique, & on pourroit la cultiver également
dans les jardins d’agrément, attendu qu’elle forme
des touffes d’ un très-joli afpe'Ct. Une terre fraîche
& une expofition ombragée lui conviennent mieux
que toutes autres 5 cependant elle vient bien partout.
Les plus forces gelées n’ont aucune aCtion fur
elle : fa multiplication a lieu par le femis dèfes
graines en automne, & plus communément par
le déchirement des vieux pieds à la fin de l’hiver.
Il faut la changer de place tous les trois à quatre
ans pour l’avoir toujours auffi belle que polfible.
( Bosc. )
RHODOBE. Rhodora,
Arbufte du Canada, qui fe cultive en pleine
terre dans le climat de Paris, & q u i, en çonfé-
quence, fera l ’objet d’un article dans le Diction*
naire des Arbres 6* Arbujies. ( Bosc. )
RHUBARBE. R heum.
Genre de plantes de l’ennéandrie triandrie &
de la famille des Polygonécs, dans lequel fe trouvent
R H U
,ent placées dix efpèces, dont les racines font plus
OU moins l'objet d‘ un commerce de quelqu'éten-
due & peuvent devenir celui d’ une culture importante,
Il eft figuré pl. 324 des Illuftraiions des genres
de Lamarck. t! j -
Efpeces.
1. La Rhubarbe rapontic, vulgairement rapontique
y rhubarbe anglaise.
Rheum rkaponticüm. Linn. 2f De 1 Orient.
2. La Rhubarbe ondulée, vulgairement rhwbarbe
de Mofcovie. ..
Rheum undulatum. Linn. 2£, De la Sibérie. 3. La Rh u b a r b e compacte.
Rheum compaStum. Linn. 2f De la Tartarie.
4. La Rhubarbe palmée, vulgairement rhubarbe
de la Chine.
Rheum palmatum. Linn. "2f De la Tartarie.
' y. La R h ub ar b e pulpeufe.
Rheum ribes. Linn. % De 1 Orient. g
6 . La Rhubarbe de Tartarie.
Rheum tataricum. Linn. 2f De la Tartarie.
7. La Rhubarbe hybride.
Rheum hybridum. Linn. "if De la Sibérie.
8. La Rhubarbe de Sibérie.
Rheum jibiricum. Ait. 2£ De la Sibérie. 9. La Rh ub ar b e penchée.
Rheum nutans. Ait. 2f De1 la Sibérie.
10. La Rhubarbe à racines blanches.
Rheum leucorrhi^um. Pail. ^ De la Sibérie.
Culture.
Nous poffédons toutes ces efpèces, excepté la
dernière, dans nos écoles de botanique ; nous cultivons
en grand, dans quelques lieux, les fécondé
& troifième, & nous devrions cultiver de
même les quatrième & cinquième.
Les Rhubarbes ne craignent point les froids du
climat de Paris, 8 c en conléquence peuvent y refter
en pleine terre toute l’année} cependant la cinquième
efpèce demande à être couverte, pendant
les fortes gelées, avec des feuilles lèches ou de la
fougère pour être garantie de leur aCtion, car elle
en eft quelquefois atteinte.-
Une terre profonde & de moyenne confiftance ,
c’ eft-à-dire, où le fable ne domine pas fur l’argile,
& qui par conféquent fe deffèche lentement, eft
celle qui convient le mieux aux Rhubarbes } cependant
elles viennent bien dans toutes celles qui
ne font pas très-arides ou très-aquatiques'. Elles
ne craignent ni l’ombre des arbres, ni l’ expofition
au nord} leur multiplication a lieu par le femis de
leurs graines te par le déchirement des vieux
pieds*
Le femis des graines des Rhubarbes s’exécute
peu après qu’elles font récoltées, dans une planche
bien préparée, autant que poflîble à l’expofition
du levant : il doit être très-clair. Des arrofemens
Agriculture. Tome FX
R H U 161
pendant les chaleurs de l’été fuivant font très-
avantageux au plant. C e plant fe couvre de feuilles
lèches ou de fougère, par prudence, pendant les
deux hivers qu’ il refte dans la planche , & fe repique
en place à la fin du fécond.
On effectue la multiplication des Rhubarbes
par le moyen du déchirement des vieux pieds ,
également à la fin de l’h iv e r , car ils pouffent de
très-bonne heure, fouvent en mars. Plus les pieds
font vieux, & plus ils ont d’oeilletons fufceptibles
d’être féparés fans nuire à la Touche. Malgré cela
on rifque fouvent d’en perdre, & même le pied
fur lequel on les enlève, lorfqu’on ne prend pas
les précautions néceffaires ; précautions indiquées
au mot OEilleton. Ces oeilletons fe mettent
en place abfolument comme le plant.
La culture qu’ on donne aux Rhubarbes fe réduit
à deux ou trois binages pendant le cours
de l ’é té , & un labour pendant l’hiver. Couper
leurs feuilles eft toujours une opération nuifîbie
aux racines, & ne doit par conféquent avoir lieu
que par un motif prédominant.
Les pieds des Rhubarbes vivent environ dix à
douze ans dans un bon fonds, & feulement la
moitié moins dans un mauvais. Ils commencent
â pourrir par le centre , & c’eft dès qu’ ils montrent
cette altération qu’il convient de les arracher
& de tranfporter leurs oeilletons dans une
autre place. Ceux de ces pieds qui font provenus
d’oeilletons fubfiftent moins long temps que ceux
qui font le réfultat du femis des graines.
Toutes les Rhubarbes font un bel effet dans
les jardins payfagers, par la grandeur de leurs
feuilles, la hauteur de leurs tiges & le nombre
I de leurs fleurs. On ne doit jamais manquer de
placer quelques pieds des efpèces les plus com-
| munes, c’ eft-à-dire, des trois premières, furie
bord des allées de ces jardins, autour des fabriques
, même au milieu des gazons,
j On n’eft pas bien certain quelle eft l’efpèce de
Rhubarbe qui fournit au commerce celle dont on
fait un fi fréquent ufage en médecine j mais il y a
lieu de croire que c’e f t , ou la troifième, ou la
quatrième, ou peut-être l’une & l’autre. Dans
leur pays natal on ne les cultive pas 5 mais pendant
l’automne, au moment de la chute de leurs
feuilles, les habitans fe répandent, fous l’autorité
du Gouvernement, dans les déferts., & arrachent
les pieds qui font arrivés à toute leur perfection,
favoir, ceux qui ont quatre à. cinq ans d’â g e ,
ce dont ils jugent facilement pay la feule infpec-
tion. Ces racines ont quelquefois deux pieds-de
long, & fix pouces de diamètre. Dès qu’elles font
arrachées, on les pèle, on les coupe par tranches,
qu’ on expofe à l’ air fur des tables', dans des tentes,
où elles commencent à fe defféclur, & , au bout de
cinq à fix jours, on les enfile dans des ficelles pour
les fufpendre fous les mêmes tentes, où elles achèvent
de fe defféçher en deux mois. Par cette opé