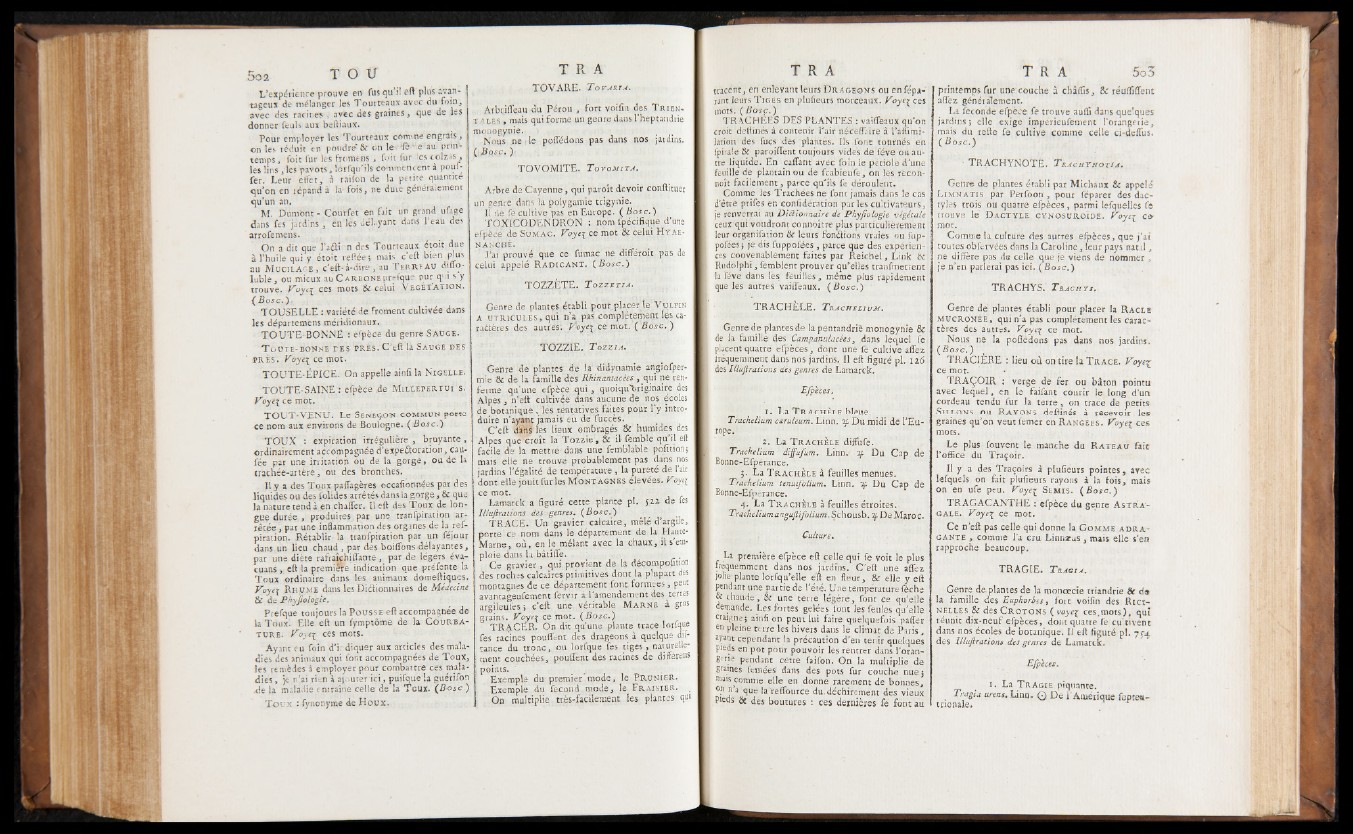
.002 T R A
TOVARE. T o v a r ia .
T O U
L ’e x p é rie n c e p ro u v e e n fus q u ’i! e ft plus a v a n - j
ta g e u x d e m é la n g e r les T o u r te a u x a v e c d u f o in , I
a v e c d e s ra c in e s . a v e c d e s g ra in e s , q u e d e le s
d o n n e r feuls aux b e ftia u x .
Pour employer les Tourteaux comme engrais , j
on les réduit en poudre* & on le/'fème-aiL prin- !
temps, foit fur les fromens , foit lur es colzas, J les lins , les pavots, lôrfqu’ils commencent a pouffer.
Leur effet, à railon de la petite quantité
qu’on en répand à la- fois, ne dure généralement
qu’un an.
M. Dumont - Courfet en fait un grand ufage
dans fes jardins, ën les délayant dans l’eau des
arrofemens.
On a d it q u e l’a d i n des T o u r te a u x é to it d u e
à l’h u ile q u i y é t o i t re f té e j mais c ’eft b ie n plus
a u M u c i l a g e , c ’e f t- à - d i r e , au T e r r e a u d iflo -
l u b l e , o u m ie u x au C a r b o n e p re tq u e p u r qui s y
t r o u v e . V o y ce s m o ts & c e lu i V é g é t a t io n .
{ B o s e . ' ) ,
TOUSELLE : variété de froment cultivée dans
les départemens méridionaux.
TOUTE-BONNE : e fp è c e du g e n r e S a u g e .
"To u t e - b o n n e t e s p r é s . C’eft la S a u g e d e s
' p r é s . Voye^ c e m o t.
TOUTE-ÉPICE. On a p p e lle ainfi la N ig e l l e .
TOUTE-SAINE : e fp è c e d e M i l l e p e r t u i s .
V o y e z c e m o t.
TOU T-VENU. Le S é n e ç o n c o m m u n p o r te
ce n om aux e n v iro n s d e Boulogne. ( B o . s c . )
TOUX : e x p ira tio n ir ré g u liè re , b r u y a n t e ,
o rd in a ir em e n t a c c om p a g n é e d ’e x p e c to r a tio n , cau-
fé e p a r u n e ir r ita tio n o u d e la g o r g e , o u d e la
c r a c h é e - a r tè r e , o u d e s b ro n c h e s .
Il y a des Toux paffagères occafionnées par des
liquides ou des folides arrêtés dans la gorge, & que
la nature tend à en chaffer. Il eft des Toux de longue
durée , produites, par une transpiration arrêtée
, par une inflammation des organes de la ref-
piration. Rétablir la tranfpiration par un féj'our
dans un lieu chaud, par des boiffons .délayantes,
par une diète rafraîchiflante, par de légers éva-
cuans , eft la première indication que préfente la
Toux ordinaire dans les animaux domeftiques.
JV o y e z Rhume dans les Dictionnaires de M é d e c in e
& de P h y s io lo g i e .
Prefque toujours la P o u s s e eft accompagnée de
la T o u x . Elle eft un fymptôme de la C o u r b a t
u r e . V o y e z ces mots.
Ayant eu foin d’irdiquer aux articles des maladies
des animaux qui font accompagnées de Toux,
les remèdes à employer pour combattre ces maladies,
je n’ai rien à ajouter ici, puifquela guérifon
de la maladie entraîne celle de la Toux. ( B o s e . )
Toux : fynonyme de Houx,
Arbriffeau du Pérou , fort voifm des Triennales
, mais qui forme un genre dans l’heptandrie
monogynie. !
Nous ne/le poffédons pas dans nos jardins.
(, B q s ç .
T0V0M1TE. T o v om i t a .
Arbre de Cayenne, qui paroît devoir conftituer
un genre dans la polygamie trigynie.
Il tiè fe cultive pas en Europe. ( B o s c . )
TOX1CODENDRON : nom lpécifique d’une
efpèce de Sumac. Voyez ce mot & celui Hyae-
NANCHÉ.
J'ai prouvé que ce fümac ne différoit pas de
celui appelé Rad icant. (B o s c . )
TOZZÈTE. T o z z e t i a .
Genre de plantes établi poutplacèrle V ulpin
a utricules , qui n’a pas complètement les caractères
des autres1. ^ ‘o y e[ cé m‘ot. ( B o s c . )
TOZZÏE. T o z z ia .
Genre de plantes de ia didynamie angiofper-
mie & de la famille des R h in a n ta c é e s , qui ne renferme
qu’une efpèce qui, quoiqu’briginaire des
Alpes , n’eft cultivée dans aucune de nos écoles
de botanique, les tentatives faites pour l’y introduire
n’ayant jamais eu de fuccès.
C’eft d§h£ les lieux ombragés & humides des
Alpes que*croît la Tozzie , & il femble qu’il eft
facile de la mettre dans une femblable pofition;
mais elle ne trouvé probablement pas dans nos
jardins l’égalité de température, la pureté de l’air
dont elle jouit furies Montagnes élevées. V oy e [
ce mot.
Lamarck a figuré cette plante pî. 5.22 de fes
l llu f i r a t io n s d e s g en r e s . ( B o s c . )
TRACE. Un gravier calcaire, mêlé d’argile,
porte ce nom dans le département de la Haute-
Marne, où, en le mêlant avec la chaux, il s’em* |
ploie dans la bâtiffe.
Ce gravier, qui provient de la décompofitron
des roches calcaires primitives dont la plupart des
montagnes de ce département font formées, peur
avantageufement fervir à l’amendement des terres
argileufesj c’eft une véritable Marne à gros
grains. V o y e z ce mot. ( B o s c . ) TRACER. On dit qu’une plante trace lorfque
fes racines pouffent des drageons à quelque dif-
; tance du tronc, ou lorfque fes tiges, naturellement
couchées, pouffent des racines de différons
1 points.
Exemple du premier’mode, le Prunier.
Exemple du fécond mode, le Fr a is ie r . .
On multiplie très-facilement les plantes qui
T R A T R A 5o3
tracent, en enlevant leurs Drageons ou en réparant
leurs T iges en plufieurs morceaux. V o y e z ces
mots; ( B o s c . )
TRACHÉES DES PLANTES : vaiffeaux qu’on
croit detlinés à contenir l’air néceffaire à raflimi-
lation des fucs des plantés. Ils font tournés en
fpitaîe & paroiffent toujours vidés de fève ou autre
liquide. En caftant avec foin le pétiole d’une
feuille de plantain ou de feabieufe, on les recon-
noît facilement, parce qu’ils fe déroulent.
Comme les Trachées ne font jamais dans le cas
d’être prifes en confidération par les cultivateurs,
je renverrai au D i c t io n n a i r e d e P h y f io lo g i e v é g é ta le
ceux qui voudront connoître plus particulièrement
leur organifation & leurs fondions vraies ou fup-
poféesj je dis fuppofées , parce que des expériences
convenablement faites par Reichel, Link &
Rudolphi, femblent prouver qu’elles tranfmectent
la fève dans les feuilles , même plus rapidement
que les autres vaiiTeaux. ( B o s c . )
TRACHELE. T r a ch e l ium.
Genre de plantes de la pentandriè monogynie &
de la famille des C am p a n u la c é e s 9 dans lequel fë
placent quatre efpèces, dbqt une fe cultive affez,
fréquemment dans nos jardins., Il eft figuré pl. 126 :
des I l lu f i r a t io n s d e s g en r e s de Lamarck.
E fp è c e s .
1. La T rachéle bleue.
T r a c h e lium c& ru leum . Linn. 7f Du midi de l’Europe.
2. La T rachéle diffufe.
T r a c h e lium d if fu fum . Linn.* "if Du Cap de
Bonne-Efpérance.
3. La T rachéle à feuilles menues.
T r a c h e lium te n u ifo lium . Linn. I f Du Cap de
Bonne-Efpérance.
4. La T rachéle à feuilles étroites.
T r a c h e lium a n g u f t ifo lium . Schousb. i f De Maroc.
C u ltu r e•
La première efpèce eft celle qui fe voit le plus
fréquemment dans nos jardins. C’eft une affez
jolie1 plante lorsqu'elle e'ft en fleur, & elle y eft
pendant une partie de l’été. Une température fèche
& chaude, & une terre légère, font ce qu’elle
demande. Les fortes gelées font les feules qu’elle
craigneî ainfi on peut lui faire quelquefois paffer
en pleine terre les hivers dans le climat de Paris,
ayant cependant la précaution d’en tenir quelques
pieds en pot pour pouvoir les rentrer dans i’oran-
gcrie pendant cétte faifon. On la multiplie de
graines femées dans des pots fur couche nue 3
mais comme elle en donne rarement de bonnes,
°p n’a que la reffource du. déchirement des vieux
pieds & des boutures : ces dernières fe font au
printemps fur une couche à châflis, 8c réufliffent
affez généralement.
La fécondé efpèce fe trouve auflî dans quelques
jardins; elle exige impérieufement l’orangerie,
mais du refte fe cultive comme celle ci-deffus.
: ( B o s c . )
TRACHYNOTE. T r a c h y h o t i a .
Genre de plantes établi par Michaux & appelé
Limnatis par Perfoon, pour féparer des dactyles
trois ou quatre efpèces, parmi lefquelles fe
trouve le Dactyle cynosuroïde. V o y e z co
mot.
Comme la culture des autres efpèces, que j’ai
toutes obfervées dans la Caroline, leur pays natal,
1 ne diffère pas jde celle que je viens de nommer ,
je n’en parlerai pas ici. ( B o s c . )
TRACHYS. T r a ch y s .
Genre de plantes établi pour placer la Racle
mucronée, qui n’a pas complètement les caractères
des autres. V o y e z ce mot.
Nous ne la pofiëdons pas dans nos jardins.
( B o s c . ) , .
TRACIERE : lieu où on tire la T race. Voyez
ce mot. ’ •
TRAÇOIR : verge de fer ou bâton pointa
avec lequel, en le faifant courir le long d’un
cordeau tendu fur la terre, on trace de petits
Sillons ou Rayons deftinés à recevoir les
graines qu’on veut femer en Rangées. V o y e z ces
mots.
Le plus fouvent le manche du Rateau fait
l’office du Traçoir.
Il y a des Traçoirs à plufieurs pointes, avec
lefquels on fait plufieurs rayons à la fois, mais
on en ufe peu. V o y e z Semis. ( B osc. )
TRAGACANTHE : efpèce du genre A str a gale.
V o y e% ce mot.
Ce n’eft pas celle qui donne la Gomme a d r a -
gante , comme l’a cru Linnæus , mais elle s’en
rapproche beaucoup.
TRAGIE. T ragza.
Genre déplantés de la monoecie triandrie 8c de
la famille des E u p h o r b e s , foit voifin des Ricr-
nelles & des C rotons ( v o y e z ces.mots), qui
réunit dix-neuf efpèces, dont quatre fe cu tivenc
dans nos écoles de botanique. Il eft figuré pl. 75-4
des I llu f i r a t io n s d e s g en r e s de Lamarck.
E fp è c e s .
1. La T rAgie piquante.
. E 'ra g ia u r en s , Linn. O De l'Amérique fepteu-
trionale.