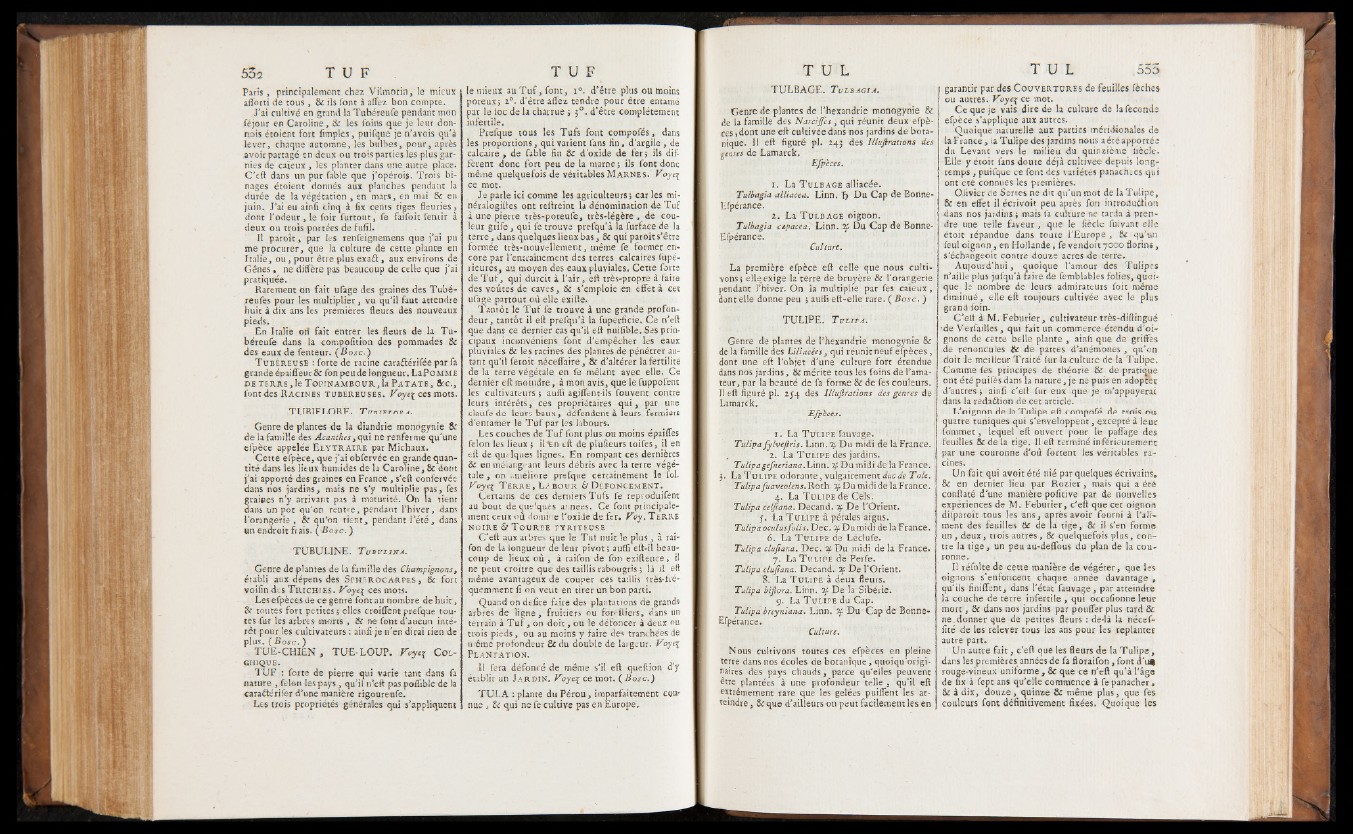
53s T U F
Paris, principalement chez Vilmorin, le mieux
afforti de tous , 8c ils font à affez bon compte.
J’ai cultivé en grand la Tubéreufe pendant mon
féjour en Caroline, 8c les foins que je leur donnais
étoient fort lîmples, puifque je n’avois qu’à
lever, chaque automne, les bulbes, pour, après
avoir partagé en deux ou trois parties les plus garnies
de caïeux, les planter dans une autre place.
C’eft dans un pur fable que j’opéroiÿ. Trois binages
étoient donnés aux planches pendant la
durée de la végétation , en mars, en mai 8c en
juin. J’ai eu ainfi cinq à lïx cents tiges fleuries,
dont l’odeur, le foir furtout, fe faifoit fentir à
deux ou trois portées de fufîl.
Il paroît, par les renfeignemens que j’ai pu
me procurer, que la culture de cette plante en
Italie, ou, pour être plus exaét, aux environs de
Gênes , ne diffère pas beaucoup de celle que j’ai
pratiquée.
Rarement on fait ufage des graines des Tubé-
reufes pour les multiplier, vu qu’il faut attendre
huit à dix ans les premières fleurs des nouveaux
pieds.
En Italie ort fait entrer les fleurs de la Tubéreufe
dans la compofition des pommades 8c
des eaux de fenteur. ( B o s c . )
T ubéreuse : forte de racine carattérifée par fa
grande épaiffeur & fon peu de longueur. LaPoMME
DE TERRE, le TOPINAMBOUR , la PATATE, flCC.,
font des Racines tubéreuses. V o y e% ces mots.
TUBIFLORE. T ub if lo r a .
Genre de plantes de la diandrie monogynie &
de la famiHe des A c a n th e s > qui ne renferme qu’une
efpèce appelée E lytraire par Michaux.
Cette efpèce, que j’ai obfervée en grande quantité
dans les lieux humides de h Caroline, & dont
j’ai apporté des graines en France, s’eft confervée
dans nos jardins, mais ne s’y multiplie pas, fes
graines n’y arrivant pas à maturité. On la tient
dans un pot qu’on rentre, pendant l’hiver, dans
l'orangerie , 8c qu’on tient, pendant l’été, dans
un endroit frais. ( B o s c . )
TUBULINE. T u b ûl in a .
Genre de plantes de la famille des C h am p ig n o n s ,
établi aux dépens des Spherocarpes, & fort
voifin des T richies. V o y e [ ces mots.
Les efpècesde ce genre font au nombre de huit,
& toutes fort petites * elles croiffent prefque toutes
fur les arbres morts , 5c ne font d’aucun intérêt
pour les cultivateurs : ainfi je n’en dirai rien de
plus. ( B o s c . )
TUE-CHIEN , TUE-LOUP. V o y e K C olchique.
TUF : forte de pierre qui varie tant dans fa
nature , félon les pays , qu’il treft pas poflïble de là
caraétérifer d’une manière rigoureufe.
Les trois propriétés générales qui s’appliquent
T U F
le mieux au Tuf, font, i°. d’être plus ou moins
poreux j i°. d’être affez tendre pour être entamé
par le foc de la charrue 53°. d’être complètement
infertile.
Prefque tous les Tufs font compofés, dans
les proportions, qui varient fans fin, d'argile , de
calcaire , de fable fin 8c d’oxide de fer, ils different
donc fort peu de la marne 5 ils font donc
même quelquefois de véritables Marnes. V o y e 1
ce mot.
Je parle ici comme les agriculteurs j car les mi-
néralogifies ont reltreint la dénomination de Tuf
à une pierre très-poreufe, très-légère , de couleur
grife, qui fe trouve prefqu’à la furface de la
terre, dans quelques lieux bas, & qui paroît s’être
formée très-nouvellement, même fe former encore
par l'entraînement des terres calcaires fupé-
rieures, au moyen des eaux pluviales. Cette forte
de Tuf, qui durcit à l’air, eft très-propre à faire
des voûtes de caves, & s’emploie en effet à cet
ufage partout où elle exifte.
Tantôt le Tuf fe trouve à une grande profondeur
, tantôt il eft prefqu’à la fuperficie. Ce n’eft
que dans ce dernier cas qu’il eft nuifible. Ses principaux
inconvéniens font d’empêcher lés eaux
pluviales 8c les racines des plantes de pénétrer autant
qu’il feroit néceffaire, & d’altérer la fertilité
de la terre végétale en fe mêlant avec elle. Ce
dernier eft moindre, à mon avis, que le fuppofent
les cultivateurs j aufiï agiffent-ils fouvent contre
leurs intérêts, ces propriétaires qui, par une
claufe de leurs baux, défendent à leurs fermiers
d’entamer le Tuf par les labours.
Les couches de Tuf font plus ou moins épaiffes
félon les lieux î il T.n eft de plusieurs toifes, il en
eft de quelques lignes. En rompant ces dernières
8c en mélangeant leurs débris avec la terre végétale
, on améliore prefque certainement le fol.
y ’oyei T erre, Labour & Défoncement’.
Certains de ces derniers Tufs fe reproduifent
au bout de quelques années. Ce font principalement
ceux où domine l’oxide de fer. V o y . T ERRE
noire & T ourbe fyriteus.e
C’eft aux arbres que le Tut nuit le plus, à rai-
fon de la longueur de leur pivot i aufli eft-il beaucoup
de lieux où , à raifon de fon exiftence, il
ne peut croître que des taillis rabougris > là il eft
même avantageux de couper ces taillis très-fréquemment
fi on veut en tirer un bon parti.
Quand on defire faire des plantations de grands
arbres de ligne, fruitiers ou forHliers, dans un
terrain à Tuf, on doit, ou le défoncer à deux ou
trois pieds, ou au moins y faire des tranchées de
-même profondeur 8c du double de largeur. V o y e \
Plantation.
Il fera défoncé de même s’il eft queftion d’y
établir un Jardin. V o y e £ ce mot. ( B o s c . )
TULA : plante du Pérou, imparfaitement eon-
nue, & qui ne fe cultive pas en Europe.
T U L
TULBAGE. T u l b a g ia .
Genre de plantes de l’hexandrie monogynie 8c
de la famille des N a r c i f f e s-, qui réunit deux efpèces
»dont une eft cultivée dans nos jardins de botanique.
Il eft figuré pl. 243 des l llu f i r a t io n s d e s
genres de Lamarck.
E fp è c e s .
1. La T ulbage alliacée.
T u lb a g ia a ll ia c e a . Linn. T) Du Cap de Bonne-
Efpérance.
2. La T ulbage oignon.
T u lb a g ia <c*.pacea'. Linn..^ Du Cap de Bonne-
Efpérance.
C u ltu r e .
La première efpèce eft celle que nous cultivons
j elle exige la terre de bruyère & l’orangerie
pendant l’hiver. On la multiplie par fes caïeux,
dont elle donne peu 5 aufti eft-elle rare. ( B o s c . )
TULIPE. T u l it a .
Genre de plantes de l’hexandrie monogynie 8c
de la famille des L i l ia c é e s , qui réunit neuf efpèces,
dont une eft l’objet d’une culture fort étendue
dans nos jardins, 8c mérite tous les foins de l’amateur,
par la beauté de fa forme 8c de fes couleurs.
Il eft figuré pl. 254 des l l lu f i r a t io n s d e s g en r e s de
Lamarck.
E fp è c e s .
1. La T ulipe fauvage.
T u l ip a f y l v e f i r i s . Linn. i f Du midi de la France.
2. La T ulipe des jardins.
T u l ip a g e fn e r ia n a . Linn. 2f Du midi de la France.
3. La T ulipe odorante, vulgairement d u e d e T ô l e . ,
T u l ip a f u a v e o le n s . Roth, i f Du midi de la France. ,
4. La T ulipe de Céls.
T u l ip a c e lf ia n a . Decand. i f De l'Orient,
y. La T ulipe à pétales aigus.
T u l ip a o c u lu s fo li s .. Dec. i f Du midi de la F rance.
è . La T ulipe de Léclufe.
T u l ip a c lu f ia n a . Dec. i f Du midi de la France.
7. La T ulipe de Perfe.
T u lip a c lu f ia n a . Decand. i f De l’Orient.
8. La T ulipe à deux fleurs.
T u l ip a b iflo r a . Linn. i f De la Sibérie.
9. La T ulipe du Cap.
T u l ip a b r e y n ia n a . Linn. i f Du Cap de Bonne-
Efpérance.
C u ltu r e .
Nous cultivons toutes ces efpèces en pleine ;
terre dans nos écoles de botanique, quoiqu'originaires
des pays chauds, parce qu’elles peuvent ■
être plantées à une profondeur telle , qu’il eft
extrêmement rare que les gelées puiffent les at- ;
teindre , 8c que d’ailleurs on peut facilement les en ;
T U L .535
garantir par des C ouvertures de feuilles fèches
ou autres. Voye1 ce mot.
Ce que je vais dire de la culture de la fécondé
efpèce s’applique aux autres.
Quoique naturelle aux parties méridionales de
la France, ia Tulipe des jardins nous a été apportée
du Levant vers le milieu du quinzième liècle.
Elle y étoit fans doute déjà cultivée depuis longtemps
, puifque ce font des variétés panachées qui
ont été connues les premières.
Olivier de Serres ne dit qu’un mot de la Tulipe,
8c en effet il écrivoit peu après fon introduction
dans nos jardins ; mais fa culture ne tarda à prendre
une telle faveur, que le fiècle fuivant elle
étoit répandue dans toute l’Europe , 8c qu’un
feul oignon, en Hollande, fe vendoi 17000 florin«,
s’échangeoit contre douze acres de terre.
Aujourd’hui, quoique l'amour des Tulipes
rt aille plus jufqu’à faire de femblables folies, quoique
le nombre de leurs admirateurs foit même
diminué, elle eft toujours cultivée avec le plus
grand foin.
C’eft à M. Feburier, cultivateur très-diftingué
•de Verfailles, qui fait un commerce étendu d’oignons
de cette belle plante , ainfi que de griffes
de renoncules & de pattes d’anémones, qu’on
doit le meilleur Traite fur la culture de la Tulipe.
Comme fes principes de théorie & de pratique
ont été puifés dans la nature, je ne puis en adopter
d’autres i ainfi c’eft fur eux que je m’appuyerai
dans la rédaction de cet article.
L’oignon de la Tulipe eft compofé de trois ou
quatre tuniques qui s’enveloppent, excepté à leur
fommet, lequel eft ouvert pour le paffage des
feuilles 5c de la tige. Il eft terminé inférieurement
par une couronne d’où fortent les véritables ra-*
cines.
Un fait qui avoit été nié par quelques écrivains,
8c en dernier lieu par Rozier, mais qui a été
conftaté d’une manière pofitive par de nouvelles
expériences de M. Feburier, c'eft que cet oignon
difparoît tous les ans, après avoir fourni à l’aliment
des feuilles 8c de ia tige, 8c il s’en forme
un , deux, trois autres , 8c quelquefois plus, contre
la tige, un peu au-deffous du plan de la couronne.
Il réfnlte de cette manière de végéter, que les
oignons s’enfoncent chaque année davantage ,
qu’ils finiffent, dans l’état fauvage, par atteindre
la couche de terre infertile , qui occafionne leur
mort, 8c dans nos jardins par pouffer plus tard 8c
ne.donner que de petites fleurs : de-là la nécef-
fité de les rélever tous les ans pour les replanter
autre part.
Un autre fait, c’eft que les fleurs de la Tulipe,
dans les premières années de fa ôoraifon, font d'u*
rouge-vineux uniforme , 8c que ce n’eft qu’à l’âge
de fix à fept ans qu’elle commence à fe panacher ,
8c à dix, douze, quinze 8c même plus, que fes
couleurs font définitivement fixées. Quoique les
r