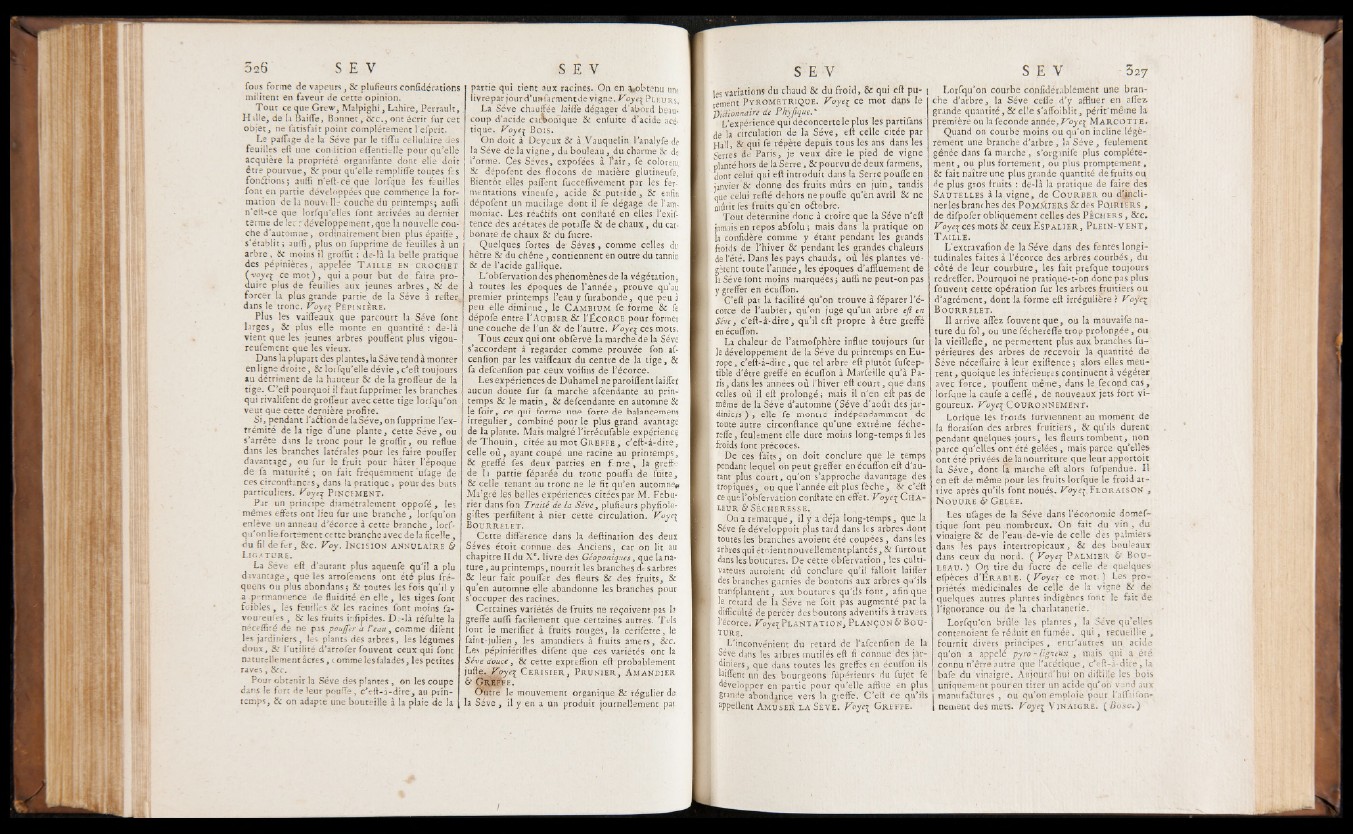
5 a6 S E V
fous forme de vapeurs, & plufïeurs confidérations
militent en faveur de cette opinion.
Tout ce que Grew, Malpighi, Lahire, Perrault,
Mille, de la Baiffe, B onnet, & c . , ont écrit fur cet
ob jet, ne fatisfait point complètement l'efprit.
Le paffage de la Sève par le tiffu cellulaire des
feuilles eft une condition effentielle pour qu'elle
acquière la propriété organifante dont elle doit
être pourvue, & pour qu'elle rempliffe toutes fes
fonctions ; auffi n’eft-ce que lorfque les feuilles
font en partie développées que commence la formation
de la nouvelle couche du printemps} auffi
n’eft-ce que lorfqu’elles font arrivées au dernier
terme de 1er : développement,que la nouvelle couche
d’automne, ordinairement bien plusépaiffe,
s'établit; auffi, plus on fupprime de feuilles à un
arbre, & moins il groffit ; de-là la belle pratique
des pépinières, appelée T a ille en c ro ch et
(voye^ ce m o t ) , qui a pour but de faire» produire
plus de feuilles aux jeunes arbres, & de
forcer la plus grande partie de la Sève à relier,
dans le tronc. Voyez Pép in iè re.
Plus les vaiffeaux que parcourt la Sève font
larges, & plus elle monte en quantité : de-là
vient que les jeunes arbres pouffent plus vigou-
reufement que les vieux.
Dans la plupart des plantes, la Save tend à monter
en ligne droite, & lorfqu'elle dévie , c'eft toujours
au détriment de la hauteur & de la groffeur de la
tige. C'eft pourquoi il faut fupprimer les branches
qui rivalifent de groffeur avec cette tige lorfqu'on
veut que cette dernière profité.
Si, pendant l'a&ion de la Sève, on fupprime 1 extrémité
de la tige d'une plante, Cette S è v e , ou
s'arrête dans le tronc pour le groflir, ou reflue
dans les branches latérales pour les faire pouffer
davantage, ou fur le fruit pour hâter l’époque
de fa maturité ; on fait fréquemment ufàge de
ces circonftances, dans la pratique, pour des buts
particuliers, Voyez Pincement.
Par un principe .diamétralement oppofé, les
mêmes effets ont lieu fur une branche, lorfqu’on
enlève un anneau d’écorce à cette branche, lorfqu'on
lie fortement cette branche avec de la ficelle,
du fil de fe r , & c . Voy. In c is ion an n u l a ir e &
L ig a t u r e .
La Sève eft d’autant plus aqueufe qu'il a plu
davantage, que les arrofemens ont été plus fré-
quens ou plus abondans; & toutes les fois qu'il y
a permannence de fluidité en e lle , les tiges font
foibies, les feuilles & les racines font moins fa-
voureufes , & les fruits infipides. De-là réfulte la
néceffiré de ne pas pouffer a l'eau, comme difent
les jardiniers, les plants des arbres, les légumes
doux, & l'utilité d’arrofer fouvent ceux qui font
naturellement âcres, comme les falades, les petites
raves, &c.
Pour obtenir la Sève des plantes, on les coupe
dans le fort de leur pouffe, c'eft-à-dire, au printemps,
& on adapte une bouteille à la plaie de la [
S E V
partie qui tient aux racines. On en ^obtenu une
livrepar jour d’urafarmentde vigne. Voyeç Pleurs,
La Sève chauffée laiffe dégager d'abord beau-
coup d’acide carbonique & enfuite d'acide acétique.
Voyez Bois.
On doit à Deyeux & à.Vauquelin l'analyfe de
la Sève de la v igne, du bouleau, du charme & de
l'orme. Ces Sèves, expofées à Pair, fe colorent
& dépofent des flocons de matière glutineufe.
Bientôt elles paffent fucceflivement par les fermentations
vineufe, acide & putride, & enfin
dépofent un mucilage dont il fe dégage de l'ammoniac.
Les réaétifs ont conffaté en elles Texif-
tence des acétates de potaffe & de chaux, du carbonate
de chaux & du fucre.
Quelques fortes de- Sèves, comme celles du
hêtre & du chêne, contiennent en outre du tannin
& de l’acide gallique.
L'obfervation des phénomènes de la végétation,
à toutes les époques de l'année, prouve qu’au
premier printemps l'eau y furâbonde, que peu à peu elle diminue, le C am b ium fe forme & fe
dépofe entre I’A ubier & I'Écorce pour former
une couche de l’ un & de l’autre. Voyez ces mots.
Tous ceux qui ont obfervé la marche de la Sève
s'accordent à regarder comme prouvée fon af-
cenfion par les vaiffeaux du centre de la tig e , &
fa defcenfîon par ceux voifins de l’écorce.
Les expériences de Duhamel ne paroiffent Iaiffef
aucun doute fur fa marche afeendante au printemps
& le matin, & defeendante en automne &
le foir , ce qui forme une forte de balancement
irrégulier, combiné pour le plus grand avantage
de la plante. Mais malgré l’irrécufable expérience
de Tnouin, citée au mot G reffe , c'eft-à-dire,
celle o ù , ayant coupé une racine au printemps,
& greffé fes deux parties en fen te , la greff-.’
de h partie féparée du tronc pouffa de fuite,
& celle tenant au tronc ne le fit qu’en automne*
Ma!gré les belles expériences citées par M. Febu-
rier dans fon Traité de la Sève, plufïeurs phyfiolo-
gsftes -perfiftent à nier cette circulation. Voye\
Bo u r r e l e t .
Cette différence dans la deftination des deux
Sèves étoit connue-des Anciens, car on lit au
chapitre II du X e. livre des Gèoponiques, que la nature
, au printemps, nourrit les branches desarbres
& leur fait pouffer des fleurs & des fruits, &
qu’en automne elle abandonne les branches pour
s’occuper des racines.
Certainés variétés de fruits ne reçoivent pas b
greffe auffi facilement que certaines autres. Tels
font le merifier à fruits rouges, la cerifette, le
faint-julien, les amandiers à fruits amers, &c.
Les pépiniériftes difent que ces variétés ont la
Sève douce 9 & cette expreffion efbprobablement
jufte%J&ye:L C e r i s ie r , Pr u n ie r , A mandier
& G ref fe.
Outré le mouvement organique & régulier de
la S è v e , il y en a un produit journellement pat
|
S E V
les variations du chaud & du froid, & qui eft pu- i
rement Pyr om é t r iq u e . Voyez ce mot daps le
piftiortnaire de Phyfique.%
L’expérience qui déconcerte le plus les partifans
de la circulation de la Sève, eft celle citée par
Hall, & qu‘ fe répète depuis tous les ans dans les
Serres de Paris, je veux dire le pied de vigne
planté hors de la Serre, & pourvu de deux farmens,
dont celui qui eft introduit dans la Serre pouffe en
janvier & donne des fruits mûrs en juin, tandis
que celui refté dehors ne pouffe qu’ën avril & ne
mûrit fes'fruits qu’en oCiobrë.
Tout détermine donc à croire que la Sève n'eft
jamais en repos abfolu ; mais dans la pratique on
la confidère comme y étant pendant les grands
froids de l’hiver & pendant les grandes chaleurs
de l’été. Dans les pays chauds, où lés plantes v é gètent
toute l’année, les époques d’affluement de
la Sève font moins marquées; auffi ne peut-on pas
y greffer en éciiffon.
C ’eft par la facilité qu'on trouve à féparer l ’écorce
de l’aubier, qu’on juge qu’ un arbre eft en
Sève 3 c'eft-à-dire, qu’il eft propre à être greffé
en écuffon.
La chaleur de l’atmofphère influe toujours fur
le développement de la Sève du printemps en Europe,
c'eft-à-dire, que tel arbre eft plutôt fufeep-
tible d'être greffé en écuffon à Marfeille qu’ à Paris,
dans les années où l’hiver eft court, que dans,
celles où il eft prolongé; mais il n’en eft pas de
même de la Sève d'automne (Sève d’août des jardiniers
) ; elle fe 'montré indépendamment de
toute autre circonftar.ce qu'une extrême féche-
reffe, feulement elle dure moins long-temps fi lés
froids font précoces.
De ces faits, on doit conclure que le temps
pendant lequel on peut greffer en écuffon eft d'autant
plus court, qu’on s’approche davantage des
tropiques, ou que l’année eft plus fèche, &r c’eft
ce que l’obfervation conftate en effet. Voyez C haleur
& Sécheresse^
On a remarqué, il ÿ a déjà long-temps, que la
Sève fe développoit plus tard dans les arbres dont
toutes les branches avoient été coupées, dans les
arbres qui étoient nouvellement plantés, & furtout
i dans les boutures. De cette obfervation, les cultivateurs
auroient dû conclure qu’ il falloir laiffer
I des branches garnies de boutons aux arbres qu'ils
tranfplantent, aux boutures qu’ ils font, afin que
le retard de la Sève ne foit pas augmenté par la
' difficulté de percér des boutons adventifs à travers
l’écorce* VoyezPlantation*, Plançon6* Bouture.
L’inconvénient du retard de l’afcerifion de la
Sève dans les arbres mutilés eft fi connue des jardiniers,
que dans toutes les greffes en écuffon ils
1 biffent un des bourgeons füpérieurs- du fujet fe
[ développer en partie pour qu’elle afflue en plus
grande abondance vers la greffe. C ’eft ce qu’ ils
appellent Amuser la Sève. Voyez Greffe.
S E V 3 2 7
Lorfqu'on courbe confidérablement une branche
d'arbre, la Sève ceffe d'y affluer en affez
grande quantité, & elle s'affoiblit, périt’même la
première ou la fécondé année. Voyez Ma r c o t t e .
Quand on courbe moins ou qu’on incline légèrement
une branche d’arbre, la S è v e , feulement
gênée dans fa marche . s’orgrnife plus complètement,
ou plus fortement, ou plus promptement,
& fait naître une plus grande quantité de fruits ou
de plus gros fruits : de-là la pratique de faire des
Sautelles à la.vigne, de C ourber ou d’jncli-
ner les branches des Pommiers & des Poiriers ,
de difpofer obliquement celles des Pêchers, & c.
Voyez ces mots & ceux Espalier, Plein-v e n t ,
T aille.
L’ extravafion de la Sève dans des fentes longitudinales
faites à l’écorce des arbres courbés, du
côté de leur courbure, les fait prefque toujours
redreffer. Pourquoi ne pratique-t-on donc pas plus
fouvent cette opération fur les arbres fruitiers ou
d’agrément, dont la forme eft irrégulière ? Voyez
Bourrelet.
Il arrive affez fouvent que, ou la mauvaife nature
du fo l, ou une féchereffe trop prolongée, ou
la vieillefîe, ne permettent plus aux branches fu-
périeures des arbres de recevoir la quantité de
Sève néceffaire à leur exiftence ; alors elles meurent
, quoique les inférieures continuent à végéter
avec force, pouffent même, dans le jecond cas ,
lorfque la caufe à ceffé, de nouveaux jets fort vigoureux.
Voye% Couronnement.
Lorfque les froids furviennent au moment de
la floraifon des arbres fruitiers, & qu’ ils durent
pendant quelques jours, les fleurs tombent, non
parce qu'elles ont été gelées, mais parce quelles
ont été privées de la nourriture que leur apportoit
la Sève, dont la marche eft alors fufpendue. Il
en eft de même pour les fruits lorfque le froid arrive
après qu'ils font noués. Voyez.Floraison ,
Nouure & Gelée.
Les ufages de la Sève dans l’économie domef-
tique font peu nombreux. On fait du vin , du
vinaigre & de l'eau-de-vie de celle des palmiers
dans les pays intertropicaux, & des bouleaux
dans ceux du nord. ( Voyez Palmier & Bo u le
au . ) On tire du fucre de celle de quelques
efpèces d’ÉRABiE. ( Voyez ce mot. ) Les propriétés
médicinales de celle de la vigne & de
quelques autres plantes indigènes font le fait de
l’ignorance ou de la charlatanerie.
Lorfqu’on brûle les plantes, la Sève qu’elles
contenoient fe réduit en fumée, qui , recueillie ,
fournit divers principes , entr'autres un acide
qu’on a appelé pyro - ligneux , mais qui a été
connu n’être autre que l'acétique, c'eft-à-dire, la
bafe du vinaigre. Aujourd’hui on diftille les bois
uniquement pour en tirer un acide qu'on vend aux
| manufactures , ou qu'on emploie pour l’affaifon-
| nement des mets. Voyez V inaigre. ( B osc*)