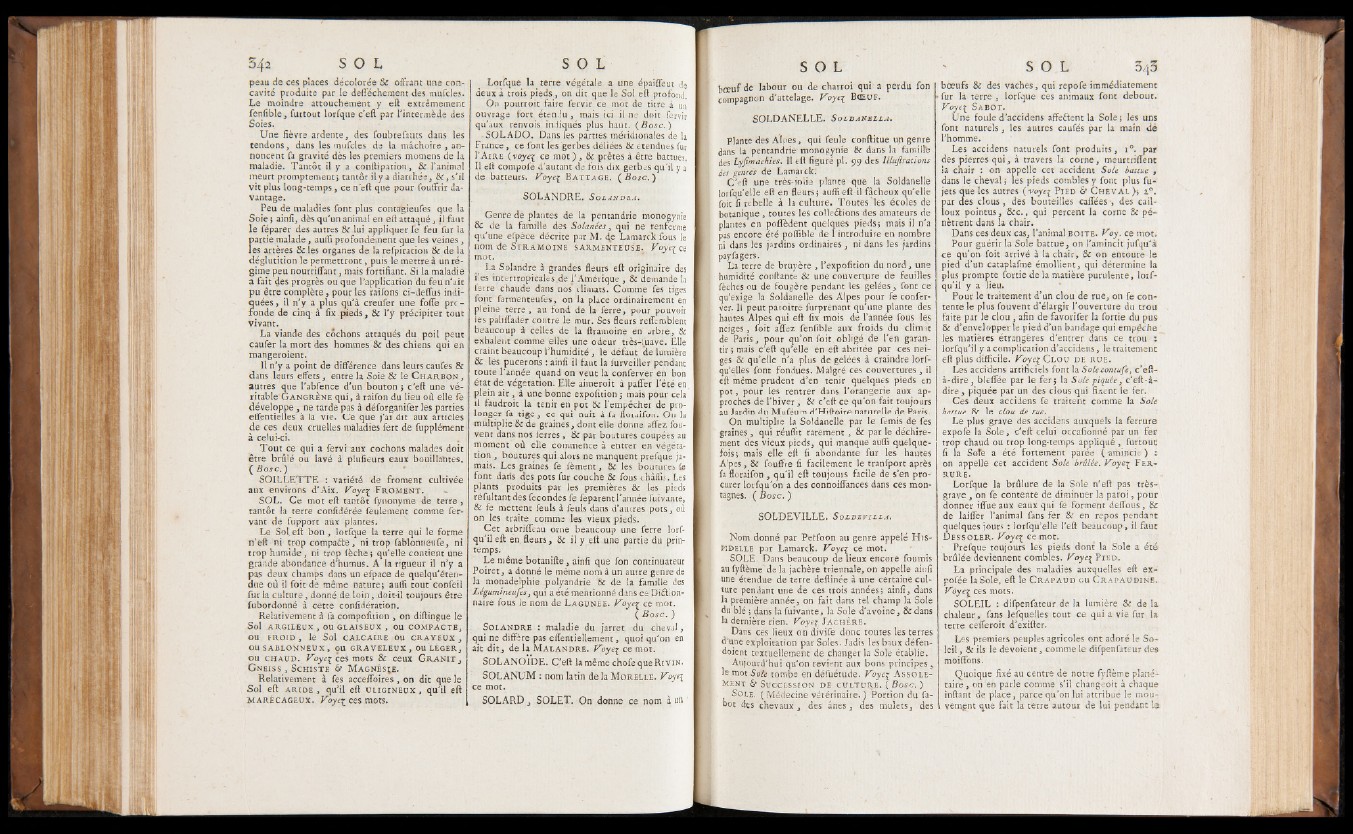
peau de ces places décolorée & offrant une concavité
produite par le deffécheroent des mufcles.
Le moindre attouchement y eft extrêmement
fenfible, furtout lorfque c’eft par l’intermède des
Soies.
Une fièvre ardente, des foubrefauts dans les
tendons, dans les mufcles de la mâchoire , annoncent
fa gravité dès les premiers momens de la
maladie. Tantôt il y a conftipation, & l’animal
meurt promptement5 tantôr il y a diarrhée, &T, s’il
vit plus long-temps, ce n’eft que pour fouffrir davantage.
Peu de maladies font plus contagieufes que la
Soie ; ainfi, dès qu’un animal en eft attaqué, il faut
le féparer des autres & lui appliquer le feu fur la
partie malade, aufli profondément que les veines,
les artères & les organes de la refpiratio» & de la
déglutition le permettront, puis le mettre à un régime
peu nourriflant, mais fortifiant. Si la maladie
a fait des progrès ou que l'application du feu n’ait
?pu être complète, pour les raifons ci-deffus indi- juées, il n’y a plus qu’à creufer une foffe prc-
onde de cinq à fix.pieds, & l’y précipiter tout
vivant.
La viande des cochons attaqués du poil peut
caufer la mort des hommes & des chiens qui en
mangeroient.
11 n’y a point de différence dans leurs caufes &
dans leurs effets, entre la Soie & le C h a r b o n ,
autres que l’abfence d’ un bouton ; c ’eft une vé-
ritable GANGRâNE qui, à raifon du lieu où elle fe
développe, ne tarde pas à déforganifer les parties
effentielles à la vie. C e que fai-dit aux articles
de ces deux cruelles maladies fert de fupplémenti
à celui-ci.
Tout ce qui a fervi aux cochons malades doit;
être brûlé ou lavé à plufieurs eaux bouillantes. !
( B o s c .)
SOIL LE TTE : variété de froment cultivée
aux environs d’ Aix. Voye^ F r om en t .
SOL. Ce mot eft tantôt fynonyme de terre,
tantôt la terre confidérée feulement comme fer-
vant de fupport aux plantes.
Le Sol,eft b o n , lorfque la terre qui le forme
n’eft ni trop compacte, ni trop fablonneufe, ni
trop humide, ni trop fèche ; qu’elle contient une
grande abondance d’humus. A la rigueur il n’y a
pas deux champs dans un efpace de quelqu’êten-
aue où il foit de même nature; auffi tout confeil
fur la culture, donné de loin, doit-il toujours être i
fubordonné à cette confidération.
Relativement à fa compofition, on diftingue le
Sol ARGILEUX , ou GLAISEUX , OU COMPACTE,
OU FROID , le Sol CALCAIRE OU CRAYEUX ,
OU SABLONNEUX, OU GRAVELEUX , OU LEGER,
ou ch au d . Voyez ces mots & ceux G r a n i t ,
G neiss , Schiste & Magné sie.
Relativement à fes acceffoires, on dit que le
Sol eft a r id e , qu’il eft u l ig in eu x , qu’ il eft
MARÉCAGEUX. Voye{ ce$ mots.
Lorfque la terre végétale a une épaiffeut de
deux à trois pieds, on dit que le Sol eft profond.
On pourroit faire fervir ce mot de titre à un
ouvrage fort étendu, mais ici il ne doit fervir
qu’aux renvois indiqués plus haut. (B o s c .)
• SO LADO. Dans les parties méridionales de la
France, ce font les gerbes déliées & étendues fur
I’A ire (voye% ce mot) , & prêtes à être battues.
Il eft compofé d'autant de fois dix gerbes qu'il y a
de batteurs. Voye[ Ba t t a g e . ( Bosc. )
SOLANDRE. S olandra.
Genre de plantes de la pentandrie monogynie
& de la famille des Sotanées, qui ne renferme
qu’une efpèce décrite par M. ({e Lamarck fous le
nom de St r am o in e sa rm én teu se . Voyez ce
mot.
La Solandre à grandes fleurs eft originaire des
îles intertropicales.de l’Amérique , & demande la
lerre chaude dans nos climats. Comme fes tiges
font farmenteufes, on la place ordinairement en
pleine terre, au fond de la ferre, pour pouvoir
les pàliffadér contre le mur. Ses fleurs reffemblent
beaucoup à celles de la ftramoine en arbre, &
exhalent comme elles une odeur très-l.uave. Elle
craint beaucoup l’humidité, le défaut de lumière
& les pucerons : ainfi il faut la furveiller pendant
toute l'année quand on veut la conferver en bon
état de végétation. Elle aimeroit à paffer l’été en,
plein a ir , à une bonne expofition ; mais pour cela
il faudroit la tenir en pot & l’empêcher de prolonger
fa t ig e , ce qui nuit à fa floraifon. On la
multiplie & de graines, dont elle donne affez fou-
vent dans nos ferres, & par boutures coupées au
moment où elle commence à entrer en végétation
, boutures qui alors ne manquent prefque jamais.
Les graines fe fèment, & les boutures le
font darîs des pots fur couche & fous châflis; Les
plants produits par les premières & les pieds
réfultant des fécondés fe féparent l’année fuivante,
& fe mettent feuls à feuls dans d’aucrés pots, où
on les traite comme les vieux pieds.
C e t arbriffeau orne beaucoup une ferre lorf-
qu’ ileft en.fleurs, & il y eft une partie du printemps.
Le même botanifte, ainfi que fon continuateur
Poiret, a donné le mêftie nom à un autre genre de
la monadelphie.polyandrie & de la famille des
Légumineuses y qui a été mentionné dans ce Di&ion-
naire fous le nom de Lagunée. Voyeç ce mot.
( B osc. )
So l and r e : maladie du jarret du cheval,
qui ne diffère pas effentiellement, quoi qu’on en
ait d it , de la Ma l a n d r e . Voyei ce mot.
SOLANOiDE. C ’eft la même chofequeRiviN.
SOLANUM : nom latin de la Morelle. Voye\
c e mot.
SO LA R D , SOLET. On donne ce nom à un
boeuf de labour ou de charroi qui a perdu fon
compagnon d’attelage. Voyei Boe u f .
SOLDANELLE. S o ld a n e l l a .
plante des Alpes, qui feule conftitue un genre
dans la pentandrie monogynie & dans la famill'e
des Lyfimachies. Il eft figuré pl. 99 des lllujlrations
des genres de Lamatck;
C ’eft une très-jolie plante que la Soldanelle
lorfqu’elle eft en fleurs ; auffi eft il fâcheux qu’elle
foit fi rebelle à la culture. Toutes'les écoles de
botanique, toutes les collections des amateurs de
plantes en pofledent quelques pieds; mais il n’a
pas encore été poflible de I introduire en nombre |
ni dans les jardins ordinaires, ni dans les jardins ;
payfagers.
La terre de bruyère , l’expofition du nord, une
humidité confiante & une couverture de feuilles
fèche? ou de fougère pendant les gelées, font ce
qu’exige la Soldanelle des Alpes pour fe confer-
Ver. Il peut paroître furprenant qu’une plante des
hautes Alpes qui eft fix mois de l’année fous les
neiges, foit affez fenflble aux froids du climat
de Paris, pour qu’on foit obligé de l’en garantir
; mais c ’eft qu’elle en eft abritée par ces neiges
& qu’elle n’a plus de gelées à craindre lorsqu'elles
font fondues. Malgré ces couvertures, il
eft même prudent d’en tenir quelques pieds en
p o t, pour les rentrer dans l’orangerie aux approches
de l’hiver, & c’eft ce qu'on fait toujours
au Jardin du Muféum d’Hiftoire naturelle de Paris.
On multiplie la Soldanelle par le femis de fes
graines, qui réuffit rarement, & par le déchirement
des vieux pieds, qui manque auffi quelquefois;
mais elle efi fi abondante fur les hautes
A'pes, & fouffre fi facilement le tranfport après
fa floraifon , qu’il eft toujours facile de s’en procurer
lorfqu’on a des connoiffances dans ces montagnes.
( Bosc. )
SOLDEVILLE. S o l o e v il l a .
Nom donné par Petfoon au genre appelé His-
PlDELLE par Lamarck. Voyez ce mot.
SOLE. Dans beaucoup de lieux encore fournis
au fyftèméde la jachère triennale, on appelle ainfi
une étendue de terre deftinée à une certaine culture
pendant une de ces trois années; ainfi, dans
la première année, on fait dans tel champ la Sole
du blé ; dans la fuivante, la Sole d’avoine, &dans
la dernière rien. Voyei Ja ch è r e .
Dans ces lieux on divife donc toutes les terres
d'une exploitation par Soles. Jadis les baux défen-
doient textuellement de changer la Sole établie.
Aujourd'hui qu’on revient aux bons principes,
le mot Sole tombe en défuétude. Voye% A ssolement
& Succession de cu l tu r e . ( B osc. )
Sole. ( Médecine vétérinaire. ) Portion du fa-
bot des chevaux, des ânes, des mulets, des
boeufs & des vaches, qui repofe immédiatement
fur la terre , lorfque ces animaux font debout.
Voyei Sabot.
Une foule d ’accidens affettent la Sole; les uns
font naturels, les autres caufés par la main dé
l’homme.
Les accidens naturels font produits, i° . par
des pierres qui, à travers la corne, meurtriffent
îa chair : on appelle cet accident Soie battue ,
dans le cheval ; les pieds combles y font plus fu-
jets que les autres (voye[ Pied & C h e v a l ); 20.
par des clous , dès bouteilles caffées -, des cailloux
pointus, & c . , qui percent la corne & pénètrent
dans la chair.
Dans ces deux cas, l’ animal b o it e . Voy. ce mot.
Pour guérir la Sole battue, on l’ amincit jufqu’ à
c e qu’on foit arrivé à la chair, & on entoure le
pied d’un cataplafme émollient, qui détermine la
plus prompte fortie de la matière purulente, lorf-
qu’il y a lieu.
Pour le traitement d’ un clou de rue, on fe contente
le plus fouvent d’élargir l’ ouverture du trou
faite par le c lo u , afin de favorifer la fortie du pus
& d’envelopper le pied d’ un bandage qui empêche
les matières étrangères d’entrer dans ce trou :
lorfqu’il y a complication d’accidens, le traitement
eft plus difficile. Voye^Chov de r u e .
Les accidens artificiels font la Solecontufe, c ’eft-
à-dire, bleffée par le fe r ; la Sole piquée y, c’eft-à-
d ire, piquée par un des clous qui fixent le fer.
Ces deux accidens fe traitent comme la Sole
battue & le clou de rue.
Le plus grave des accidens auxquels la ferrure
expofe la S o le , c’eft celui occafionné par un fer
trop chaud ou trop long-temps appliqué , furtout
fi la Sofe a été fortement parée ( amincie ) :
on appelle cet accident Sole brûlée. Voyej F ER-
RURE.
Lorfque la brûlure de la Sole n’eft pas très-
grave , on fe contente de diminuer la paroi, pour
donner iffueaux eaux qui fe forment deffous, &
de laiffer l’animal fans fer & en repos pendant
quelques jours : lorfqu’elle l’eft beaucoup, il faut
D e s so ler . Voyei ce mot.
I Prefque toujours les pieds dont la Sole a é té
brûlée deviennent combles. Voye[ Pie d .
La principale des maladies auxquelles eft ex-
pofée la Sole, eft le C r a p a u d ou C r a p a u d in e ,
Voyez ces mots.
SOLEIL t difpenfateur de la lumière & de la
chaleur , fans lefquelles tout ce qui a vie fur la
1 terre cefferoit d’exifter.
Les premiers peuples agricoles ont adoré le Soleil
, & ils le dévoient, comme le difpenfateur des
moiffonsi
Quoique fixé au centre de notre fyftème planétaire,
on en parle comme s’ il changeoit à chaque
inftant de place, parce qu'on lui attribue le mouvement
que fait la terre autour de lui pendant la