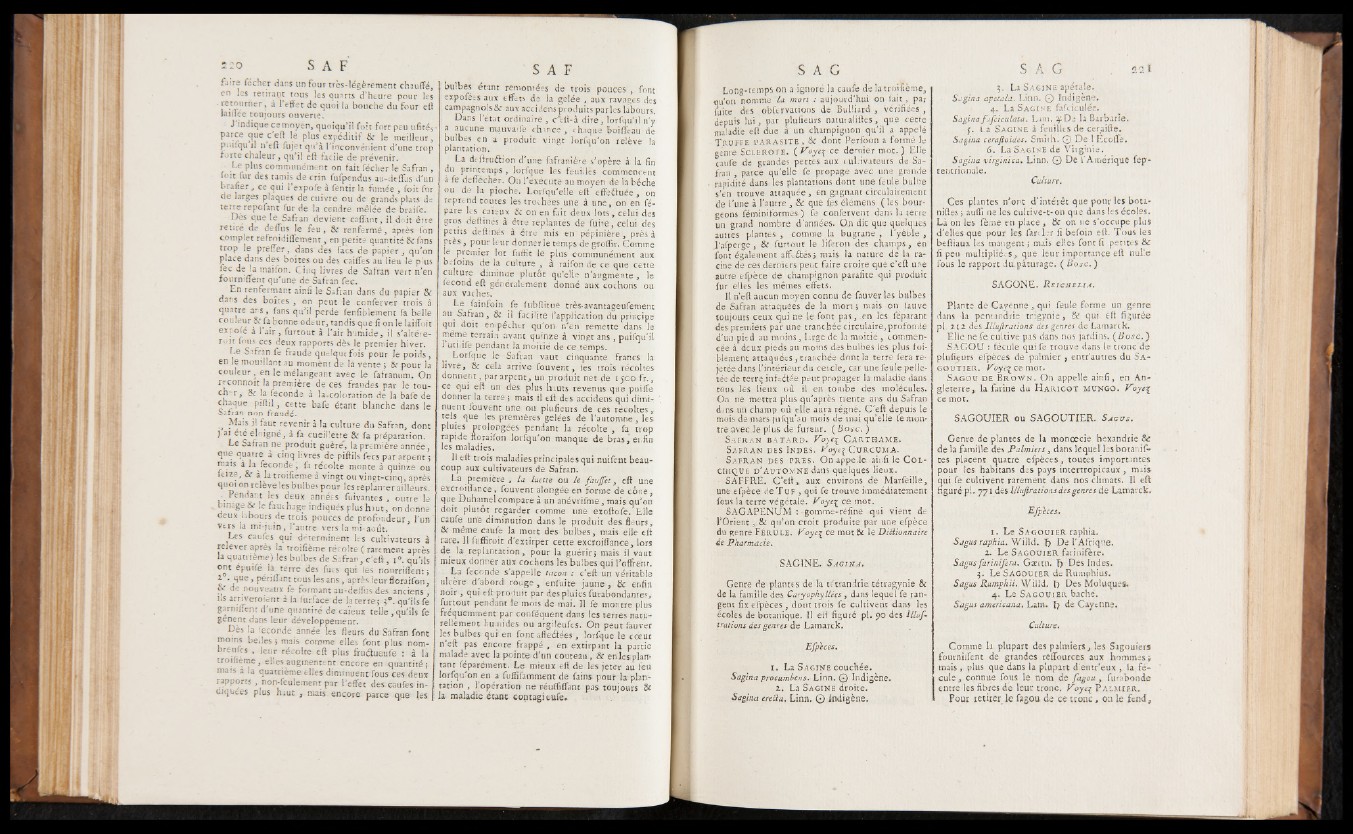
faire fécher dans un four très-légèrement chauffé,
en les retirant tous les quarts d’heure pour les
• re.c^ur^er > à 1 effet de quoi la bouche du four eft
laiflée toujours ouverte.
J indique ce moyen, quoiqu’ il foit fort peu ufitéj-
parce que c’eft le plus expéditif & le meilleur,
puifqu il n eft fujet qu’ à l’ inconvénient d’ une trop
forte chaleur, qu’ il eft facile de prévenir.
Le plus communément on fait fécher le Safran ,
foit fur des tamis de crin fufpendus au-defllis d’un
brafier, ce qui l’expofe à fentir la fumée , foit fur
de larges plaques de cuivre ou de grands plats de
terre repofant fur de la cendre mêlée de braife.
Dès que le Safran devient caftant, il doit être
retiré de deftiis le feu, & renfermé, après fon
complet refroidiffement, en petite quantité & fans
trop le prefter, dans des facs de papier, qu’on
place dans des boîtes ou des caiffes au lieu le plus
fec de la maifon. Cinq livres de Safran vert n’en
iourniffent qu’ une de Safran fec.
En renfermant ai nu le Safran dans du papier &
dans des boîtes , on peut le conferver trois à
quatre ar-s, fans qu’il perde fenfiblement fa belle
couleur &r fa bonne odeur, tandis que lï on le laiftoit
expofé a 1 a ir , furtout à l’ air humide, il s’altére-
roit fous ces deux rapports dès le premier hiver.
Le Safran fe fraude quelque fois pour Je poids,
en le mouillant au moment de la vente ; & pour la
couleur, en le mélangeant avec le fafranum. On
reconnoit la première de ces fraudes par le tou-
& la fécondé à la.caloration de la bafe de
chaque piftil, cette bafe étant blanche dans le
Safran non fraudé.
Mais il faut revenir à la culture du Safran, dont
j ai été éloigné, à fa cueillette & fa préparation. ;
Le Safran ne produit guère, la première année, i
que quatre à cinq livres de piftils fecs par arpent ;
mais à la fécondé j fa récolte monte à quinze ou
feize, & à la troifième à vingt ou vingt-cinq, après
quoi on relève les bulbes pour les replanter ailleurs.
. Pendant les deux années fuivantes , outre le
binage & le fauchage indiqués plus haut, on donne
deux labours de trois pouces de profondeur, l'un'
vers la mi-juin, l’autre vers la mi-août.
Les caufes qui déterminent les cultivateurs à
relever après la troifième récolte ( rarement après
la quatrième) les bulbes de Safran, c’e ft, i°. qu’ils
ont épuifé la terre des fucs qui les nourriftent ;
2°. que, périftant tous les ans , après leur floraifon,
& de nouveaux fe formant au-deftiis des. anciens ,
ns arriveroient à la furface de la terre; qu’ils fe
garniftent d’ une quantité de caïeux telle,qu’ ils fe
gênent dans leur développement.
Dès la fécondé année les fleurs du Safran font
moins belles ; mais comme elles font plus nom-
breufes , leur récolte eft plus fru&ueufe ; à là
troifième, elles augmentent encore en quantité;
mais a la quatrième elles diminuent fous ces deux
rapports, non-feulement par l’effet des caufes-indiquées
plus h a u t , mais encore parce que les. :
bulbes étant remontées de trois pouces , font
expo fées aux effets de la gelée , aux ravages des
campagnols & aux accidens produits parles labours.
Dans l’état ordinaire , c’ eft-à dire, lorfqu’ il n’y
a aucune mauvaife chance, chaque boifteau de
bulbes en a produit vingt lorfqu’on relève la
plantation.
La deftruétion d’ uné fafranière s’ opère à la fin
du printemps, lorfque les feuilles commencent
à fe deffécher. On l’exécute au moyen de la bêche
ou de la pioche. Lorfqu’elle eft effeétuée, on
reprend toutes les trochées une à une, on en fé-
pare les caïeux & on en fait deux lots, celui des
gros deftinés à être replantés de fuite, celui des
petits deftinés à être mis en pépinière, près à
près , pour leur donner le temps de gToflïr. Comme
le premier lot fuffit le plus communément aux
befoins de la culture , à raifon de ce que cette
culture diminue plutôt qu’elle n’augmente, le
fécond eft généralement donné aux cochons ou
aux vaches.
Le fainfoin fe fubftitue très-avantageufement
au Safran, & il facilite l’application du principe
qui doit empêcher qu’on n’en remette dans le
même terrain avant quinze à vingt ans , puifqu’il
l’utiiife pendant la moitié de ce temps.
Lorfque le Safran vaut cinquante francs la
livre, & cela arrive Couvent, (es trois récoltes
donnent, par arpent, un produit net de iy co fr .,
: ce °1U^ un des plus hiuts revenus que puiffe
donner la terre ; mais il eft des accidens qui diminuent
fouvent une ou plufieurs de ces récoltes,
•tels que les premières gelées de l ’automne, les
pluies prolongées pendant la récolte , fa trop
, rapide floraifon lorfqu’ on manque de bras, enfin
: les maladies.
Il eft trois maladies principales qui nuifent beaucoup
aux cultivateurs de Safran.
La première , la luette ou le fauffet, eft une
excroiffance, fouvent alongéeen forme de cône,
que Duhamel compare à un anévrifme, mais qu’on
doit plutôt regarder comme une exoftofe. Elle
caufe^ une diminution dans le produit des fleurs,
& meme caufe la mort des- bulbes, mais elle eft
rare. Il fuffiroit d’extirper cette excroiffance, lors
de la replantation, pour la guérir; mais il vaut
mieux donner aux cochons les bulbes qui l’offrent.
La fécondé s’appelle tacon : c’ eft un véritable
ulcère d ’abord rouge, enfuire jaune, & enfin
noir , qui eft produit par des pluies furabondantes,
furtout pendant le mois de mai. Il fe montre plus
fréquemment par conféquent dans les terres naturellement
humides ou argüeufes. On peut fauver
les bulbes qui en font affe&ées, lorfque le coeur
n’eft pas encore frappé , en extirpant la partie
malade avec la pointe d’un couteau., & enles plarT-
tanc féparément. Le mieux eft de les jeter au feu
lorfqu’on en a fuffifamment de fains pour la plantation
, l’opération ne réufliffant pas toujours &
ht maladie étant contagi eufe.
Long-temps on a ignoré la caufe de la troifième,
qu’on nomme la mort : aujourd’hui on fait, par
fuite des ob fer varions de Bul'.iard , vérifiées ,
depuis lu i, par plufieurs naturaüftes, que cette
maladie eft due à un champignon qu’ il a appelé
T ruffe p a r a s ite , & dont Perfoon a formé le
genre Sclerote. {Voyei ce dernier mot.) Elle
caufe de grandes pertes aux tuLivateurs de Safran
, parce qu’elle fe propage avec une grande
rapidité dans les plantations dont une feule bulbe
s’en trouve attaquée, en gagnant circulairement
de l’une à l’autre , & que fes élémens ( les bourgeons
fémi ni formes.) fe confervent dans la terre
un grand nombre d'années. On dit que quelques
autres plantes , comme la bugrane , l'yèbie ,
J ’afperge, & furtout le liferon des champs, en
font également affrétés; mais la nature de la racine
de ces derniers peut faire croire que c’eft une
autre efpèce de champignon parafite qui produit
fur elles les mêmes effets.
Il n’eft aucun moyen connu de fauver les bulbes
de Safran attaquées de la mort ; mais on lauve
toujours ceux qui ne le font pas, .en les réparant
des premiers par une tranchée circulaire, profonde
d’un pied au moins, large de la moitié, commencée
à deux pieds au moins des bulbes les plus foi-
blement attaquées, tranchée dont la terre fera rejetée
dans L’intérieur du ceicle, car une feule pelletée
de terr^ infeétée peut propager la maladie dans
tous les lieux où il en tombe des molécules.
On ne mettra plus qu’après trente ans du Safran
dans un champ où elle aura régné. C ’eft depuis le
mois de mars jufqu’au mois de mai qu’elle fe montre
avec ..le plus de fureur. ( Bosc. )
Safran batard. Voyei C arthame.
Safran des Indes. Voyei C urcuma.
' Safran des près. On appelle air.fi le C olchique
d’automne dans quelques lieux.
SAFFRE. C ’e ft, aux environs de Marfeille,
une efpèce rie T uf , qui fe trouve immédiatement
fous la terre végétale. Voyei ce mot.
SAGAPENUM : gomme-réfine qui vient de
l’Orient, & qu’ on croit produite par une efpèce
du genre Férule. Voye% ce mot & le Diâionnaire
4 e Pharmacie.
SAGINE. S a g in a .
Genre de plantés de la tetrandrietétragynie &
de la famille des Caryophyliées, dans lequel fe rangent
fix efpèces, dont trois fe cultivent dans les
écoles de botanique. Il eft figuré pl. 90 des llluj-
tracions des genres de Lamarck.
Efpèces,
1. La Sagine couchée.
Sagina procumbens. Linn. Q Indigène.
2. La Sagine droite.
Sagina erefta. Linn. O indigène.
3. La Sagine apétale.
Sagina apetala. Linn. O Indigène.
4. La Sagine fafciculée.
Sagina fifciculata. Lu ni, ü^De la Barbarie,
f. La Sagine à feuilles de ceraifte.
Sagina cerafioidcs. Smith. O De l Ecoffe.
' 6 . La Sagine de Virginie.
Sagina virginie a. Linn. O De l'Amérique fep-
tentrionale.
Culture.
Ces plantes n’ont d’ intérêt que pour les bota-
niftes ; au fil ne les cultive-t-on que dans les écoles.
Là on les fème en place, & on ne s’occupe plus
d’elles que pour les farc 1er fi befoin eft. Tous les
beftiaux les mangent ; mais elles font fi petites &
fi peu multipliées, que leur importance eft nulle
fous le rapport do-pâturage. ( Bosc. )
SAGONE. R eichelia.
Plante de Cayenne, qui feule forme un genre
dans la penrandrie trigynie, & qui eft figurée
pl. Z12 des Illuftrations des genres de Lamarck.
Elle ne fe cultive pas dans nos jardins. ( B o s c .)
SAGOU : fécule qui fe trouve dans le tronc de
plufieurs efpèces de palmier , entr’autres du Sa -
goutier. Voye* ce mor.
Sagou de Brown . On appelle ainfi, en Angleterre,
la farine du Haricot mungo. Voyei
ce mot.
SAGOUIER ou SAGOUTIER. S agus.
Genre de plantes de la monoecie hexandrie 8c
de la famille des Palmiers , dans lequel les botanif-
tes placent quatre efpèces, toutes importantes
pour les habitans des pays intertropicaux, mais
qui fe cultivent rarement dans nos climats. Il eft:
figuré pl. 771 des lllufirations desgenres de Lamarck.
Efpèces.
1. Le Sagouier raphia.
Sagus raphia. Willd. f) De l’Afrique.
2. Le Sagouier farinifère.
Sagus fari ni fera. Gaertn. T) Des Indes.
3. Le Sagouier de Rumphius.
Sagus Rumphii. \yiiid. {7 Des Moluques.
4. Le Sagouier bâché.
Sagus americana. Lam. de Cayenne.
Culture.
Comme la plupart des palmiers, les Sagouîers
fourniifent de grandes reffources aux hommes»
mais , plus que dans la plupart d entr’eux , la fécule
, connue fous le nom de fagou, Rirabonde
entre les fibres de leur tronc. Voyei Palmier.
Pour retirer le fagou de ce tronc, on le fend,