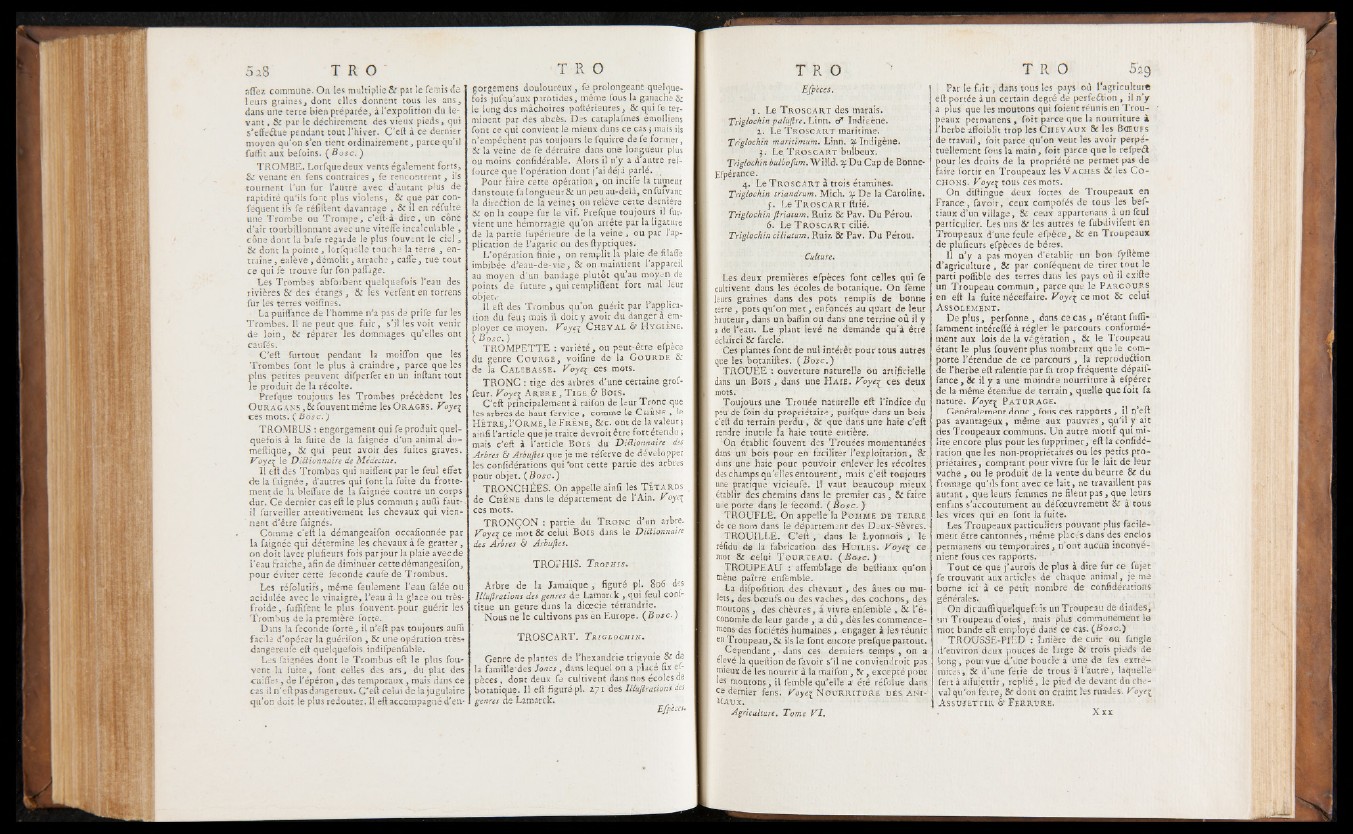
5a8 T R O
affez commune. On les multiplie & par le femis de
leurs graines, dont elles donnent tous les ans,
dans une terre bien préparée, àl’expofition du levant,
& par le déchirement des vieux pieds, qui
s’effectue pendant tout l’hiver. Ç’eft à ce dernier
moyen qu’on s’en tient ordinairementparce qu’il
fuffit aux befoins. ( B o s c . )
TROMBE. Lorfquedeux vents également forts,
& venant en fens contraires , fe rencontrent, ils
tournent l’un fur l’autre avec d’autant plus de
rapidité qu'ils font plus vioîens, & que par conséquent
ils fe réliftent davantage , & il en réfulte
une Trombe ou Trompe, c’eft-à dire, un cône
d’air tourbillonnant avec une viteffe incalculable,
cône dont la bafe regarde le plus Souvent le ciel,
& dont la pointe, lo ri quelle touche la terre , entraîne,
enlève, démolit, arrache, cafte, tue tout
ce qui fe trouve fur Son palTage.
Les Trombes abforbent quelquefois l’eau des
rivières & des étangs, 8c les verfent en torrens
Sur les terres voifînes.
La puiffance de l’homme n’a pas de prife fur les
Trombes. 11 ne peut que fuir, s’il les voit venir
de loin, 8c réparer les dommages qu’elles ont
caufés.
C’eft Surtout pendant la moiffon que les
Trombes Sont le plus à craindre, parce que les
plus petites peuvent difperfer en un inftant tout
le produit de la récolte.
Prefque toujours les Trombes précèdent les
O u r a g an s , & Souvent même les O r a g e s . V o y e^
ces mots. ( B o s c . )
TROMBUS : engorgement qui fe produit quelquefois
à la fuite de la faignée d'un animal do-
meftique, & qui peut avoir des fuites graves.
V o y e% lé D i c t io n n a i r e d e M é d e c in e .
Il eft des Trombes qui n ai lient par le feul effet
de la faigriée, d’autres qui font la fuite du frotte- 1
ment de la bleflure de la faignée contre un corps j
dur. Ce dernier cas eft le plus commun ; aulïi faut-.
il furveiller attentivement les chevaux qui viennent
d’être faignés.
Comme c’eft la démangeaifon occafionnée par
la faignée qui détermine les chevaux à fe gratter,
on doit laver plufieurs fois par jour la plaie avec de
i’eau fraîche, afin de diminuer cette démangeaifon,
pour éviter cette fécondé caufe de Trombus.
Les ré fol u tifs. même feulement l’eau falée ou
acidulée avec le vinaigre, l’eau à la glace ou très-
froide , fuffifent le plus fouvent- pour guérir les
Trombus de la première forte..
Dans la fécondé forte, il n’eft pas toujours autfi
facile d’opérer la guërifon, & une opération très-»
dangereuse eft quelquefois indifpenfable.
Les faignées dont le Trombus eft le plus fou-
vent la fuite, font celles des ars, du plat des
cuiffes, de l’épéron, des temporaux, mais dans ce
cas il n’eft pas dangereux. C’eft celui de la jugulaire
qu’on doit le plus redouter.il eft accompagné d’en-
T R O
gorgemens douloureux, fe prolongeant quelquefois
jufqu’aux parotides, même fous la ganache &
le long clés mâchoires poftérieures, & qui fe terminent
par des abcès. Des cataplalmes émolliens
font ce qui convient le mieux dans ce cas j mais ils
n’empêchent pas toujours le fquirre de fe former,
& la veine de fe détruire dans une longueur plus
ou moins confidérable. Alors il n’y a d’autre ref-
fource que l'opération dont j'ai déjà parlé. <
Pour faire cette opération, on incife la tumeur
dans toute fa longueur & un peu au-delà, enfuivanc
la direction de la veine; on relève cette dernière
& on la coupe fur le vif. Prefque toujours il fur-
vient une hémorragie qu’on arrête par la ligature
de la partie fupérieure de la veine, ou par l’application
de l’agaric ou des ftyptiques.
L’opération finie, on remplit la plaie de filafle
imbibée d’eau-de-vie, & on maintient l’appareil
au moyen d’un bandage plutôt qu’au moyen de
points de future, qui rempliffent fort mal leur
objet*'
11 eft des Trombus qu’on guérit par l’application
du feu ; mais il doit y avoir du danger à employer
ce moyen. V o y e [ C h e v a l & H y g iè n e .
( B o s c . ) , ' ' > TROMPETTE : v a r i é t é , o u p e u t- ê tr e efpèce
d u g e n r e C o u r g e , v o ifin e d e la G o u r d e 8c
d e la C a l e b a s s e . V o y e ^ c e s m o ts.
TRONC : tig e d e s a rb re s d ’u n e c e rta in e gro f-
f e u r. Voyc^ A r b r e , T ig e & Bo i s .
C’eft principalement à raifon de leur Tronc que I
les arbres de haut fervice , comme le C h ê n e , le I
H ê t r e , I ’ O r m e , le F r ê n e , &c. ont de la valeur;
ainfi l’article que je traite devroit être fort étendu ;
mais c’eft à l’article Bois du D i c t io n n a i r e des |
A r b r e s & A r b u jte s que je me réferve de développer
les confidérations qui 'ont cette partie des arbres
pour objet. (B o s c .)
TRONCHÉES. On appelle ainfi les T ê t a r d s
de C h ê n e dans le département de l’Ain. V o y e \
ces mots.
TRONÇON : p a r tie d u T r o n c d ’u n arbre.
V o y e [ c e m o t & c e lu i Bois d an s le D ic t io n n a ir e
d e s A r b r e s & A r h u f ie s .
TROPHIS. T rophi s .
Arbre de la Jamaïque , figuré pl. 8o6 des
I l lu f i r a t io n s d e s g e n r e s de Lamarck , qui feul conf*
titue un genre dans la dioecie tétrandrie.
Nous ne le cultivons pas èn Europe. { B o s c . )
TROSCART. T r ig l o ch in .
Genre de plantes de l’hexandrie trigynie 8c de
la famille des J o n c s , dans lequel on a placé fix espèces
, dont deux fe cultivent dans nos écoles de
botanique. Il eft figuré pl. 2 .71 des U lu . f i r a t io n s des
g en r e s de Lamarck.
è E f p i c e s A
T R O
E fp e c e s .
1. Le T roscart des marais.
T r ig lo c h in p a lu f ir e . Linn. d * Indigène.
1 . Le T roscart maritime.
T r ig lo c h in m a r i t im um . Linn. if. Indigène.
3. Le T roscart bulbeux.
T r ig lo c h in b u lb o f u m .W ÏW d .i fD v L Cap de Bonne- I Efpé ranc e.
4. Le T roscart à trois étamines.
T r ig lo c h in t r ia n d rum . Mich. i f De la Caroline.
5. Le T roscart ftrié.
T r ig lo c h in f t r ia tu m . Ruiz & Pav. Du Pérou.
6. Le T roscart cilié.
T r ig lo c h in c i l ia t u m . Ruiz & Pav. Du Pérou.
C u ltu r e .
Les deux premières efpèces font celles qui fe
I cultivent dans les écoles de botanique. On fème
I leurs graines dans des pots remplis de bonne
K terre, pots qu’on met, enfoncés au quart de leur
I hauteur, dans un baflïn ou dans une terrine où il y
I a de Peau. Le plant levé ne demande qu’à être
éclairci 8c fardé.
. Ces plantes font de nul intérêt pour tous autres
que les botaniftes. { B o s c . )
TROUÉE : ouverture naturelle ou artificielle
dans un Bois, dans une Ha ie . K o y e ^ ces deux
mots.
Toujours une Trouée naturelle eft l’indice du
peu de foin du propriétaire, puifque dans un bois
c’eft du terrain perdu1, & que dans une haie c’eft
rendre inutile la haie toute entière.
On établit fouvent des Trouées momentanées
dans un bois pour en faciliter rexploitarion, &
dans une haie pour pouvoir enlever les récoltes
des champs qu elles encourent, mais c’eft toujours
une pratique vicieufe. Il vaut beaucoup mieux
établir des chemins dans' le premier cas, & faire
uiie porte dans le fécond. ( B o s c . )
TROÜFLE. On appelle la Pomme de terre
de ce nom dans le département des Deux-Sèvres.
TROUILLE. C’eft, dans le -Lyonnais , le
I réfîdu de la fabrication des Huiles. K o y e ç ce
■ mot & celui T ourteau. {B a s e .)
TROUPEAU : affembkge de beftiaux qu’on
[ mène paître enfemble.
La difpofition des chevaux , des ânes eu mu-
| Jets, des boeufs ou des vaches, des cochons, des
I moutons, des chèvres, à vivre enfemblé , 8c l’é-
I conomie de leur garde , a dû , dès les commence-
I mens des fociétés humaines, engager à les réunir
I en Troupeau, & ils le font encore prefque partout.
I ^ Cependant, - dans ces derniers- temps , on a
■ élevé la q u e ftio n d e fa v o ir s’il n e c o n v ie n d ro n t pas
| mieux d e les n o u rr ir à la m a ifo n , & „ e x c e p té p o u r
| *eS m o u ro n s , i l fembl'e q u ’e lle a1 é té ré fo lu e dan s
K c e d e rn ie r fe n s. Voye^ N o u r r i t u r e d e s a n i -
I maux.
A g r i c u ltu r e . T o m e K l .
T R O 5-29
Par le fait, dans tous les pays où l'agriculture
eft portée à un certain degré de perfection, il n’y
a plus que les moutons qui foient réunis en Troupeaux
permanens , foit parce que la nourriture à
î’herbe affoiblit trop les C h e v a u x & les Boe u f s
de travail, foit parce qu’on veut les avoir perpé-
I tueliement fous la main, foit parce que le refpeét
pour les droits de la propriété ne permet pas de
faire fortir en Troupeaux les V a c h e s & les Coc
h o n s . V o y e£ tous ces mots.
On diftingue deux fortes de Troupeaux en
France, favoir, ceux compofés de tous les beftiaux
d’un village, & ceux appartenais à un feul
particulier. Les uns 8c les autres fe fubdivifent en
Troupeaux d’une feule efpèce, 8c en Troupeaux
j de plufieurs efpèces de bêtes.
Il n’y a pas moyen d’établir un bon fyftème
d’agriculture, & pat- conféquent de tirer tout le
parti poflible des terres dans les pays où il exifte
un Troupeau commun, parce que le P a r c o u r s
en eft la fuite nécelfaire. V o y e 1 ce mot 8c celui
A s s o l e m e n t .
De plus, perfonne , dans ce cas , n’étant fuffi-
famment intéreffé à régler le parcours conformément
aux lois de la végétation , & le Troupeau
étant le plus fouvent plus nombreux que le comporte
l’étendue de ce parcours , la reproduction
de l’herbe eft ralentie par fa trop fréquente dépaif-
fance, & il y a une moindre nourriture à efpérer
de la même étendue de terrain, quelle que foit fa
nature. V o y e£ P â t u r a g e .
Généralement donc , fous ces rapports, il n’eft
pas avantageux, même aux pauvres, qu'il y ait
des Troupeaux communs. Un autre morif qui milite
encore plus pour les fupprimer, eft la confidé-
ration que les non-propriétaires ou ïes petits propriétaires,
comptant pour vivre fur le lait de leur
vache, ou le produit de la vente du beurre 8c du
fromage quhlsfont avec ce lait, ne travaillent pas
autant, que leurs femmes ne filent pas, que leurs
enfans s’accoutument au défoeuvrement 8c à tous
les vices qui en font la fuite.
Les Troupeaux particuliers pouvant plus facilement
être cantonnés, même placés dans des enclos
permanens ou temporaires, n’ont aucun inconvénient
fous ces rapports.
Tout ce que j’aurois de plus à dire fut ce fujet
fe trouvant aux articles de chaque animal, je me
borne ici à ce petit nombre de confidérations
générales.
On dirauffiquelquefois un Troupeau de dindes,
un Troupeau d’oies , mais plus communément le
mot bande eft employé dans ce cas. { B o s c . )
TRQUSSE-PÏED : lanière de cuir ou fangîe
d’environ deux pouces de large 8c trois pieds de
long, pourvue d’une boucle à une de fes extrémités,
8c d’une férié de trous à l’autre, laquelle
ferc à alfujettir, replié, le pied de devant du cheval
qu”ori ferre, 8c dont on craint les ruades. V o y c \
| A s s u j e t t i r b F e r r u r e . Xxx